IVAR SAMSET, chef de l'Institut norvégien de recherches forestières de Vollebekk (Det Norske Skogforsøksvesen), a prononcé ce discours lors de son élection aux fonctions de vice-président de l'Union internationale des instituts de recherches forestières, au quatorzième Congrès de l'IUFRO qui a eu lieu à Munich (Allemagne) en septembre 1967. A ce même Congrès, M. George M. Jemison, sous-directeur pour la recherche du Service des forêts des Etats-Unis a été élu président, succédant à M. Julius Speer, président du Conseil allemand de la recherche (Deutsche Eorschungsgemeinschaft). Le prochain congrès de l'IUFRO aura lieu à Gainesville, Floride (Etats-Unis), en 1971.
Savants et chercheurs du monde entier sont rassemblés aujourd'hui pour procéder en toute liberté à des confrontations d'idées et d'expériences touchant l'évolution de la foresterie en général et les conséquences de cette évolution pour la recherche forestière. C'est pour moi un honneur de vous faire part de certaines réflexions qui nous intéressent tous directement.
Il y a un an, plus de deux mille praticiens et théoriciens de la foresterie représentant les milieux administratifs, scientifiques, techniques, industriels et commerciaux, étaient réunis à Madrid pour confronter leurs expériences à l'occasion de Congrès forestier mondial. Une question était posée: quel rôle incombe à la foresterie dans une économie mondiale en pleine transformation? La réponse unanime a été optimiste: la demande mondiale de bois et de produits dérivés continuera de s'accroître, quelle que puisse être la concurrence exercée par d'autres produits.
Comment aurait-on pu ne pas être optimiste? Non seulement la demande de produits forestiers augmente sans cesse, mais jamais l'homme n'a disposé d'autant de moyens de conserver les ressources forestières et d'accroître la production de la forêt et des industries du bois. Ces nouveaux moyens sont dus au progrès général de tous les secteurs d'activité; il est indispensable que les forestiers d'aujourd'hui apprennent à les utiliser.
C'est à la recherche forestière qu'il incombe de jalonner la voie en évitant les obstacles. D'où l'importance des congrès internationaux comme celui de l'IUFRO, dont l'objet même est de susciter des échanges d'idées et d'expériences.
L'expansion de la demande de produits forestiers ne date pas d'hier, il suffit d'un coup d'œil rétrospectif pour s'en convaincre: l'invention de la scie remonte à plus de 3 500 ans, et l'exploitation des cèdres et des cyprès de Liban - qui ont servi notamment à construire le temple du roi Salomon il y a quelque trois mille ans - restera dans les annales comme un tour de force: il a fallu trente mille ouvriers forestiers pour l'abattage, le débardage et le flottage des grumes le long de la côte.
L'histoire nous enseigne que les Athéniens ont perdu la guerre de Péloponnèse contre Sparte, en 104 avant Jésus-Christ, parce qu'ils manquaient de navires et qu'ils n'avaient pas de bois pour reconstruire leur flotte. Platon, commentant la défaite dans le Critias, relève avec perspicacité le rapport entre les problèmes de reboisement, ceux des bassins versants et ceux de l'érosion, posant ainsi il y a plus de 2 300 ans le premier fondement de la science forestière. Mais ce n'est qu'au dix-huitième siècle que cette science a réellement commencé à progresser. On peut citer les noms de von Beckmann (1700-1777) qui s'est occupé des questions de sylviculture et de von Moser (1729-1793), père de l'économie forestière.
La FAO a présenté l'an dernier au Congrès forestier mondial une étude intitulée Le bois: évolution et perspectives mondiales, dont les conclusions doivent inciter à l'action. Jamais la demande de produits forestiers n'a été plus élevée, et elle doit s'accroître encore. La consommation mondiale de bois en 1961 était estimée à 2 130 millions de mètres cubes, et la valeur totale des exportations mondiales de tous les produits forestiers à environ 5 100 millions de dollars U.S. par an, soit environ cinq pour cent de la valeur du commerce mondial total. Selon les calculs, les besoins mondiaux s'élèveront à 2 690 millions de mètres cubes en 1975 par rapport à 1961, cela représente un accroissement de 25 pour cent ou de 560 millions de mètres cubes, dont soixante-dix pour cent seront demandés par les pays développés; or, dans ces pays, la consommation de panneaux dérivés du bois, de papier et de carton s'accroît plus rapidement que celle de sciages, de sorte que pour cette partie des besoins nouveaux la dimension et la forme du bois auront moins d'importance que le volume de la production et le coût du bois et des fibres de bois.
L'étude de la FAO donne aussi sur l'approvisionnement en bois des renseignements qui permettent de tracer les grandes lignes de l'évolution future de la foresterie: en Europe et aux Etats-Unis, il ne reste que peu de résineux arrivés à maturité ou vieux, utilisables pour le sciage; la proportion des arbres jeunes et de petite dimension s'accroîtra. Par contre, en U.R.S.S. et au Canada, il existe encore de grandes superficies de forêts vierges peuplées d'arbres arrivés à maturité et vieux. Mais ces forêts sont éloignées et la possibilité d'accroître leur production dépend dans une large mesure des voies de communication ainsi que des techniques et des coûts du transport. Les quantités enlevées chaque année en U.R.S.S. représentent environ 60 pour cent de la récolte potentielle; au Canada, cette proportion n'est que de 45 pour cent. La production de ces pays pourra donc croître si l'infrastructure nécessaire est établie. Les forêts tropicales humides contiennent de vastes peuplements très hétérogènes dont l'utilisation dépendra surtout des progrès des méthodes d'exploitation et de l'intégration des industries du bois. Enfin, on pourra compter sur les plantations d'essences à croissance rapide qui représentent dans le monde entier un potentiel toujours plus considérable de production de bois d'œuvre et d'industrie.
L'optimisme est donc fondé, et, moyennant un développement des activités forestières, les ressources seront suffisantes pour faire face à l'accroissement de la demande de bois. Encore faudra-t-il, pour assurer des progrès dans divers domaines, résoudre les grands problèmes de la foresterie moderne, à savoir:
1. Méthodes de plantation et programmes accrus de plantation.2. Méthodes d'éclaircie et de récolte des bois de petites dimensions.
3. Accroissement de la production de fibre à un coût acceptable par des moyens sylvicoles.
4. Méthodes d'abattage, de débardage et de transport permettant l'exploitation économique des zones éloignées et des montagnes d'accès difficile.
5. Procédés industriels permettant de traiter un plus grand nombre d'espèces et même des mélanges d'espèces.
Le potentiel des forêts du monde suffira à faire face aux besoins accrus si des solutions sont apportées à ces grands problèmes: c'est là une tâche qui incombe au premier chef aux organismes de recherches forestières.
Depuis la fondation de l'IUFRO en 1890, c'est la recherche - pure et appliquée - qui oriente la pratique forestière.
Les essais de provenance et la recherche génétique illustrent bien ce rôle de la recherche: au sud de la zone tempérée, des peuplements artificiels d'Eucalyptus, de Pinus radiata, etc., ont un rendement parfois quintuple de celui des forêts nordiques.
Dans le dernier rapport annuel de l'école de foresterie de l'université d'Etat de la Caroline du Nord, B.J. Zobel (1967) déclare qu'avec les essais de provenance et la recherche génétique, on peut compter sur une amélioration du rendement et de la qualité du bois, et sur la production d'essences à fibres plus longues et résistantes aux parasites. Des résultats analogues ont été obtenus dans différents centres de recherche. Particulièrement à l'ordre du jour, certaines recherches font entrevoir la possibilité de réduire le coût des programmes sylvicoles en diminuant le nombre des éclaircies nécessaires.
La recherche forestière permet de mettre graduellement au point des méthodes de reboisement économique avec des plants hautement sélectionnés. Grâce au progrès des techniques de pépinières et de plantation (les plants à racines nues sont remplacés par des plants emballés ou en mottes), la plantation sera bientôt économique et fortement mécanisée même en terrain accidenté et pierreux. Des progrès ultérieurs rendront peut-être rentable la mécanisation de toutes les opérations.
L'application d'engrais aux épicéas de Norvège dans les forêts tempérées du Nord fournit un autre exemple des résultats de la recherche: avec 150 kilogrammes d'azote par hectare, le rendement annuel augmente d'environ 3 mètres cubes par hectare. Selon A. Brantseg environ dix millions d'hectares pourraient être fertilisés en Europe du Nord (1954), ce qui accroîtrait sans doute la production annuelle de quelque 30 millions de mètres cubes. On a obtenu des résultats analogues au Canada occidental depuis 1963 dans des essais de fertilisation par voie aérienne des peuplements de bois à pâte. Des perspectives brillantes sont donc ouvertes à la foresterie de demain.
Dans le secteur de la technologie du bois, les progrès sont rapides depuis quelques années. La productivité des industries s'est accrue et les coûts du traitement ont beaucoup diminué. Sans conteste, c'est à la recherche sur les produits forestiers qu'il faut attribuer ces progrès.
Un facteur intéressant est l'accroissement de la productivité de la main-d'œuvre: dans les scieries traditionnelles de petites et moyennes dimensions, il fallait couramment de 1 à 3 journées de travail par mètre cube et il existe dans les pays en voie de développement des scieries où il faut 13 journées de travail par mètre cube. Quel contraste avec les scieries modernes hautement productives où il suffit de 0,3 à 0,4 journée de travail par mètre cube!
Dans l'industrie de la pâte et du papier, même résultat: dans une fabrique classique de pâte au sulfate de dimension moyenne (300 tonnes/jour), il suffit de 0,2 à 0,3 journée de travail par mètre cube.
Pour arriver aux progrès spectaculaires enregistrés aujourd'hui, il a fallu de longues recherches et de nombreuses expériences. On peut citer par exemple la transformation de la machine à papier classique par l'introduction de procédés nouveaux (inverform, twinverform, papriformers). Ces perfectionnements permettent d'améliorer la structure du papier et d'accroître la productivité. Pour le papier journal, il est question de machines à papier d'une vitesse de 1500 mètres par minute.
Un autre exemple est le blanchiment de la pâte qui, dans une fabrique de pâte kraft moderne, représente souvent la moitié du coût total de la production: les travaux du professeur Rapson à l'université de Toronto ouvrent des perspectives intéressantes à cet égard. Un nouveau procédé permettra d'éclaircir les copeaux et de blanchir le papier à mesure qu'il se fait dans la machine, ou bien de blanchir la pâte avant de la former en feuille.
Certaines découvertes récentes intéressent tout particulièrement l'avenir de la foresterie mondiale. En quelques mots, les principales tendances qui résultent de l'application de ces découvertes sont les suivantes:
1. Coordination étroite entre la production forestière et les industries utilisatrices du bois.2. Intégration de différents types d'industries du bois.
3. Nouveaux procédés industriels permettant une forte production avec des machines moins grandes.
Ainsi, de nouvelles machines permettront de produire en une seule opération des sciages et des copeaux, utilisant intégralement la matière première, ce qui favorisera l'intégration de la scierie avec la fabrication de pâte. Les nouvelles déchiqueteuses consomment moins d'électricité que les déchiqueteuses classiques et produisent moins de vibrations, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à l'utilisation de déchiqueteuses mobiles en forêt. L'emploi de ces appareils, joint à celui d'une écorceuse mobile, pourra être intéressant pour les éclaircies ou la récolte du bois de deuxième choix.
La production de pâte mécanique à partir de copeaux est un autre progrès révolutionnaire, ne serait-ce que par l'effet qu'il peut avoir sur la coordination entre la foresterie et les industries forestières. La fabrication de pâte mécanique extra-fine avec des raffineurs s'est répandue rapidement: environ 7 pour cent de la production mondiale de pâte mécanique est fabriquée avec ce procédé. A ce propos, il faut mentionner les nouveaux lessiveurs à cuisson continue pour la fabrication de pâte kraft de qualité supérieure avec lesquels le cycle de production est réduit à une heure au lieu des trois heures à trois heures et demie que demande le procédé continu. Il pourrait en résulter une tendance à adopter des matériels plus petits, avec une réduction des coûts de production ainsi que des investissements.
Lincoln R. Thiesmeyer (1966) souligne l'importance des études visant à établir la corrélation entre les caractéristiques du bois et le produit final. Il y a en effet tout lieu d'encourager ce genre de recherches. Le développement des connaissances techniques et biologiques permettra sans doute de fabriquer industriellement des produits de bonne qualité et d'un prix acceptable avec une grande variété d'essences. Les progrès dans ce domaine auront une importance déterminante pour les programmes sylvicoles.
Un aspect important de la production forestière est la quantité d'énergie manuelle ou mécanique qu'elle utilise, ainsi que l'administration et l'entretien de ces moyens de production. Cela vaut pour l'exploitation aussi bien que pour les travaux sylvicoles et les transports. Les résultats de la recherche depuis quelques dizaines d'années ont abouti à un revirement des idées dans ce domaine.
Il y a encore des exploitations intensives, à fort coefficient de main-d'œuvre, demandant plus de 5 hommes/jour par mètre cube, mais on peut leur opposer des exploitations modernes, entièrement mécanisées, et dans lesquelles il faut moins de 0,1 homme/jour par mètre cube. On assiste à ce que l'on pourrait appeler la révolution industrielle de la foresterie. Cette industrialisation tire amplement profit du progrès général des techniques dans tous les secteurs; à signaler les moteurs légers d'une grande puissance, l'utilisation de la force hydraulique et pneumatique à haute pression, l'emploi de la radio et d'autres moyens de commande à distance, etc. Avec des véhicules à chenilles équipés de bandes flexibles assurant un maximum d'adhérence au sol et un minimum d'enfoncement, les sites à terrain mou ou couverts de neige épaisse sont désormais accessibles. Les derniers progrès dans le domaine des tracteurs à châssis articulé équipés de gros pneus de caoutchouc mettent à la disposition des forestiers des véhicules tous terrains qui ne s'enfoncent pas dans le sol. L'énergie mécanique est amenée jusque dans les chantiers d'exploitation forestière.
Autre progrès notable, la continuité du transport sur une longue distance, de la forêt à l'usine. L'amélioration des réseaux de communication et des véhicules est évidente. A noter particulièrement les appareils perfectionnés de chargement et de déchargement, qui réduisent au minimum le coût de ces opérations. Il n'est pas rare maintenant que les arbres puissent être traités dans une usine quelques jours seulement après l'abattage.
Dans certains cas, les innovations s'écartent radicalement de la tradition; les expériences canadiennes de transport à longue distance des copeaux en pipe-lines en sont un excellent exemple.
Les nouvelles machines d'exploitation forestière sont particulièrement intéressantes; certaines permettent le débardage d'arbres entiers, la transformation en grumes ou en copeaux étant centralisée. D'autres transforment en pleine forêt des arbres en divers assortiments de produits. Il ne s'agit pas de possibilités théoriques; en Amérique du Nord, dans les pays scandinaves et en U.R.S.S., divers modèles sont utilisés dans des opérations de recherche pratique. Ces machines ont passé le stade des expériences préliminaires et l'on peut espérer qu'elles seront appliquées en pratique à la foresterie, d'ici quelques années.
Même les forêts de montagnes inaccessibles, où l'exploitation forestière est coûteuse et parfois prohibitive, ont fait l'objet de recherches. Les câbles aériens sont bien connus; depuis quelques années, le transport par ballons ou hélicoptères permet d'envisager de nouvelles possibilités pour l'exploitation des régions montagneuses. Dans ce domaine, le câble-grue télécommandé avec lequel on a obtenu de bons résultats expérimentaux dans des forêts de montagnes en Norvège a probablement de l'avenir.
FIGURE 2. - Les machines pour l'exploitation forestière par arbres entiers n'en sont plus au stade expérimental et l'on peut s'attendre à ce qu'elles soient utilisées en foresterie pratique d'ici quelques années:
1. Machine Beloit pour l'exploitation de l'épicéa
Depuis la construction de la première scie à chaîne mécanique en 1858, plusieurs étapes ont été franchies: après le travail manuel et les outils mécaniques, on en arrive au remplacement de l'ouvrier forestier par un mécanicien. L'automation promet une nouvelle révolution, des machines polyvalentes effectuant automatiquement plusieurs opérations successives.
Il faut, pour plusieurs raisons d'ordre économique, se féliciter de ce progrès des techniques forestières. Considérons par exemple l'évolution du prix des produits industriels depuis quinze ans: dans beaucoup d'industries, le prix des produits a diminué; pour la pâte au sulfate blanchie, cette baisse est de 1,1 pour cent par an. On observe la même tendance pour l'acier laminé (baisse annuelle: 1,7 pour cent). Dans l'industrie des matières plastiques, la baisse atteint 4,8 pour cent par an pour le polyéthylène. Pendant la même période de quinze ans, le coût de la main-d'œuvre industrielle a monté à un taux qui atteint en Norvège 11,1 pour cent par an. Pour concilier cette baisse du prix de vente des produits avec la hausse du coût de la main-d'œuvre, l'industrie doit appliquer de nouveaux procédés de fabrication à haut rendement. Les industries du bois doivent en outre absorber un accroissement du coût de la matière première: en Norvège, le prix du bois à pâte a augmenté de 6,1 pour cent par an depuis quinze ans.
D'après ce qui précède, il est évident que l'on ne peut pas espérer que le prix des produits de la forêt continuera à monter. Mais cela ne doit pas inciter au pessimisme. La technologie moderne ouvre de nouvelles possibilités que la recherche forestière se doit de traduire en progrès concrets.
Dans la plupart des pays ayant des activités forestières, le coût de la main-d'œuvre tend à augmenter. Depuis une quinzaine d'années, cette augmentation est en moyenne de 10 à 15 pour cent par an dans les pays d'Europe. Dans l'est du Canada, elle est d'environ 9 pour cent par an. Dans un pays comme l'Inde, on observe également une légère augmentation, mais nettement moins marquée qu'en Europe - de 6 à 7 pour cent par an seulement. Il semble donc que la hausse du coût de la main-d'œuvre soit légèrement moins forte dans les pays en voie de développement que dans les pays relativement développés d'Europe; d'autre part, elle est relativement faible aussi dans les pays à revenu très élevé, comme les Etats-Unis ou le Canada.
Par contre, on observe une tendance commune à tous les pays, quel que soit leur degré de développement: le coût de la main-d'œuvre augmente beaucoup plus rapidement que celui des opérations mécanisées (figure 4). Avec la modernisation de l'industrie, les coûts de production diminuent; on emploie des machines perfectionnées qui sont à la fois plus légères, plus puissantes et plus productives et surtout, les coûts de fonctionnement et d'entretien diminuent. Cette évolution montre la voie à suivre en foresterie: il faut pallier la faible productivité de la main-d'œuvre par une mécanisation complète de toutes les opérations.
Les salaires varient beaucoup selon les régions. Exprimé en dollars U.S., le salaire des ouvriers forestiers était en 1965 de 0,5 dollar par jour en Ouganda, de 1 dollar en Inde, de 2 à 4 dollars en Grèce, de 11 dollars en Scandinavie et de 20 dollars dans l'est du Canada (figure 5). Dans certains pays en voie de développement les méthodes à fort coefficient de main-d'œuvre resteront sans doute en usage pendant un certain temps en raison du sous-emploi. La mécanisation est d'ailleurs toujours graduelle. L'homme reste naturellement attaché aux méthodes traditionnelles jusqu'à ce que la pression des prix impose des perfectionnements. Le progrès suit une loi que l'on pourrait appeler loi de l'évolution discontinue (figure 6). L'adoption d'une innovation technique se fait en quatre stades; au stade de la pression économique, le coût des méthodes traditionnelles de travail devient excessif; au stade du développement, de nouvelles méthodes sont mises à l'épreuve de l'expérience;
On a étudié cette évolution discontinue des méthodes de travail en forêt pour les pays scandinaves (figure 7) et l'est du Canada. Ces tendances semblent être générales en foresterie. Même dans les régions où l'on applique aujourd'hui des méthodes à fort coefficient de main-d'œuvre, on peut prévoir une mécanisation assez rapide à l'avenir. Les pays peu développés pourront s'inspirer des progrès réalisés dans les pays où la foresterie est plus avancée (figure 8).
Il est bien évident que les méthodes modernes, très mécanisées, d'abattage et de transport sont utiles pour les coupes rases en terrain facile. Pour les éclaircies, la mécanisation est beaucoup plus difficile. Avec les méthodes traditionnelles, le coût opérationnel des éclaircies est 2 à 4 fois plus élevé que celui de la coupe finale. Il serait donc important que la recherche forestière mette au point des méthodes sylvicoles permettant de réduire le nombre des éclaircies. Parallèlement, il serait important de chercher des méthodes d'abattage et d'exploitation économiques des éclaircies.
Le coût de l'exploitation du bois en terrain accidenté et sur les pentes abruptes avec les méthodes classiques est souvent deux à quatre fois plus élevé qu'en terrain facile. Les éclaircies et les coupes sélectives sont particulièrement coûteuses dans ce type de terrain. Il faut donc créer de nouvelles méthodes pour ces opérations: c'est là une tâche importante de la recherche forestière moderne.
Je conclurai ce bref exposé sur une note optimiste. L'accroissement constant de la demande de produits forestiers dans le monde entier est un facteur très positif. En outre, la recherche sur les forêts et les industries forestières a permis d'accumuler une masse de connaissances dont l'application fera progresser la sylviculture et l'exploitation forestière. Jamais les chercheurs n'ont disposé de plus de moyens pour s'acquitter de leur mission. Une recherche rationnelle et tenace, dont les résultats sont aussitôt mis en pratique, a l'avantage d'être à la fois le parti le moins risqué et le seul qui permette de résoudre les problèmes de foresterie moderne.
FIGURE 4. - Evolution du coût de la main-d'œuvre et des opérations mécanisées dans certains pays.
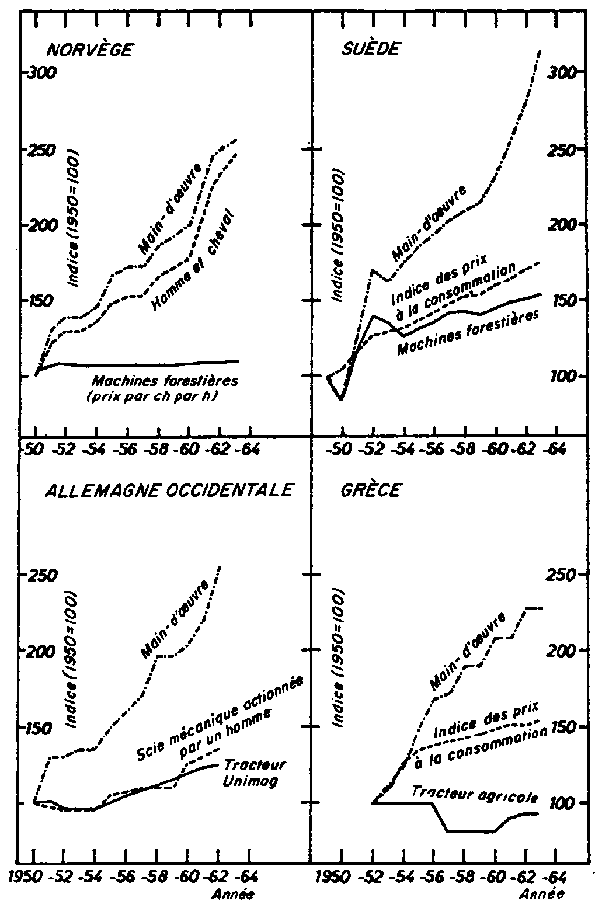
FIGURE 5. - Accroissement du coût de la main-d'œuvre dans certains pays.

FIGURE 6. - Loi de l'évolution discontinue.

|
Stade I. |
Pression économique. Avec les méthodes classiques, le coût unitaire de la main-d'oeuvre s'accroît plus rapidement que la productivité. |
|
Stade II. |
Développement. Le coût de la main-d'œuvre est désormais trop élevé pour la productivité des méthodes classiques. La pression économique détermine une activité expérimentale intensive en vue de mettre au point de nouvelles méthodes. |
|
Stade III. |
Introduction. Lorsque la nouvelle méthode a fait ses preuves, elle est introduite dans les opérations commerciales. Le prix: par homme/jour augmente parce que la main-d'œuvre doit utiliser un équipement coûteux. |
|
Stade IV. |
Stabilisation. La nouvelle méthode est désormais appliquée, mais certains progrès sont encore nécessaires, par exemple en matière d'organisation du travail et d'application à la foresterie. On observe une légère augmentation de la productivité. Avec le temps, les ouvriers demandent des salaires plus élevés, d'un côté parce qu'ils veulent participer aux profits dus à la rationalisation et de l'autre parce qu'ils doivent avoir des qualifications plus poussées pour appliquer les nouvelles méthodes. |
On admet que l'investissement dans la recherche forestière représente environ 0,5 pour cent de la valeur de la production, alors que dans certaines industries, telles que les industries chimiques ou métallurgiques, de 3 à 5 pour cent de la valeur de la production sont investis dans la recherche et le développement. Espérons que la recherche forestière disposera à l'avenir de fonds suffisants pour accomplir sa tâche.
Certaines méthodes sylvicoles et pratiques forestières envisagées s'inspirent de recherches très anciennes, datant d'une époque où les conditions opérationnelles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. A notre époque, il est nécessaire d'appliquer des méthodes industrielles souvent incompatibles avec la foresterie classique. Il faut chercher des compromis pour tenir compte à la fois des résultats de la recherche biologique, de la recherche technique et de la recherche économique. Plus que jamais, la liaison entre les diverses disciplines forestières, ainsi qu'entre celles-ci et d'autres branches, est indispensable.
A l'échelle mondiale, l'Union internationale des instituts de recherches forestières est l'organisme qui offre aux chercheurs de diverses spécialisations forestières et de diverses formations la possibilité de se rencontrer pour procéder à des confrontations d'expériences. A l'occasion du congrès on observe aussi d'excellents exemples de coopération directe. Ainsi, les problèmes que posent les éclaircies seront discutés par des savants des diverses sections. Il en va de même de la question de la résistance génétique aux maladies forestières, de la morphologie du bois considérée sous l'aspect génétique et sous l'aspect technologique, ainsi que des problèmes de la productivité de la main-d'œuvre.
FIGURE 7. - Rapport entre l'accroissement des coûts et celui de la productivité dans l'exploitation forestière en Norvège.

|
Méthode I. |
Tronçonnage et ébranchage à la main sur le lieu d'abattage. |
|
Méthode III. |
Débardage d'arbres entiers avec tracteurs articulés. |
|
Méthode IV. |
Débardage d'arbres entiers et tronçonnage, ébranchage, etc., mécanisés. |
FIGURE 8. - Même dans les régions où l'on applique aujourd'hui des méthodes à fort coefficient de main-d'œuvre, on peut prévoir une mécanisation assez rapide des opérations forestières. Les pays relativement peu développés s'inspireront des progrès réalisés dans les pays plus développés.

Dans le monde entier, la foresterie attend beaucoup de la recherche forestière. Les résultats doivent donc être formulés de façon à être facilement applicables dans la pratique forestière.
C'est le privilège du savant que d'être libre de toute influence extérieure. Toutefois, en raison des contingences économiques, la recherche forestière, même la recherche pure, devrait de préférence viser toujours à une application possible dans la pratique.
La foresterie moderne tend à l'industrialisation complète des opérations. Cette évolution est la condition d'une foresterie prospère: il y a là, dans toutes les disciplines biologie, technologie, technique et économie - à la fois une responsabilité et un défi pour la recherche forestière de demain.
Références
|
BRANTSEG, A. |
Kan vi øke produksjonen av nyttbart virke gjennom shogbehandlingen? [Pouvons-nous augmenter la production de bois par le traitement des forêts?] Norsk Skogindustri 8: p. 271-281. |
|
THIESMEYER, L. R. |
Quelques nouveautés techniques dans les domaines forestier et industriel. Unasylva 20 (4): p. 12-16. |
|
ZOBEL, B. J. |
Eleventh annual report. Raleigh, North Carolina State Industry Cooperative Tree Improvement Program, School of Forestry, North Carolina State University. 42 p. |
COMITÉ FAO/IUFRO DE LA BIBLIOGRAPHIE, ET DE LA TERMINOLOGIE
Lors de sa seizième session (Munich, République fédérale d'Allemagne, 5-6 septembre 1967), le Comité a convenu d'apporter l'amendement suivant à la Classification décimale d'Oxford pour la foresterie.
AMENDEMENT N° 6 CDO
|
181 |
.2 |
Ajouter entre parenthèses [se référer de préférence, si possible, aux subdivisions de 4; en ce qui concerne l'influence de la pollution du milieu voir 181.45]. |
|
181 |
.21 |
Ajouter les subdivisions suivantes: |
|
|
.211 |
Exigences et tolérance vis-à-vis de la lumière en général |
|
|
.212 |
Exigences et tolérance saisonnières vis-à-vis de la lumière; comportement photopériodique |
|
|
.213 |
Effets sur la lumière du milieu environnant |
|
|
.219 |
Divers |
|
181 |
.22 |
Ajouter les subdivisions suivantes: |
|
|
.221 |
Exigences et tolérance vis-à-vis de la température en général |
|
|
.221.1 |
Réaction vis-à-vis du froid |
|
|
.221.2 |
Réaction vis-à-vis de la chaleur [réaction vis-à-vis de la sécheresse voir 181.31, réaction vis-à-vis du feu voir 181.43] |
|
|
.221.9 |
Divers |
|
|
.222 |
Exigences saisonnières vis-à-vis de la température; comportement thermopériodique |
|
|
.223 |
Effets sur la température du milieu environnant |
|
|
.229 |
Divers |
|
181 |
.23 |
Au lieu de Comportement vis-à-vis du vent lire Relations avec le vent et les autres mouvements de l'air |
|
|
.231 |
Supprimer le texte et lui substituer: Tolérance vis-à-vis du vent en général |
|
Ajouter | ||
|
181 |
.232 |
Réaction vis-à-vis de certains types de vent particulier |
|
Ajouter | ||
|
181 |
.233 |
Effets sur le vent et les autres mouvements de l'air |
|
Ajouter | ||
|
181 |
.24 |
Réaction vis-à-vis des précipitations (par exemple neige, grêle) [voir aussi: Relations avec l'eau 181.31] |
|
Ajouter | ||
|
181 |
.26 |
Relations avec les phénomènes électriques (foudre, etc.) |
|
181 |
.4 |
Lire: Relations avec les facteurs biotiques, le feu et la pollution du milieu [se référer de préférence, si possible, aux subdivisions de 4] |
|
Ajouter | ||
|
181 |
.45 |
Influence de la pollution du milieu |
|
305 |
|
Corriger le texte et lire: Enchaînement des opérations et rendements. Calcul des salaires basé sur des mesures de rendement (tables de temps et de rendement, évaluation du travail). |