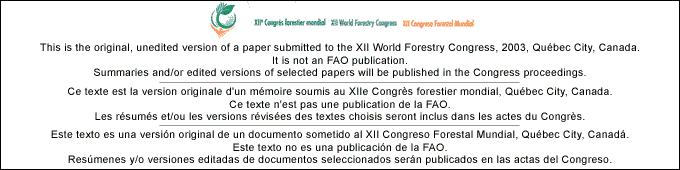
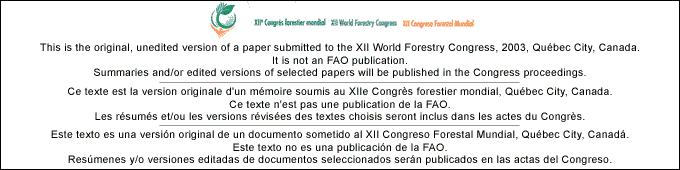
0495-A1
David MINGA MINGA 1
Le palmier à raphia, particulièrement Raphia textilis communément dénommé par les Kuba, ibwoon est ngol miteyi = aîné des plantes. Cette expression signifie que pour les Kuba, il n'y a pas de vie sans palmier à Raphia textilis.
Le Raphia textilis = ibwoon est une source de vie pour les Kuba. Il est utilisé dans son intégralité: son vin est la boisson très appréciée par ce peuple et beaucoup d'étrangers, ses feuilles fournissent des cordes qui servent à la construction et à tendre des pièges, ses branches sont aussi des matériaux de construction et son tronc, particulièrement l'intérieur donne des vers dénommés sholel qui sont des aliments très succulents et protéiniques. Des feuilles du palmier à raphia, rameaux sont extraites la précieuse fibre dénommé hiook qui est la principale matière première utilisée par les tisserands, les brodeurs et les vanniers Kuba.
La matière première hiook permet de fabriquer plusieurs _uvres d'art, ntshiaak, mahel, showa...Ces produits finis font l'objet d'un comme local, national et international et constitue la première source des revenus de ce peuple.
Les Kuba sont les habitants du territoire de Mweka, province du Kasaï-Occidental, République Démocratique du Congo. Le territoire de Mweka est limité au Nord par le territoire de Dekese, à l'Est par le territoire de Dimbelenge et Demba, à l'Ouest par le territoire de Luebo et au Sud par le territoire d'Ilebo. Sa superficie est 20.115 Km2 et sa population était de 413.508 en 1994 (Monographie du Kasaï Occidental, 1998).
La moyenne du taux d'accroissement annuel étant de 5,62%, la population du territoire de Mweka peut être estimée en 2002 à 576.221 habitants soit 28 habitants par Km2
Cette population est constituée de plusieurs ethnies: les Bushoong, les Bulaang, les Ngende, les Pyaang, les Ngongo, les Ngombe, les TShwa, les Bieeng, les Kel, les Ibaam, les Maluk, les Tshoowa, les Mbiengi, les Ding, les Kete et Tshoofa qui sont tous des Kuba.
Suivant la classification de KÖPPEN, le territoire de Mweka appartient au climat chaud et humide, AW2 (Selon KOPPEN, A=climats tropicaux humides; W2=Saison sèche dure deux mois). La température annuelle moyenne est de 23,5°C.
La végétation naturelle du territoire de Mweka est composée des forêts tropothytes, des savanes herbeuses, des savanes arbustives, des galeries forestières et des lambeaux des forêts tropophytes (Monographie du Kasaï Occ, 1998)
Le Territoire de Mweka est une contrée essentiellement à vocation agricole et artistique. L'agriculture a fait de ce territoire le grenier de la province du Kasaï Occidental.
Les Kuba cultivent des maïs, des maniocs, des aubergines, des poivriers, des tomates, des cannes à sucre, des palmiers à huile et surtout des palmiers à raphia qui sont à la base de sa civilisation et son Art en particulier. Son somptueux Art dénommé « Art Kuba » a fait que les Kuba restent jusqu'aujourd'hui fiers de leur tradition artistique.
Qu'est-ce qu'alors l'Art Kuba ?
La notion de l'Art Kuba est indissociable de l'artisanat qui vient du mot latin ars, qui signifie l'ensemble des activités manuelles.
Par artisanat, il faut entendre l'ensemble des procédés par lesquels une population transforme les matériaux que lui procure la nature pour faire des objets utiles et beaux (MVENG, 1981). L'artisanat est donc à la fois une industrie qui est un ensemble des techniques de transformation et de fabrication et un art, car un ensemble des procédés pour rendre les objets fabriqués porteurs d'un message de vie et de beauté.
Toute Société, toute organisation se caractérise par son mode de production. La production d'_uvres d'art par le peuple Kuba et d'autres peuples d'ailleurs traduit ce que le producteur pense du présent et de l'avenir. C'est donc en rapport avec la vision du monde de ce peuple.
L'Art Kuba est de ce fait la décoration, la sculpture, le tissage, la broderie et la vannerie qui est l'expression objective de la pensée du peuple Kuba.
Industrie de tissage Kuba: Mbwoong a mbaal
Il n'existe pas d'industrie de tissage sans raphia spp. Les spécialistes distinguent plusieurs sortes dont (RENIER, M, 1948) :

Raphia textilis: Espèce très utilisée par les Kuba. La fibre extraite des palmes du raphia constitue le génie intellectuel des Kuba. C'est cette dernière qui constitue le matériau de base pour fabriquer le tissu.
Métier à tisser: Mbwoong a mbaal

Mbwoong a mbal signifie tout simplement une unité de production traditionnelle à partir de laquelle on obtient les tissus dénommés mbaal ou ntwoong
L'industrie Mbwoong a baal est composée des éléments immobiles et mobiles.
Les éléments immobiles sont des objets qu'on ne déplace pas après la fabrication du tissu mbaal ou ntwoong. Ce sont:Ikwook i nwiin, ikwook i ngady, nwiim a kéem, ngady a keem, latwoong'd, et makwootsh.
Les éléments mobiles sont des objets qu'on déplace après tissage. C'est cet ensemble de biens qui ont servi à la fabrication des mbaal ou ntwoong hormis les éléments immobiles qu'on dénomme biong'l. Ces objets sont: Kwey a mbaal, sheek, mikukuun, twoong, ngwootsh a mbaal, lahwaah, mashel, ngieng'd ou nkaang'l, shiim et mwaan.
Les éléments mobiles et immobiles mis ensemble permettent d'obtenir les tissusntwoong et mbaal. Le produit fini obtenu de l'industrie culturelle Kuba est dénommée mbaal a nkani. Dès qu'il est préparé pour la fabrication du costume et autres habits, il est ilaam.
* Eléments immobiles
* Eléments mobiles
Il est à noter qu'il existe deux façons de monter le métier à tisser:
Les travaux des raphias se font dans un atelier. Cet atelier est dénommé," atelier du couturier" qui est un endroit aménagé pour coudre les tissus à raphia. L'outillage utilisé dans l'atelier du couturier est:
De l'atelier du couturier, on obtient les produits finis suivants: ntshiak minen, ntshion itet, ishoh, mash a mash, bwiin, ishen, ntshiak a kot, ishweeh, kumishing, ndwoon a kwey, mtween, kumingwoong, nshwih mahel, ikwik misheng, shoowa etc. Ce dernier fait l'objet d'un commerce international très développé mais il n'est pas repris parmi les produits forestiers non ligneux congolais destinés à l'exportation. Nos études ultérieures porteront sur la filière du raphia spp en République Démocratique du Congo. Ce qui nous permettra d'avoir beaucoup d'informations sur la commercialisation des produits de l'Art Kuba.
L'Art Kuba est le génie intellectuel de ce peuple. G.D Périer disait ceci à propos de cet art: « la région de l'Entre -Sankuru - Kasaï (région des Kuba) compte à coup sûr les meilleurs artistes et artisans du continent noir. Leur intelligence esthétique égale, entre autres dans l'art du fer, des ferronniers du Bénin. Comme tisserands, brodeurs, sculpteurs en bois, aucune autre peuplade ne les surpasse (BOKONGA, 1975).
L'Art Kuba est tellement riche que beaucoup de chercheurs le compare à celui de baoulé de la Côte d'Ivoire et au style bénin du Nigeria.
Tout ceci a fait que cet Art puisse jouer un rôle socio-économique non négligeable pour ce peuple. En effet, nous l'avons déjà dit que la civilisation des Kuba est inséparable du palmier à raphia. Le palmier à raphia est utilisé dans son intégralité: Son vin est la boisson très appréciée par ce peuple, ses feuilles fournissent des cordes qui servent à la construction et à tendre des pièges, ses branches sont aussi des matériaux de construction et son tronc, particulièrement l'intérieur donne des vers dénommés, sholel et des coléoptères qui sont des aliments pour les populations.
Des feuilles du palmier à raphia (rameaux) sont extraites la précieuse fibre dénommée, hiook qui est la principale matière première utilisée par les tisserands, les brodeurs et les vanniers Kuba. Cette matière première permet de fabriquer plusieurs _uvres d'art, ntshiak, mahel, shoowa, et autres qui sont aujourd'hui une source permanente des revenus pour les Kuba.
Les velours Kuba que d'aucuns dénomment « velours du Kasaï » jouent un rôle culturel et esthétique indéniable. Ils sont d'une telle beauté que l'éminent conservateur français Henri Clouzot écrivit à ce sujet: « Dès le premier coup d'_il, l'étonnante originalité et l'incroyable variété de ces broderies indigènes me donnèrent ce que les vieux fureteurs appellent le choc » (BOKONGA, 1975)
Les champs des forêts dénommés par les Kuba, « ngwoon » sont cultivés en défrichant et en abattant les arbres. Après avoir brûlé les champs, on y plante généralement les maïs, les maniocs, les haricots, etc.
Les maniocs sont toujours récoltés en dernière position et puis vient la période de jachère. Pendant ce temps, l'on plante des palmiers à raphia, des cannes à sucre et autres.
Etant donné que la culture des palmiers à raphia ne donne la première fibre qu' à la huitième année, la forêt en jachère se reconstitue jusqu'à ce qu'on aura des plantes qui peuvent donner du vin, des larves et des coléoptères. Ceci ramène la jachère aux environs de la quinzième année.
La culture des palmiers à raphia est chez le peuple Kuba un problème des familles et des clans. Il existe des plantations familiales et claniques, ishesh i mabwoon.
Cette pratique qui consiste à posséder des champs des palmiers à raphia permet une jachère généralisée et une conservation de la forêt. En effet, durant la période d'attente de la fibre, du vin, des larves aucune culture n'est admise en dehors de la chasse et des pièges que l'on peut tendre pour attraper des animaux.
Le tissage et la couture des objets à base du raphia prennent beaucoup de temps. Les tisserands et couturiers font par conséquent moins de travaux des champs. Ce qui a un impact positif sur l'environnement.
Il y a quelques années, dans la capitale Nshyeeng, les habitants faisaient rarement les travaux des champs. Ils ne vivaient que du raphia et de l'aiguille, c'est-à-dire de la couture faite avec l'aiguille et de la fibre du raphia. Ceci montre que l'Art Kuba qui est une source des revenus est aussi un moyen de préservation de l'environnement, plus particulièrement de la forêt.
Kroeber et Kluchohn dressa en 1952 l'inventaire des multiples manières d'utiliser le terme culture, dirent que ce sont les coutumes, les croyances, la langue, les idées, les goûts esthétiques et la connaissance technique que l'organisation de l'environnement total de l'homme, c'est-à-dire culture matérielle, des outils, l'habitat, et plus généralement tout l'ensemble technologique transmissible régulant les rapports et les comportements d'un groupe social avec l'environnement (Encyclopaedia Universalis, 1988)
Les coutumes, les idées et croyances peuvent dès lors être à la base de la préservation de la nature. La sculpture de l'Art africain par exemple, a toujours une prépondérance spirituelle que matérielle. Celle-ci véhicule certains messages qui ont un apport significatif sur la conservation de l'environnement.
Il existe plusieurs rites, mythes, chansons et interdits qui accompagnent certains objets d'art qui permettent la protection de la nature. Nos études ultérieures essayeront d'aborder aussi cet aspect des choses qui est très important pour la sauvegarde de l'environnement.
D'ailleurs Kabengele Munanga, qui a étudié la fonction de l'art plastique chez les Baluba n'a-t-il pas écrit « des masques représentant les âmes des morts et des aïeux figurent encore aux fêtes de la puberté des jeunes gens, à des cérémonies funèbres des sociétés secrètes, aux cérémonies d'initiations et aux rites des confréries médicales» (KABENGELE M. cité par BOKONGA, 1975).
Notre communication porte sur la contribution de l'Art Africain et Kuba en particulier sur la préservation de l'Environnement.
Nous venons de montrer que l'Art en tant que composante de la culture ne relève pas seulement du beau mais est une source des revenus et un moyen efficace pour préserver la forêt et l'environnement en général.
L'Art traduit la pensée d'un peuple, la vision qu'a ce peuple vis-à-vis du monde. L'Art est par ce fait un élément de développement. Car dans le monde, l'on est optimiste que la prise en compte des savoirs endogènes serait un atout pour le développement.
Aujourd'hui que les Nations du monde cherchent des solutions pour protéger l'environnement, l'Art peut à travers - les croyances, les coutumes, les idées, les mythes, les rites, les chansons et les interdits - être une des stratégies car les savoirs endogènes peuvent agir durablement sur la préservation de la nature.
C'est à ce titre que nous demandons à ce qu'il soit revalorisée la fonction culturelle dans les projets de développement et de protection de l'environnement.
1.BOKONGA Ekanga Botombele.1975.La politique culturelle en République Démocratique du Congo (ZaÏre). Paris: presses de l'Unesco. 120p.
2. CENTRE D'ETUDES DES RELIGIONS AFRICAINES.1981. Art Religieux Africain.
Kinshasa: FCK: SAINT PAUL.vol. 16 n°31-32. 330p.
3.CORNET, J. 1982. Art royal Kuba . Bruxelles: Edizioni. 336p.
4.ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS. 1988. Paris: Encyclopaedia Universalis. 1197p.
5.FAIK-Nzuzi Madiya, cl. 1992. Symboles graphiques en Afrique noire. Paris, Bruxelles: Karthala. 190p. 11
6.KABALA Matuka et al. 1993. La Forêt Tropicale Africaine:Patrimoine à préserver d'urgence. UNESCO. 362p.
7. Ki-ZERBO, j . 1978. Histoire de l'Afrique: D'hier à demain. Paris: Hâtier. XXXI- 711p.
8.LEMA GWETE. 1986. L'Art et le pouvoir dans les sociétés traditionnelles . Kinshasa: PNUD, UNESCO, IMNZ, 127 p
9.MALDAGUE, M et al. 1997. Notions d'aménagement et de développement intégrés des forêts tropicales. Paris: UNESCO: ERAIFT: MAB. 378
10.MINISTERE DE L'AGRICULTURE et al. 1998. Monographie de la province du Kasaï- Occidental. Kinshasa: PNRSAR. 314p.
11.MINGA Minga, D. 1996 . Les Fonctions documentaires des _uvres artistiques du Muyum des Kuba . Kinshasa: UPC . 65p
12.MUDIJI MULAMBA BILOMBE. 1989. Le Langage des masques africains: Etude des formes et fonctions symboliques des Mbuya des Phende. Kinshasa: FCK. 287p.
13.MVENG, E . 1980. L'Art et l'artisanat. Yaoundé: Ed-Clé. 163p.
14.MVENG,E. 1981. L'Art et l'Afrique noire: Liturgie cosmique et langage religieux . Yaoundé Ed - clé .158p.
15.RENIER, M. 1948. Flore du Kwango: Cryptogames vasculaires -Gymnospermes Monocotyllées - Dicotylées apétales, tome, 185p.
16.VANSINA, J. 1964. Le Royaume Kuba. Bruxelles: Tervuren. 196p.
17.VANSINA, J. 1954. Les Tribus Bakuba et les peuplades apparentées. Belgique: Tervuren. 64p
1 Spécialiste en Gestion de l'Environnement
Doctorant inscrit à l'Université Laval *
Etudiant à l'Ecole Régionale Post-Universitaire d'Aménagement Intégré des Forêts et Territoires Tropicaux,
ERAIFT / UNIVERSITE DE KINSHASA
Email: [email protected]
B.P.: 10788 KINSHASA I
R.D. CONGO