par ARTHUR W. SAMPSON, Professeur Emeritus de sylviculture, et ARNOLD M. SCHULTZ, «Associate Specialist», Ecole forestière, Université de Californie, Berkeley
Cet article représente la troisième partie d'un travail préparé à la demande de la FAO. Les première et deuxième parties ont paru dans Unasylva, Vol. 10, N°s 1 et 3. La dernière partie paraîtra dans le Vol. 11. N° 1.
L'ensemble des articles sera ensuite publié sous forme de fascicule.
L'INCINÉRATION contrôlée est l'utilisation délibérée et bien délimitée du feu sur une superficie déterminée généralement inculte. L'incinération proprement dite peut revêtir des aspects différents, allant des feux réglementés qui nécessitent des conditions atmosphériques et de combustibilité bien définies pour atteindre le but recherché, aux» feux de convenance» pour lesquels les seuls éléments déterminés au préalable sont l'époque et l'emplacement du feu (34)¹.
(¹ Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux ouvrages cités dans la bibliographie, voir Unasylva, Vol. 10, N° 1, pp. 28-29.)
En règle générale, le feu se développe mieux et détruit le maximum de plantes si la température est élevée, le degré hygrométrique bas, et si l'air est un peu en mouvement. Dans de telles circonstances, les risques sont grands et le contrôle du feu est difficile. Le but de l'incinération contrôlée est d'obtenir une incinération aussi efficace que possible dans les conditions les plus sûres.
Les points à étudier dans cette méthode de lutte contre la broussaille sont la détermination des limites de la superficie à incinérer, l'aménagement des lignes de défense, la préparation du combustible et la conduite du feu.
Détermination de l'emplacement et aménagement des lignes de défense
La superficie à incinérer doit être entourée d'obstacles à la propagation du feu, naturels ou artificiellement aménagés. Ils servent, à la fois, de base à partir de laquelle est faite la mise à feu et d'obstacles à son extension incontrôlée. Si la chose est possible, les obstacles naturels doivent être utilisés comme lignes de défense; ils sont souvent plus larges et plus efficaces, et la seule sujétion qu'ils entraînent est de mettre à feu une superficie un peu plus grande ou au contraire de diminuer quelque peu celle-ci. On peut distinguer les obstacles physiques (surfaces récemment brûlées, cours d'eau ou routes, bancs rocheux), topographiques (ligne de crêtes, larges fonds de ravins) et les obstacles constitués par une végétation résistante au feu (végétation clairsemée, herbe verte, broussailles spontanées croissant sur les pentes à l'exposition nord). La plus sûre des lignes de défense est constituée par une combinaison de ces éléments, comme par exemple une route traversant une pelouse verte près d'une ligné de crêtes (4).
Pour la création des lignes de contrôle artificielles, il est nécessaire de tenir compte de la topographie et du caractère de combustibilité de manière à pouvoir arrêter les feux de surface, les feux de cime et les feux à foyers dispersés. On arrête les feux de surface en rompant la continuité du combustible existant à la surface du sol. Il n'est pas nécessaire que la ligne soit large, mais elle doit être décapée jusqu'au sol minéral. Une bonne règle à adopter est d'aménager la ligne de telle sorte que sa largeur soit au moins égale à la hauteur des végétaux combustibles qui lui sont adjacents. Il en résulte que, dans l'herbe, il n'est pas nécessaire que les lignes garde-feu soient aussi larges que dans de hautes broussailles denses. Lorsque les conditions favorables se trouvent réunies pour l'exécution d'une incinération prescrite en forêt, il suffit de faire une ligne étroite dans le tapis d'aiguilles avec un rateau à main. Cela signifie que, pour que l'aménagement des lignes entraîne une dépense aussi réduite que possible, il convient de reculer les limites du feu contrôlé jusqu'à un terrain enherbé ou cultivé en bordure de la broussaille, ou de les porter sous des arbres sous le couvert desquels n'existe pas d'épaisse couverture morte ou de broussaille.
On arrêtera les feux de cimes en créant un large espace dans la broussaille ou dans la strate formée par les cimes des arbres. La largeur de cet espace dépend de la quantité de chaleur existant à la pointe du feu, de la direction et de la violence du vent soufflant vers la ligne et de l'inflammabilité de la matière combustible en deçà de la ligne.
Il est difficile d'arrêter les feux à foyers dispersés, mais on peut les vaincre en évitant de laisser sur pied, près de la ligne, des broussailles et des arbres qui projettent haut dans l'air des feuilles enflammées, et en créant les lignes garde-feu là où les mouvements de l'air peuvent être prévus avec le plus d'exactitude.
La superficie à incinérer doit toujours être située sur une pente au-dessus de la ligne de défense (fig. 40). Celle-ci ne doit jamais être aménagée à flanc de coteau ou sur les lignes de crêtes; il est préférable de les disposer immédiatement au-delà de la crête, sur le versant opposé à celui où se développe le feu.
L'emplacement de la ligne de défense doit être choisi de telle sorte que la mise à feu soit facile. La facilité d'allumage ou de mise à feu est inversement proportionnelle à la taille, au taux d'humidité et à la faible densité de la matière combustible, et directement proportionnelle à la vitesse du vent, à la température de l'air, à la sécheresse et à la raideur de la pente. L'élément le plus important pour qu'une ligne de mise à feu soit bonne, est la présence d'un combustible léger, sec et continu sur une certaine profondeur dans l'enceinte et se poursuivant dans la broussaille qui doit être incinérée. La mise à feu peut y être faite rapidement; il y a peu de chaleur dans la partie la plus proche de la ligne, et pour une section quelconque de celle-ci il n'est pas nécessaire de s'attarder longtemps. Citons parmi les combustibles remplissant les conditions ci-dessus définies, l'herbe sèche, les débris de feuilles, les aiguilles de pins et la broussaille légère qui a été broyée par un bulldozer.
L'outillage mécanique qui peut être utilisé pour l'aménagement des lignes a déjà été décrit. Dans les broussailles épaisses ou pour les arbres sensibles au feu on utilise le bulldozer pour faire un chemin suffisamment large répondant aux conditions de sécurité requises. On pousse les tiges brisées à l'intérieur de l'enceinte mais jamais à l'extérieur. Si un temps très long doit s'écouler entre l'époque à laquelle est aménagée la ligne de défense et celle de l'incinération contrôlée, il vaut mieux placer les éléments végétaux arrachés par le bulldozer loin dans la broussaille à des intervalles réguliers tout au long du périmètre. Le bois pourri, par exemple les nids de rats du genre américain Neotoma et les grumes avariées, doit aussi être poussé loin dans l'enceinte. Les grands chandeliers doivent être renversés au bulldozer parce qu'ils sont longs à brûler et projettent des étincelles à de grandes distances. Si le fourré n'est pas trop dense, une bande de la largeur d'une ou deux passes de bulldozer peut être broyée immédiatement à l'intérieur de la ligne de défense pour faciliter la mise à feu.
Lorsque les lignes de défense sont tracées dans une pelouse, on utilise une charrue à disques pour constituer un obstacle de sol minéral. Cette opération peut être réalisée lorsque l'herbe est verte ou lorsque le sol a une humidité suffisante pour pouvoir être travaillé aisément. Le même résultat peut être obtenu en décapant l'herbe avec un bulldozer ou un grader. Souvent, une ligne convenable peut être faite à la pelle ou avec une houe.
Dans les aiguilles de pins, l'utilisation d'un râteau ou de l'outil spécialement conçu pour le feu par McLeod, qui est une combinaison de la houe et du râteau, constitue la solution la meilleure. Les aiguilles de pins et l'humus brut doivent être enlevés jusqu'au sol minéral et entassés ou répandus à l'intérieur de la ligne (du côté à incinérer). Le même outil peut ensuite être utilisé pour l'allumage du feu, en râtelant une certaine quantité d'aiguilles enflammées.
Pour préparer les lignes garde-feu, on peut également combiner les méthodes mécaniques ou chimiques avec la pré-incinération. Une bande de broussailles est écrasée au bulldozer ou arrosée avec un produit desséchant à action rapide. Lorsque le taux d'humidité de la matière combustible est descendu suffisamment bas, on peut mettre à feu cette bande avec un minimum de risques d'incendier la broussaille verte, non traitée, adjacente à la bande (fig. 41). La pré-incinération est également utilisée pour constituer de larges lignes au travers de l'herbe; la mise à feu doit être faite tard le soir, lorsque l'humidité est suffisamment élevée pour garantir une incinération sans danger. La pré-incinération consume le combustible fin, sec, dans le but d'écarter tout risque ultérieur, mais le feu peut ne pas être suffisamment actif pour tuer la broussaille.
Allumage et conduite du feu
Il est nécessaire d'apporter beaucoup de soin et de patience pour la mise à feu à partir du périmètre de la superficie à incinérer par le procédé classique. Etant donné que l'opération doit se dérouler avec lenteur, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des procédés rapides ou compliqués pour la mise à feu. Quelques méthodes simples vont être brièvement décrites.
Il n'est évidemment pas nécessaire de disposer d'un équipement spécial si l'on se contente de mettre le feu en jetant des allumettes enflammées dans la matière combustible sèche le long de la ligne de défense. Toutefois il est bon et commode de disposer de l'outil loger de McLeod; cet instrument peut être nécessaire en cas de feu à foyers espacés ou si le feu saute la ligne. Il peut être utilisé pour étendre le feu en poussant lentement dans l'herbe une touffe de combustible enflammé. On peut traîner dans l'herbe sèche un vieux pneu partiellement rempli d'huile de moteur enflammée. Une torche laissant tomber goutte à goutte une matière enflammée produit le même effet. Elle est constituée par un bidon d'un gallon (environ 5 litres) contenant du gas-oil et muni d'une mèche fixée à l'extrémité d'un long tuyau. La mèche imprégnée d'huile est allumée et quand le bidon est retourné l'huile s'écoule goutte à goutté en traversant la mèche et tombe enflammée sur la matière combustible (fig. 42). Si ces méthodes rustiques peuvent rendre des services dans l'herbe sèche et dans les aiguilles de pins, elles ne donnent pas satisfaction si la végétation à brûler n'est ni basse ni compacte, comme c'est le cas pour une broussaille dense et en place. Il faut alors disposer d'un lance-flammes portatif de manière à élever suffisamment la température pour enflammer les tiges éparses (fig. 43). Le lance-flammes, comme la torche laissant tomber goutte à goutte la matière enflammée, consomme du gas-oil. Celui-ci est contenu dans un réservoir sous haute pression et peut être éjecté sous forme d'une flamme chaude de 20 feet (6 mètres) ou plus. L'huile s'enflamme en passant par un ajutage placé au-dessus d'une mèche allumée.
Trois méthodes fondamentales de mise à feu ont été utilisées. La plus simple et la plus courante est la mise à feu en lisière (fig. 44 gauche). On allume les feux le long des lignes de défense et ceux-ci sont dirigés vers le centre. Ce moyen est le plus sûr, en particulier pour les broussailles denses où il n'existe pas de piste de dégagement vers la ligne de défense. La superficie entière doit être située de telle manière que les courants d'air se dirigent vers son centre lorsque la mise à feu est faite le long du périmètre. Il est nécessaire de disposer d'une manière uniforme et continue de suffisamment de combustible sec pour conduire le feu vers toutes les plantes indésirables. La superficie doit être suffisamment petite ou suffisamment concentrée pour être incinérée dans la courte période de la journée où température, humidité et vent sont sensiblement constants.
Dans la mise à feu à partir du centre, les premiers feux sont allumés au milieu de l'enceinte et on ne les laisse s'étendre que lorsque la chaleur dégagée est très importante (fig. 44 centre). Alors d'autres feux sont allumés près du périmètre. Ceux-ci sont attirés vers le centre par un courant d'air, générateur de vents allant jusqu'à 10 miles (16 km) à l'heure à partir de tous les côtés. Les feux de centre eux-mêmes se stabilisent et s'étendent rarement vers la lisière. L'utilisation de cette méthode se limite aux petites superficies de terrain plat et lorsqu'il n'y a pas de vent.
La mise à feu par bandes peut être utilisée sur les pentes et là où les vents dominants obligent le feu à ne se développer que dans une seule direction. Tout d'abord on incinère une bande étroite en allumant à flanc de coteau une série de feux en lignes un peu en-dessous de la limite et sous le vent de la surface à incinérer (fig. 44 droite). Quand ce feu est éteint, on allume une nouvelle bande à flanc de coteau à environ 100 feet (30 mètres) en-dessous de la première. On peut en toute sécurité augmenter la largeur de chaque bande successive puisque le pare-feu précédent est toujours plus large. Cette méthode est intéressante là où la mise à feu de lisière serait difficile à réaliser, et là où une incinération rapide risquerait de sauter en retour la ligne de défense.
Les méthodes classiques d'incinération qui viennent d'être décrites concernent des feux «en plein» (fig. 45). La réussite de tels feux est inégale. Généralement une incinération contrôlée est préparée longtemps à l'avance pour une date donnée. On a alors procédé à l'aménagement des lignes de défense, une équipe d'hommes a été amenée à pied d'œuvre (fig. 46), et le pâturage a été suspendu de façon à pouvoir disposer d'une plus grande quantité d'herbe combustible nécessaire à la propagation du feu. De légers changements dans les conditions atmosphériques, trop subtils pour justifier un ajournement de l'incinération pour le jour choisi, peuvent avoir pour effet de ne permettre que l'incinération de l'herbe, entraînant par là la perte de toute une année d'efforts. De nouvelles tendances se sont fait jour prévoyant le broyage mécanique des broussailles une année à l'avance, de telle sorte que les tiges et les feuilles soient sèches et tassées sur le sol, l'herbe ayant cru au travers des branches mortes. De cette manière, même par un jour relativement frais, le feu peut consumer la plus grande partie de ce combustible. Cette combinaison d'un traitement mécanique et du feu est efficace en maintes circonstances.
On a constaté que pour que l'incinération soit complète, il n'était pas nécessaire d'écraser toute la broussaille. On peut passer le bulldozer dans la broussaille en combinant plusieurs techniques différentes, en faisant alterner une bande travaillée avec une bande non travaillée, de telle sorte que la moitié ou le tiers seulement de la superficie soit écrasée, ce qui diminue proportionnellement le coût de l'opération.
Une quatrième méthode d'incinération, appelée» mise à feu sur toute la surface» peut être utilisée pour incinérer des broussailles. Dans ce cas, la superficie à traiter est préparée après que les andains broyés au bulldozer se soient desséchés. Cette méthode comporte la création d'un grand nombre de feux individuels sur une superficie donnée dans un court laps de temps (4). L'intervalle entre les feux est si réduit que la chaleur se dégageant de l'un accélère la combustion de l'autre, et la matière combustible des intervalles est desséchée et chauffée de telle sorte qu'elle brûle plus rapidement. Les différentes flammes s'unissent pour former une colonne de feu créant un courant ascendant d'air chaud qui empêche le feu de courir. En pratique les opérations sont conduites par une équipe d'hommes (fig. 47) dont chacun est équipé d'une torche laissant tomber goutte à goutte la matière enflammée, qui allument les feux en parcourant rapidement les bandes parallèles de broussailles écrasées. Ils doivent s'efforcer de se maintenir de front pour ne pas mettre en difficulté l'un d'entre eux qui resterait en arrière. Si l'équipe travaille à raison de 2 ou 3 miles à l'heure (3,2 à 4,8 km/h) et si le combustible est à un taux d'humidité convenable, la broussaille pourra être mise à feu à la vitesse requise pour obtenir une incinération efficace et sans danger. On peut agir sur l'intensité du feu en augmentant ou en diminuant la cadence de la mise à feu.
La chaleur engendrée par la combustion est suffisamment intense pour consumer la broussaille verte sur pied entre les bandes écrasées. C'est pendant les mois de printemps que la méthode peut être utilisée avec le minimum de risques lorsque le bois est humide et difficile à enflammer (fig. 48). Elle peut également être utilisée pour incinérer les larges lignes de défense créées en vue d'une incinération classique conduite dans toutes les directions.
Equipements spéciaux pour la mise à feu
Un nouveau champ de recherches s'est ouvert avec l'application de la pyrotechnie à l'incinération contrôlée. Un certain nombre de dispositifs ont été expérimentés pour la mise à feu, mais jusqu'à maintenant il y a peu à dire sur les avantages d'une méthode ou de l'autre, sur leur efficacité respective ou sur leur coût respectif.
Certaines techniques utilisent différentes grenades qui peuvent être jetées à la main, tirées à l'aide d'un fusil, larguées d'avion, ou placées sur le sol dans des endroits bien définis et commandées par des circuits électriques ou par une mèche rapide (fig. 49). Une des méthodes qui a été expérimentée dans le «chaparral» californien consiste à disposer des grenades à des espacements de 50 ou 100 feet (15 à 30 mètres); les grenades sont placées dans des tas de matières combustibles constituées de broussailles coupées et empilées qui sont enflammés simultanément. De bons résultats sont obtenus par une autre méthode dans laquelle les grenades sont larguées d'un avion volant lentement (90 miles à l'heure, soit 144 km/h) à une altitude de 500 feet environ (150 mètres). Quand sur le sol existe un combustible compact et continu, constitué, par exemple, d'herbe sèche, des grenades, petites ou grosses, individuelles ou réunies en chapelet, sont également efficaces pour la mise à feu.
L'intérêt des techniques utilisant la pyrotechnie est qu'elles permettent l'incinération de larges bandes de broussaille qui sont pratiquement inaccessibles à pied et de ce fait interdisent l'emploi de lance-flammes ou autres outillages classiques. Ceci peut être le cas pour des territoires au relief accidenté ou pour la partie centrale des incinérations contrôlées dont la mise à feu a été faite sur le périmètre. Lorsque les grenades sont disposées à l'avance et commandées par une longue mèche, on ne risque pas que les hommes soient cernés par le feu. La mise à feu simultanée produit les mêmes effets que dans l'aire de mise à feu si les grenades sont disposées de façon convenable. C'est pourquoi cette méthode peut être utilisée avec efficacité pour l'incinération d'hiver ou de printemps réalisée pour l'entretien des lignes de chasse ou pour la création de larges lignes de défense.
Incinération réglementée en forêt
L'incinération réglementée a été définie comme l'utilisation délibérée et bien délimitée du feu sur une superficie déterminée dans un but bien défini. Les principaux buts que l'on cherche à atteindre en forêt sont les suivants:
1. réduire les risques d'incendie en éliminant les rémanents de broussailles et de bois;2. éviter l'extension d'espèces indésirables dans le sous-étage;
3. réduire la période de croissance lente dans les peuplements où existe une régénération dense;
4. préparer un lit de cendres favorable à la régénération naturelle des essences précieuses;
5. réduire le volume de la couverture morte en excédent et la végétation qui arrêtent la pluie, ce qui nuit à la croissance des arbres et à l'approvisionnement en eau du sol;
6. réduire l'étendue des dégâts cryptogamiques et des attaques d'insectes;
7. améliorer les terrains de parcours à la disposition du bétail; et
8. améliorer les conditions de vie du gibier et faciliter la chasse.
Aucun outillage spécial n'est nécessaire par de telles incinérations. Les éléments essentiels requis sont des conditions atmosphériques et le combustible favorables. Bien que la technique puisse varier suivant le lieu, il convient de retenir les principes énumérés ci-dessous. Lorsque le taux d'humidité est bas et la température élevée, le feu peut détruire n'importe quel arbre. Les conditions les plus sûres sont réunies lorsque l'incinération a lieu en saison humide ou froide, lorsque le combustible est sec et les arbres en repos hivernal. De nombreux arbustes ou arbres feuillus ont une écorce fine et sont facilement tués par les feux légers; par contre nombreux sont les arbres parmi ceux qui ont le plus de valeur pour la production de bois d'œuvre qui sont remarquablement résistants au feu; citons à titre d'exemples Pinus palustris, caribaea et taeda «pins» longleaf», «slash» et «loblolly» du sud-est des Etats-Unis, Pinus ponderosa et lambertiana («sugar pine» de l'ouest des Etats-Unis. Les espèces résistantes au feu sont généralement dominantes dans les groupements végétaux sub-climaciques qui se sont développés dans un milieu où les incendies se produisaient naturellement et fréquemment (43).
Le combustible utilisé pour enflammer les broussailles et débris végétaux peut être de l'herbe, comme dans le sud-est des Etats-Unis, ou des aiguilles de conifères. Le feu doit être contenu près du sol en toutes circonstances et une préparation spéciale de la structure du combustible peut être nécessaire dans certains cas. L'incinération à flanc de coteau peut entraîner des feux de cimes. Il convient de porter une attention toute spéciale aux chandeliers, aux grumes pourries et aux arbres brogneux.
Coût de l'incinération contrôlée
Les dépenses sont variables d'un lieu à un autre. Elles dépendent du taux des salaires, de la qualité de l'équipement, de la nature de la végétation, et d'une année à l'autre elles sont fonction surtout des progrès réalisés dans les techniques utilisées qui tendent à créer un compromis convenable entre les mesures de sécurité et l'efficacité des incinérations. Les chiffres les plus valables sur le coût des incinérations proviennent de Californie où l'incinération de terrains broussailleux sur autorisation a été rendue légale en 1945 et où les recherches et la technique ont fait de grands progrès depuis lors.
Les dépenses entraînées pour l'incinération sur autorisation se composent de deux éléments: les dépenses supportées par le bénéficiaire de l'autorisation ou le propriétaire, et les dépenses à la charge de l'Etat, ou du gouvernement local (34). A titre d'illustration de ces dépenses on peut citer les exemples suivants:
|
Dépenses à la charge du bénéficiaire de l'autorisation |
Dépenses à la charge de l'Etat |
|
1. Préparation des lignes de défense. |
1. Temps consacré par le personnel administratif chargé de donner les conseils techniques et d'assurer le contrôle. |
|
2. Autres mesures de protection. |
2. Outillage et dépenses pour le maintien sur place d'un service destiné à protéger les propriétés adjacentes. |
|
3. Travail, outillage et dépenses de nourriture à l'occasion de l'exécution de l'incinération. |
3. Temps passé par les équipes présentes sur les lieux. |
Une dépense à la charge du bénéficiaire de l'autorisation qui n'est pas prise en considération est la perte de l'herbe utilisée comme combustible, qui aurait pu être utilisée comme fourrage, et la mise à disposition consécutive de terres supplémentaires, ou l'achat de fourrage pour compenser celui qui a été perdu. Il n'est pas tenu compte non plus des dépenses suivant normalement l'incinération comme le réensemencement et la mise en place de clôtures. Les dépenses à la charge de l'Etat, ne doivent pas être considérées comme une participation à l'opération à laquelle est intéressé le bénéficiaire de l'autorisation, bien qu'elles puissent contribuer à accroître son bénéfice. Elles sont plutôt à porter au compte des charges incombant à l'administration au titre de la réglementation de l'utilisation du feu pour l'amélioration des parcours dans l'intérêt public.
Les deux facteurs les plus importants pour la détermination des dépenses à l'unité de superficie sont l'étendue de la superficie à incinérer et l'importance des aménagements préliminaires. En ce qui concerne l'étendue de la superficie à incinérer, l'élément déterminant du coût est la nécessité d'assurer la sécurité, en particulier par la création de lignes de défense. Les dépenses d'aménagement préliminaire ont pour but d'assurer l'efficacité de l'opération.
Le graphique de la figure 50 montre la relation existant entre l'étendue de la superficie à incinérer et la dépense par acre, pour les incinérations contrôlées faites dans le nord de la Californie en 1947 et 1948. Pour les incinérations de 640 acres (260 ha) ou sur une superficie plus faible, les dépenses totales ont été réparties entre le bénéficiaire de l'autorisation d'une part et l'Etat, de l'autre. Quoi qu'elles ne soient pas comprises dans le graphique, les dépenses par acre (0,40 ha) pour des étendues plus grandes ont les tendances ci-après: pour des superficies de plus de 700 acres (283 ha) les dépenses diminuent de 1,20 dollar à environ 40 cents jusqu'à un plafond de 5000 à 10000 acres (2024 à 4048 ha), au-delà de ce chiffre, la dépense à l'acre croît à nouveau quelque peu. La chute initiale de la courbe résulte de l'existence de certaines dépenses de base qui existent quelle que soit l'importance de la superficie à incinérer. Au-delà de 440 acres (178 ha), il est nécessaire de prévoir un équipement plus important et des mesures spéciales de sécurité mais en ce qui concerne la base du coût à l'acre, le chiffré le plus élevé est atteint pour 700 acres (283 ha). L'incinération de très grandes superficies nécessite l'emploi d'équipements encore plus importants et de plus d'hommes, et des techniques différentes doivent être utilisées pour assurer la sécurité.
L'importance des moyens mécaniques ou chimiques à mettre en œuvre pour préparer l'incinération est conditionnée par l'intensité d'incinération et le degré de propreté désirés. La mise à feu sur le périmètre d'une superficie recouverte de broussailles sur pied peut être réalisée en n'utilisant qu'un faible pourcentage de broussailles préalablement tuées et avec une consommation réduite de combustible, tandis qu'il peut être nécessaire de compartimenter ou d'écraser les broussailles si l'on veut obtenir une incinération totale (fig. 51). La proportion de la superficie qui doit être travaillée est indiquée sommairement dans la figure 52. Des essais expérimentaux de mise à feu pour des types de «chaparral» mélangés ou à «chemise», où le diamètre moyen des tiges principales est compris entre 1 et 4 inches .(2,5 à 10 centimètres), ont permis d'établir un guide sommaire fixant l'importance de la destruction et de l'écrasement des broussailles à réaliser (14). Ces renseignements sont résumés dans le tableau suivant:
TABLEAU 1. - FACTEURS INFLUANT SUR LE COUT DE L'INCINÉRATION CONTRÔLÉE
|
Type de broussaille |
Densité du fourré |
Pourcentage de la superficie á travailler |
|
Broussailles jeunes, croissant vigoureusement, peu de brindilles et de feuilles mortes, couverture morte ne propageant pas le feu |
Cimes des brous sailles peu denses couvert de 20 à 50% |
100 |
|
Moyen - densité 50-80 % |
100 |
|
|
Dense - densité 80% |
100-50 |
|
|
Broussailles dont les composants arrivés à maturité ont atteint leur hauteur maximum; présence de brindilles et de branches mortes dans les cimes; couverture morte suffisante pour propager le feu dans des conditions normales d'incinération en été |
Clair |
100 |
|
Moyen |
50 |
|
|
Dense |
33 |
|
|
Plantes surannées dont les cimes s'éclaircissent; nombreuses ramilles et branches mortes; couverture morte susceptible de propager le feu quelle que soit l'époque de la mise à feu |
Clair |
100 |
|
Moyen |
33 |
|
|
Dense |
25 |
De ces chiffres on peut déduire approximativement le coût relatif de l'incinération.
FIGURE 52. Photo expérimentale pour essais de «zone d'allumage»
a) 50 % broyés, les bandes non broyées étant aussi larges que les bandes broyées;Service forestier des Etats-Unis
b) 33 %7 bandes non broyées ayant 2 largeurs de bulldozer;
c) 25 %, bandes intactes ayant 3 largeurs de bulldozer;
d) 50 % broyés en croisant les passes;
e) 100 % broyés;
f) broussailles intactes.
L'utilisation des produits chimiques pour le débroussaillement n'est pas nouvelle. Des produits d'usage domestique comme le kérosène, le sel de cuisine et l'arsenic ont été utilisés depuis longtemps pour tuer les plantes. Cependant, on n'a pas fait d'efforts sur une grande échelle pour éliminer les broussailles et les arbres indésirables avec des produits chimiques jusqu'à ce qu'on ait fabriqué des produits complexes spécialement dans ce but. Les produits chimiques toxiques pour les broussailles font maintenant l'objet d'un grand effort de recherches et d'une industrie importante. Plusieurs facteurs sont responsables de ce progrès récent: la demande d'une méthode sûre et bon marché pour tuer jusqu'aux racines les plantes indésirables, une connaissance plus poussée des activités physiologiques de base chez les plantes et le bénéfice qu'en peuvent tirer les industries chimiques.
La destruction chimique a des avantages: la mort complète des plantes est obtenue plus facilement qu'avec les méthodes d'essartage mécanique et elle est d'ordinaire moins hasardeuse. Par contre, elle nécessite beaucoup de recherches ou d'essais pour connaître le produit chimique adéquat, la dose et le mode d'emploi propre à chaque espèce. Un autre inconvénient est qu'après la mort d'une plante, toutes les parties ligneuses restent debout et intactes. De plus, les produits chimiques rendent fréquemment le bois moins sensible à la pourriture. Parce que la méthode chimique tue mais ne supprime pas les broussailles, on la combine généralement soit avec des travaux mécaniques, soit avec l'incendie.
Différents types de produits chimiques
Afin de comprendre pourquoi certaines méthodes d'emploi doivent être utilisées, il est important de connaître l'action des herbicides courants. Pour être effectivement un débroussaillant, un produit chimique doit posséder les propriétés suivantes: être réellement absorbé par les tissus de la plante, être véhiculé à l'intérieur de la plante et avoir la propriété de tuer les cellules ou les tissus et éventuellement la plante. Parmi ces propriétés, la circulation du produit n'est pas une nécessité absolue. Une brève discussion de l'activité physiologique des produits chimiques les plus couramment employés est donnée ci-dessous. Certains d'entre eux peuvent figurer dans plusieurs catégories de la classification.
Herbicides sélectifs ou hormonés
On appelle ainsi les produits chimiques réglant la croissance, qui sont véhiculés à l'intérieur de la plante et agissent principalement sur les enzymes. Celles-ci varient dans leur structure chimique d'un groupe de plantes à un autre, si bien qu'un composé particulier du type hormone réagit spécifiquement sur le protoplasme d'un genre donné, d'une espèce ou peut-être d'une race. C'est la base de la sélectivité. Dans un peuplement hétérogène de broussailles, composé d'une douzaine d'espèces ou plus, l'herbicide aura un effet sur la croissance ou la respiration de certains arbustes, mais peut n'avoir qu'un effet minime ou nul sur les autres. C'est seulement un avantage là où les espèces indésirables sont sensibles, mais où certains composants doivent être maintenus pour le pâturage.
Beaucoup d'herbicides hormonés ont été fabriqués, mais deux seulement sont bien connus, le 2,4-D et le 2,4,5-T. Ils ont été largement utilisés sur des espèces buissonnantes et avec plus ou moins de succès. Afin de réduire l'action sélective, on mélange souvent ces deux produits chimiques, ils ont ainsi de l'effet sur un plus grand nombre d'espèces.
On peut utiliser le 2,4-D ou le 2,4,5-T sous forme d'ester, de sel d'amine ou d'acide. Parmi eux, les esters sont les plus solubles dans les graisses, c'est pourquoi ils sont le plus réellement absorbés par les cuticules grasses ou cireuses qui recouvrent couramment les feuilles de beaucoup de plantes des broussailles, surtout celles des climats méditerranéens. A côté des esters, les formules avec acide libre sont mieux absorbées par les feuilles que les sels d'amine solubles dans l'eau. Cependant, une fois que le produit chimique a traversé l'épiderme, il doit être dissous dans l'eau interstitielle afin de pénétrer dans le liber et d'agir sur les cellules méristématiques. C'est alors que la forme amine fonctionne le mieux, tandis que les esters sont les moins facilement véhiculés. On peut ainsi voir que la nature de la cuticule et des tissus de la feuille, chez une espèce, peut déterminer lequel des deux, ester ou amine de 2,4-D ou de 2,4,5-T, sera le produit chimique le plus efficace à utiliser.
Un des désavantages graves d'utilisation des formes ester du 2,4-D ou du 2,4,5-T est leur volatilité élevée. L'évaporation des éléments chimiques à partir du feuillage vaporisé peut se produire quelque temps après la pulvérisation et agir sur la végétation voisine. Ceci ne doit pas être confondu avec les «erreurs de direction» qui arrivent pendant la pulvérisation et qui peuvent être aussi néfastes avec les acides ou les amines qu'avec les esters.
Le 2,4-D et le 2,4,5-T ont plusieurs avantages sur beaucoup d'autres produits chimiques dont il sera question plus loin, à savoir: ils ne sont pas nocifs pour le bétail; ils ne sont pas corrosifs pour les parties métalliques du matériel; ils peuvent être utilisés sous une relativement faible quantité de produit concentré - habituellement environ 1 à 4 pounds par acre (1,1 à 4,5 kg à l'ha); et ils sont efficaces pour une gamme étendue de volumes, ce qui les rend également adaptés au traitement par avion, avec matériel se déplaçant au sol ou manuellement. L'herbe ne subissant pas de dégâts, ces composés sélectifs sont utilisés couramment pour débroussailler les terrains de parcours.
Leurs inconvénients sont: une efficacité dépendant entièrement de la concentration, du stade de croissance des plantes, des conditions atmosphériques et du terrain et des risques d'erreurs de direction dans l'arrosage. Le traitement par avion ou avec matériel terrestre peut aboutir à une dispersion de particules sur des kilomètres à la ronde, se traduisant par une perte de valeur des récoltes. Le traitement par avion est néfaste, même par des journées calmes, à cause de la turbulence provoquée par les hélices.
Herbicides de contact non sélectifs
Il y a beaucoup de produits chimiques solubles dans l'eau qui sont véhiculés dans les tissus, mais ne sont pas sélectifs. Ils peuvent être soit utilisés en pulvérisation sur le feuillage, soit appliqués sur des sections d'abattage. Les plus connus de ce groupe sont l'ammate (sulfamate d'ammonium) et l'arsénite de soude, quoique certains composés, chlorate et thyocyanate, aient le même effet. Etant solubles dans l'eau, ils peuvent être transportés vers les différents organes de la plante quand ils atteignent les tissus du liber. Les cellules de la plante, qui ont subi un contact prolongé avec ces composés, sont tuées. L'effet est à peu près le même sur le protoplasme de chaque plante, mais la vitesse de transport, la dose utilisée et l'époque de la plus grande sensibilité diffèrent suivant les espèces, si bien que les destructions ne sont pas uniformément satisfaisantes.
La manière dont les cellules sont tuées varie avec les produits chimiques: l'ammate tend à floculer les protéines dans le protoplasme, l'arsenic détruit la structure du noyau, tandis que la plupart des sels ont une action plasmolytique. En général, ces réactions rompent les relations normales de l'eau dans les cellules et les tissus. Ces composés restent solubles dans la plante tant qu'ils sont transportés par le système vasculaire vers les différents organes, tuant ainsi la plante entière.
Quand on les utilise en pulvérisation sur le feuillage, les solutions aqueuses sont appliquées avec les mêmes appareils que le 2,4-D; elles peuvent aussi l'être sur les sections des troncs ou encore les cristaux eux-mêmes peuvent être introduits sous l'écorce ou dans des entailles à la base du tronc.
Ni l'ammate ni l'arsénite de soude ne sont volatils, si bien qu'ils peuvent être utilisés sans danger pour les récoltes voisines. Cepedant l'arsénite est très toxique pour les animaux et doit être utilisé avec précaution.
Ainsi, les bois des arbres empoisonnés à l'arsénite de soude ne doivent pas être utilisés comme combustible, parce que les fumées peuvent être toxiques. L'ammate et l'arsénite sont extrêmement corrosifs pour le matériel et, en général, sont plus coûteux à employer que les pulvérisations du type hormone. L'efficacité de l'ammate a été démontrée sur un plus grand nombre de broussailles et d'espèces d'arbres que celle du 2,4-D ou du 2,4,5-T.
Herbicides de contact non systématiques
Ils comprennent les différents produits pétroliers qui sont utilisés comme herbicides. La plupart des pétroles ont des effets nuisibles sur les plantes. Ils s'étaleront sur les feuilles en un film en raison de leur faible tension superficielle et traverseront la cuticule. Ils ne circulent pas dans le système vasculaire, mais pénètrent profondément dans la plante par diffusion à travers la phase lipoïdique des tissus. Les pétroles sont solubles dans les produits lipoïdiques des parois cellulaires. La saturation des parois cellulaires en pétrole empêche les échanges gazeux normaux et la cellule est ainsi asphyxiée. A côté de cet effet mortel, les produits pétroliers ont une certaine part de toxicité qui dépend de leur teneur en composés non saturés.
On reconnaît deux types de toxicité: aiguë qui produit une brûlure rapide des feuilles, et chronique dont les symptômes sont la chlorose et sont moins apparents. La toxicité chronique seule est rarement observée chez les broussailles. Des composés légers, comme l'essence brûleront rapidement les feuilles mais les dégâts sont habituellement faibles parce que la plus grande partie du produit s'évapore avant que les tissus puissent être saturés, sauf si un volume important est employé. La toxicité aiguë est obtenue par l'emploi des hydrocarbures aromatiques plus lourds. Les désherbants à base de pétrole et le gas-oil en sont des exemples. Les produits pétroliers les plus couramment utilisés pour débroussailler sont le gas-oil, le mazout, le pétrole raffiné et les désherbants «carotte» Le gas-oil est le moins cher, sans danger à manipuler, il n'attaque pas le matériel et provoque à la fois les toxicités aiguë et chronique.
La toxicité des produits pétroliers peut être augmentée en ajoutant de faibles quantités d'agents renforçateurs comme les sulfures, le pentachlorophénol ou le dinitrocrésol qui détruisent les cellules après avoir été transportés par les huiles à travers la cuticule. De telles solutions sont employées comme desséchants; elles sont utilisées pour réduire rapidement la teneur en eau du feuillage, à tel point qu'il peut être allumé aussitôt après le traitement. Dans le «chaparral» californien une solution à 1 pour cent de pentachlorophénol dans le gas-oil, appliquée à la dose de 50 gallons par acre (470 litres environ à l'hectare) réduit de 50 pour cent en un jour l'eau contenue dans la broussaille sur pied.
Produits pour stériliser le sol
Ces produits non seulement tuent toutes les plantes qui existent sur la surface traitée, mais aussi empêchent la repousse de toute végétation pendant un temps appréciable. La stérilisation du sol est utilisée pour tuer les broussailles et empêcher leur repousse le long des lignes électriques et des clôtures, des canaux d'irrigation, sur les bas-côtés des routes et sur les pare-feu. Mais cette méthode ne peut être utilisée dans la pratique de l'amélioration des terrains de parcours ou de l'aménagement des forêts.
FIGURE Schéma d'un pulvérisateur à rampe. Ce modèle possède une pompe foulante et un agitateur mécanique. Les parties principales sont décrites dans le texte. [D'après Akesson et Harvey (1)]
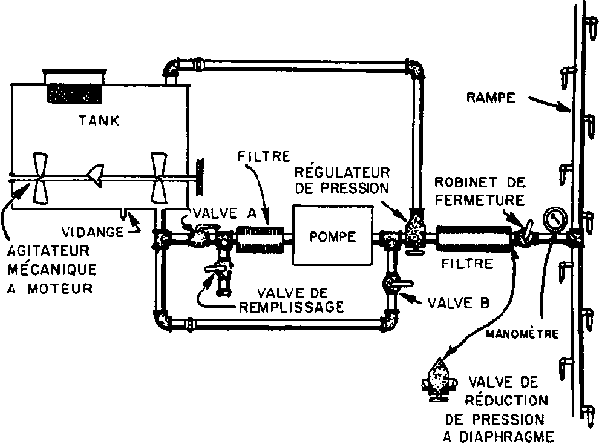
Les produits employés pour la stérilisation sont appliqués, soit sur toute la superficie, soit seulement autour du pied des plantes qu'on veut éliminer. Ils sont entraînés dans le sol par les pluies et y restent jusqu'à ce qu'ils soient absorbés par les plantes, lessivés par de nouvelles pluies, ou décomposés par action chimique ou bactérienne. Les produits chimiques peuvent être absorbés par les colloïdes du sol et deviennent ainsi inutilisables par les plantes. Les solutions de ces produits pénétrant dans les plantes détruisent la structure des cellules avec lesquelles elles sont en contact.
On peut citer comme produits stérilisants du sol à action permanente: l'arsénite de sodium, le trioxyde d'arsenic, les borates et le CMU (3- [parachlorophényl] - 1,1 - diméthyl urée). Leur action se traduit, avec certaines exceptions, par une destruction totale de toute végétation. L'arsénite de soude et les borates seront, dans les sols sableux, entraînés rapidement en profondeur par de fortes pluies; d'autre part, certaines plantes résistent à l'action du trioxyde d'arsenic.
On peut donner comme exemple de produits stérilisants à action temporaire: la chloropicrine, le sulfure de carbone, le bromure de méthyle. Le 2,4-D, le 2,4,5-T ou l'ammate peuvent être employés pour stériliser le sol. Ces produits n'étant pas couramment employés dans les opérations de débroussaillement sur une grande échelle, nous n'énumérerons pas leurs avantages et leurs inconvénients respectifs.
Les propriétés fondamentales des produits destinés à stériliser le sol doivent être les suivantes: se maintenir dans la zone du sol où se trouvent les racines, sous une forme soluble facilement absorbable, et en concentration suffisante au moment où les plantes absorbent activement (13).
Agents de dilution et additifs
Grâce aux agents de dilution ou «supports», il est possible de répandre uniformément des produits chimiques à forte concentration; les additifs accroissent l'efficacité de ces produits.
L'eau est l'agent de dilution le plus couramment employé pour les pulvérisations sur le feuillage, car elle est bon marché. Le gas-oil est employé comme support pour les pulvérisations sur la partie inférieure des arbres, tandis que pour les pulvérisations sur le feuillage il sert à la fois comme support et, en petites quantités, comme additif, en améliorant la pénétration du produit. Avec les herbicides systémiques, on ne peut employer le gas-oil qu'en faibles proportions, sinon il brûlera les feuilles et la pénétration du produit dans les tissus en sera retardée.
FIGURE 54. Schéma d'un pulvérisateur avec pompe centrifuge et agitateur hydraulique. Avec les pompes centrifuges, les valves de dérivation sont inutiles. Sur le croquis, la valve «D» est une valve de réduction de pression, on si la pression de la pompe est constante, c'est une simple valve d'obturation. Sur la valve «B» se fixe le tuyau d'aspiration pour le remplissage, avec «C» ouvert et «A» fermé. Un Venturi commande la rampe de l'agitateur. [D'après Akesson et Harvey (1)]
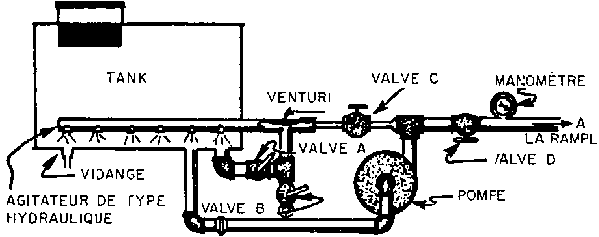
Les additifs comprennent les agents mouillants (sticker-spreuders) et les produits émulsifiants (emulsifiers). Les agents mouillants sont des corps ionisés ou neutres qui améliorent l'adhérence des herbicides à la surface des plantes et réduisent la tension superficielle du support. Les émulsifiants maintiennent les corps huileux en suspension dans l'eau pendant la pulvérisation. Un agent mouillant et émulsifiant doit être ajouté aux solutions aqueuses d'ammate et des sels aminés du 2,4-D ou du 2,4,5-T; les produits commerciaux à base d'esters en contiennent généralement les doses nécessaires.
Techniques d'application
Quatre techniques fondamentales sont employées pour traiter par les produits chimiques les arbres et les broussailles: pulvérisations sur le feuillage (foliage sprays), pulvérisations sur la partie inférieure des arbres (basal sprays), applications sur les sections (cut surface applications) et saturation du sol (soil saturation). Cette dernière technique a été traitée au paragraphe «produits pour stériliser le sol».
Pulvérisations sur le feuillage
Cette technique consiste à recouvrir complètement les feuilles des broussailles ou des arbres avec l'herbicide divisé en particules très fines. Elle est surtout employée en application «totale» tous les végétaux, indésirables ou non, étant soumis à la pulvérisation. Pour cette raison, les herbicides sélectifs qui, par exemple, n'ont aucune action sur les graminées, conviennent spécialement à ce mode d'application.
Les produits chimiques peuvent être pulvérisés sous un volume important ou restreint. Dans le premier cas le produit est employé fortement dilué, pour mouiller complètement la végétation. On emploie couramment 100 gallons par acre (950 litres à l'hectare) de produit dilué, pour le traitement de broussailles avec des pulvérisateurs à moteur équipés pour travail au sol. Dans la pulvérisation sous faible volume, on emploie une forme plus concentrée du produit, en appliquant rarement plus de 10 gallons par acre (95 litres à l'hectare). Les applications sous faible volume sont faites surtout par avion ou par hélicoptère, quand le prix du transport de grandes quantités de liquide est prohibitif.
Le matériel de pulvérisation comprend essentiellement: pompe, réservoir, agitateur, rampe, embout, et une source d'énergie pour actionner la pompe et déplacer le matériel au-dessus des broussailles.
Les types les plus simples de pulvérisateurs sont le pulvérisateur portatif à réservoir d'air comprimé, et le pulvérisateur à dos à pression constante. Dans ces modèles portatifs le pompage se fait à la main. Une simple pompe à air, montée à l'intérieur d'un réservoir cylindrique de 3 ou 4 gallons (11,3 à 15 litres) peut fournir une pression d'environ 80 pounds par square inch (5,6 kilogrammes par centimètre carré). Cette pression projette le liquide à travers l'embout. La pression diminue lorsque le niveau du liquide baisse, et on doit la rétablir en pompant. Dans le type à dos, les pompes à piston ou à diaphragme sont équipées de chambres a air qui maintiennent la pression constante quel que soit le niveau du liquide. La pompe à main doit être actionnée de façon continue.
Le nombre des types de pulvérisateurs à moteur est presque illimité, mais il suffira de donner le schéma d'un modèle classique et d'en décrire brièvement les parties principales.
La figure 53 représente le schéma d'un pulvérisateur avec pompe foulante. Il est équipé d'une valve de dérivation ou régulateur de pression et d'une valve de réduction de pression à diaphragme. La valve de dérivation abaisse la pression jusqu'à 100 pounds par square inch (7 kilogrammes par centimètre carré) ou moins, ce qui convient pour la pulvérisation sur les broussailles. Le réservoir peut être rempli par le fond en fixant un tuyau d'aspiration à la valve de remplissage, en fermant la valve «A» et ouvrant la valve «B»
Le débit nécessaire pour la pompe dépend du débit maximum du liquide qui doit être projeté par les embouts. L'équation suivante permet de calculer cette valeur (1):
|
débit de la pompe (gallons par minute) |
= |
vitesse de déplacement (miles par heure) |
× |
feet par mile |
x |
longueur de la rampe en feet |
× |
gallons par acre |
|
|
Square feet par acre × minutes par heure | |||||||
|
ou débit de la pompe (litres par minute) |
= |
vitesse de déplacement (mètres par heure) |
× |
longueur de la rampe en mètres |
× |
litres à l'hectare | ||
|
|
10 000 × 60 | |||||||
Ainsi avec une rampe de 25 feet (7,6 mètres) de long, une vitesse de déplacement de 5 miles (8 000 mètres) à l'heure, le débit de la pompe doit être de 25 gallons (95 litres) par minute si on veut répandre 100 gallons à l'acre (950 litres à l'hectare).

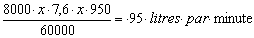
Les dimensions du réservoir dépendent du débit de la pompe, du volume ou de la concentration du liquide, et de la proximité du poste d'approvisionnement en eau ou autre agent de dilution. Les pulvérisateurs pour travail au sol peuvent avoir de grands réservoirs - de 300 à 1 000 gallons- (1 134 à 3 785 litres) mais ceux fixés aux ailes des avions ont rarement plus de 150 gallons (567 litres) de capacité, et ceux fixés aux hélicoptères 60 à 80 gallons (227 à 302 litres). Le réservoir peut être rempli en suivant la méthode décrite plus haut. Les réservoirs métalliques sont maintenus propres facilement et sont moins exposés aux fuites que les réservoirs en bois, mais un problème de corrosion se pose lorsqu'on emploie l'ammate et les composés arsenicaux. Si on ne peut employer que de l'eau sale comme agent de dilution, des filtres doivent être placés entre le réservoir et la valve de remplissage et aussi avant les embouts (voir fig. 53).
Des agitateurs sont nécessaires pour tous les mélanges de produits. L'agitation doit être continue avec les émulsions huileuses et les suspensions lourdes, il suffit d'une agitation intermittente pour les solutions aqueuses de 2,4-D, 2,4,5-T ou ammate. Un agitateur mécanique comprend une série de pales montées sur un axe qui traverse le fond du réservoir. Il peut être branché sur le moteur de la pompe. Une agitation hydraulique peut être assurée en faisant repasser une partie du liquide pris par la pompe à travers un tuyau percé de trous placé près du fond du réservoir. Ce dispositif fonctionne mieux avec une pompe centrifuge (fig. 54).
Les rampes sont faites de tubes de 3/4 d'inch à 2 inches de diamètre (1,9 à 5 centimètres). Des tubes plus petits ne conviennent pas en raison de la perte de charge qui abaisse la pression aux jets pour les pulvérisations sous grand volume. Les tubes plus gros sont plus solides et moins sujets à «vibrer» lorsqu'ils sont placés en porte à faux. De plus, il est plus facile de percer des trous dans de gros tubes pour y visser les embouts. La longueur de la rampe dépend des dimensions du réservoir et de la pompe. La longueur nécessaire pour couvrir me certaine superficie dans un temps donné peut être calculée comme suit:
|
|
square feet par acre × nombre d'acres | |||||
|
longueur de la rampe |
= |
temps effectif de pulvérisation |
× |
vitesse |
× |
feet par mile |
|
|
nombre de mètres carrés à parcourir | |||||
|
ou longueur de la rampe (en mètres) |
= |
temps effectif de pulvérisation (en heures) |
× |
vitesse (en mètres par heure) | ||
La longueur de rampe nécessaire pour couvrir 500 acres (200 hectares) en 10 jours de 8 heures avec un appareil qui se déplace à la vitesse de 4 miles (6,4 kilomètres) à l'heure sera calculée comme suit:
ou
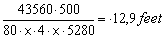
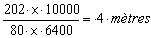
On emploie deux types d'embouts: ceux donnant un jet plat en éventail et ceux donnant un jet creux conique. L'embout plat couvre uniformément et avec plus de puissance. Une pression minimum de 10 à 25 pounds par square inch (0,7 à 1,8 kilogramme par centimètre carré) est nécessaire pour projeter l'éventail liquide. En augmentant la pression, on obtient un éventail plus large et des gouttelettes plus fines. Les embouts qui donnent un: jet conique ne se ferment pas aussi facilement, et sont moins bien adaptés pour produire un brouillard lorsqu'on pulvérise sous faible débit. La largeur de l'éventail, l'espacement des embouts et la hauteur de la rampe déterminent l'uniformité de la couverture (fig. 55). La consommation en gallons par acre peut être calculée par la formule suivante:
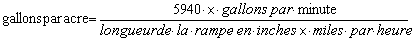
Le chiffre de 5 940 est une constante dérivée de l'équation:

ou

Pour la pulvérisation aérienne la largeur couverte effectivement à chaque passage est plus grande que la longueur de la rampe. Si le débit des jets est connu, la consommation peut être calculée par l'équation suivante:
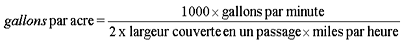
ou
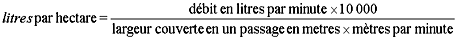
La puissance nécessaire pour actionner la pompe peut être calculée d'après le débit et le rendement de la pompe. L'équation suivante permet de trouver la puissance approximative nécessaire pour actionner la pompe:

ou
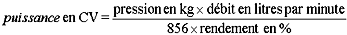
Le rendement des pompes varie de 20 à 80 pour cent; si on prend une valeur faible, les calculs donneront une puissance du moteur largement suffisante.
Le moteur peut être, soit indépendant de celui qui fait avancer l'appareil, soit le même; dans ce dernier cas, la pompe est branchée sur la poulie ou sur la prise de force. Les pompes des pulvérisateurs montés sur avion peuvent être actionnées par les commandes hydrauliques des ailerons ou du train d'atterrissage, par des hélices tournant par la vitesse de l'avion, indirectement par le moteur de l'avion ou par des moteurs électriques indépendants.
Les divers montages qui peuvent être faits soit pour des appareils au sol, soit pour des pulvérisateurs sur avion, sont trop nombreux pour qu'on puisse en discuter ici; quelques-uns sont représentés dans les figures 56, 57, 58, 59 et 60.
La pulvérisation du feuillage par avion présente certains avantages sur la pulvérisation au sol. De grandes superficies peuvent être traitées économiquement et rapidement. Le repérage d'une piste d'atterrissage à proximité du terrain à traiter, et la distance à parcourir pour y atterrir, représentent une partie considérable du prix de revient de la pulvérisation aérienne. Cette part du prix est la même quelle que soit la grandeur du terrain; le prix de revient à l'hectare est donc élevé lorsque la superficie à traiter n'a que quelques hectares.
FIGURE 64. Schèma de l'appareil Cornell. [D'après Cope et Spaeth (9)]
Sur de petites superficies, la pulvérisation au sol est généralement moins coûteuse. L'avion peut aussi être employé lorsque le sol est détrempé ou couvert de neige. En terrain accidenté, l'avion permet de traiter la végétation complètement, mais pas toujours de façon uniforme. Les produits chimiques peuvent être appliqués sous un faible volume, ce qui, pour beaucoup d'espèces, représente un très net avantage.
La pulvérisation par hélicoptère peut être faite beaucoup plus près du sol qu'il n'est possible par avion. En terrain accidenté, l'hélicoptère peut suivre les contours des courbes de niveau, de façon à se maintenir à hauteur constante au-dessus du terrain et réaliser ainsi une pulvérisation plus uniforme. Il est possible d'insister, en passant à faible vitesse et à basse altitude, sur des taches de broussailles éparses ou des bouquets d'arbres que l'on veut détruire, tout en évitant de répandre les produits au-dessus d'une végétation insensible à leur action. Le souffle du rotor provoque un déplacement d'air, dirigé vers le bas, particulièrement avantageux pour le traitement de feuillage de densité moyenne ou forte.
Le produit pulvérisé est projeté violemment vers le bas; puis il y a une vive aspiration vers le haut. Grâce à cette double action, la face supérieure et la face inférieure des feuilles sont toutes deux touchées par le produit, et celui-ci est distribué dans toute la masse du feuillage. Un autre avantage de l'hélicoptère est qu'il peut décoller et atterrir sur un très petit espace; il est rare de ne pouvoir trouver un terrain convenable dans la région à débroussailler ou tout près. Toutefois, la charge utile est plus faible que celle des avions, ce qui augmente le prix de revient de l'opération. L'hélicoptère ne peut être employé dans les montagnes d'une altitude supérieure à 6 000 feet (1830 mètres).
Le principal inconvénient de la pulvérisation par avion est l'éventualité de la dérive due aux courants aériens qui existent à l'altitude de vol. De ce fait, outre les dégâts possibles aux récoltes voisines, il faut craindre une mauvaise répartition du produit sur le feuillage.
La pulvérisation aérienne est dangereuse pour les pilotes. Beaucoup de terrains actuellement couverts de broussailles présentent de fortes pentes ou des canons. Il est dans ces conditions extrêmement dangereux de voler à l'altitude nécessaire pour avoir une bonne distribution des produits.
Les pulvérisateurs au sol sont le plus couramment employés lorsqu'on peut utiliser un fort volume de liquide, lorsque le terrain est assez plat et solide pour permettre la circulation d'appareils à roues, et lorsque la broussaille n'est pas dense au point d'empêcher leur passage. Les pulvérisateurs à main sont utilisés sur les petites superficies, sur les terrains trop accidentés pour les appareils à roues, et dans les forêts, lorsqu'on ne veut détruire qu'une faible partie de la végétation.
Pulvérisation à la base des tiges (basal spray)
Cette méthode consiste à appliquer les produits sous forme concentrée sur la partie inférieure des tiges des plantes ligneuses. Le produit phytocide peut être versé d'un bidon ou appliqué au pinceau. De cette façon on n'en gaspille pas beaucoup et il peut être employé pratiquement pur. Lorsqu'on utilise un pulvérisateur, les embouts qui donnent un jet en éventail sont préférables. Mais une partie du liquide peut être gaspillée, aussi faut-il diluer un peu le produit. En tout cas, il faut appliquer assez de liquide pour qu'il puisse couler le long du tronc jusque dans le sol.
Tous les phytocides systémiques solubles dans l'huile peuvent être employés pour ce type de pulvérisation. Ils sont particulièrement efficaces lorsqu'on utilise comme solvant du gas-oil loger ou du pétrole qui pénètrent à travers l'écorce, jusqu'au cambium. Les petits arbres, d'un diamètre de 3 inches (7,6 centimètres) ou moins, sont tués très facilement par ce moyen à cause de leur écorce mince. On emploie aussi les huiles minérales seules. Elles sont surtout efficaces sur les espèces susceptibles de rejeter. L'huile minérale peut couler le long du tronc jusqu'à la zone où se forment les bourgeons préventifs, saturant le collet et la terre qui l'entoure; l'huile pénètre dans les tissus et tue les méristèmes des bourgeons, empêchant ainsi toute possibilité de développement de rejets (fig. 61).
Applications sur surfaces coupées (cut-surface applications)
En appliquant les produits chimiques sur des surfaces coupées sur le tronc, il est possible, par les méthodes des encoches (notching) et de la «collerette» (frilling) de tuer les parties aériennes et d'empêcher la pousse des rejets et, par le traitement des souches, d'empêcher la pousse des rejets de tige ou de souche. Les techniques employées sont relativement simples. L'ammate, l'arsénite de soude, les esters ou les sels aminés de 2,4-D ou 2,4,5-T sont les produits le plus couramment employés pour ces traitements.
Méthode des encoches (notch method) (fig. 62). Des encoches (notches ou cups) sont pratiquées autour du pied des broussailles ou des arbres, à intervalles réguliers. Une bonne encoche peut être taillée en deux coups de hache, la section inférieure étant faite par un coup donné vers le bas, pénétrant jusque dans l'aubier ou tout au moins le cambium, de sorte que les vaisseaux libériens sont tranchés et ouverts. Il n'est pas nécessaire d'employer des solutions huileuses puisqu'il n'y a pas de tissu subérifié à traverser. Les produits du type systémique, solubles dans l'eau, peuvent être utilisés en solution ou sous forme de cristaux et versés dans l'encoche avec un bidon ou une cuillère. La burette à pompe des mécaniciens, avec son long bec, convient très bien pour cet usage; mais n'importe quel type de bidon à bec improvisé peut remplir le même office. Le nombre d'encoches nécessaire dépend, de même que la concentration et la quantité de produit à appliquer à chaque encoche, de l'espèce et du diamètre du tronc.
Méthode de la «collerette» (frill method) (fig. 63). Une «collerette» consiste essentiellement en une série continue d'entailles faites autour de la base du tronc. On n'obtient pas, comme dans l'annélation circulaire, une section nette et large dans le cambium, mais simplement une sorte de gouttière, tout autour de l'arbre, où on peut verser le produit. Il y a peu ou pas de mouvements latéraux de l'eau dans les tiges ligneuses; c'est pourquoi, par la méthode des encoches, les parties de la plante alignées verticalement avec les encoches sont tuées, tandis que celles alignées avec les intervalles entre les encoches ne sont pas tuées et peuvent émettre des rejets. Cet inconvénient est réduit avec les «collerettes». Cette méthode est la meilleure pour les gros arbres, de plus de 12 inches (30 centimètres) de diamètre à la base. Naturellement, il faut plus de temps et plus de produit pour une «collerette» que pour des encoches, mais ces inconvénients sont compensés par la plus forte proportion de tiges tuées.
L'appareil «Cornell» (fig. 64). Cet appareil est constitué par deux tubes de sections différentes ayant au total 5 feet (1,5 mètre) de long. La partie supérieure a 4 feet (1,2 mètre) de long et sert de réservoir pour le produit; la partie inférieure est façonnée en forme de lame coupante à bord concave. Un cylindre de laiton percé d'un trou de 1/2 inch (1,27 centimètre) placé entre les deux sections, joue le rôle de clapet de fermeture et sert à doser le produit. Deux clapets sont attachés à une tringle de 1/8 inch (3,2 millimètres) qui passe à travers le cylindre et le réservoir; la longueur de la tige est telle que lorsque la valve supérieure est fermée, l'inférieure est ouverte, et vice-versa. Après avoir frappé avec l'outil coupant, on donne à la tringle un rapide mouvement de va-et-vient, ce qui permet à une quantité donnée de liquide de s'écouler dans l'entaille pratiquée dans l'arbre. Ce modèle d'outil a été mis au point à l'Université Cornell (9). D'autres «injecteurs pour arbres» sont basés sur le même principe, mais la valve balladeuse est actionnée automatiquement par le seul choc de l'outil sur l'arbre.
Traitement de souches. Les souches des espèces susceptibles de rejeter peuvent être traitées par l'une des trois méthodes suivantes: pulvérisation au pied de la souche, encoches ou collerette pratiquées autour du pied de la souche, dans lesquelles on verse le poison, application du poison sur la section de la souche. Le produit peut être versé avec une cuillère (fig. 65) ou appliqué au pinceau. La souche doit être barbouillée avec la solution presque jusqu'à refus. Sur des souches coupées ras et bien planes. le liquide appliqué sera pratiquement utilisé en totalité. Les tiges de faible diamètre peuvent être coupées de façon à ce que la souche soit creusée en forme de V. Le creux sera rempli de cristaux ou enduit avec la solution.
Méthodes combinées de débroussaillement
L'efficacité des produits chimiques est maximum lorsqu'ils sont employés en même temps que d'autres méthodes de débroussaillement, traitement mécanique, incinération, aménagement du pâturage. En effet, d'une part les diverses espèces de broussailles, en peuplements mélangés, ne sont pas également sensibles aux produits chimiques, et d'autre part les tiges mortes restent sur pied pendant un certain temps. Le rail, le câble ou le bulldozer peuvent donc être employés pour briser les tiges tuées par un traitement chimique. Le feu est souvent employé avant ou après la pulvérisation. Les rejets et les semis de broussailles sont généralement plus sensibles à l'action des produits chimiques à base d'hormones que les sujets complètement développés des mêmes espèces; c'est pourquoi l'incinération contrôlée suivie d'une pulvérisation sur le feuillage est une technique de débroussaillement particulièrement efficace. Pour l'incinération au printemps, alors que la teneur en eau des plantes est élevée, la pulvérisation de produits de contact à action rapide, qui dessèchent les parties vertes, constitue un bon traitement préparatoire.
La possibilité d'emploi de produits sélectifs en pulvérisation sur le feuillage, combinée avec un pâturage intensif n'a pas encore été complètement étudiée. Les phytocides à base d'hormones, qui agissent d'autant mieux qu'une plus grande surface de feuillage leur est exposée, tueront par conséquent plus facilement, dans un peuplement de broussailles, les espèces qui ne seront pas broutées par le bétail et épargneront dans une certaine mesure celles que le bétail préfère. Cette action sélective favorisera donc les bonnes plantes du pâturage.
Destruction «biologique» des végétaux
Le débroussaillement par des méthodes dites «biologiques» se rapporte essentiellement à la destruction des rejets et semis des plantes ligneuses après que les parties aériennes aient été brûlées ou traitées mécaniquement. Les chèvres et dans une moindre mesure les cervidés, sont les animaux les plus efficaces lorsqu'il s'agit de compléter la destruction des peuplements éclaircis, par exemple de chêne-vert de l'intérieur (interior live oak) en Californie, ainsi que certaines autres espèces de broussailles (32).
Lorsque, après le débroussaillement, des pousses comestibles commencent à apparaître, il faut introduire assez de chèvres sur le terrain pour que les rejets et les semis soient continuellement abroutis (fig. 66). Des clôtures permettent de cantonner les animaux sur des superficies relativement petites. Lorsque les pousses sont abondantes, il faut 3 chèvres à l'acre (7 ou 8 à l'hectare) sinon 2 chèvres à l'acre (5 à l'hectare) suffisent pendant toute la saison de pâturage. A mesure que les broussailles cèdent la place à l'herbe, la superficie par tête de bétail peut être augmentée afin de maintenir les chèvres en bonne condition. La charge en bétail doit, généralement pour 3 à 5 ans, correspondre à la possibilité totale en plantes comestibles; sinon, une partie seulement des pousses seront détruites. En règle générale, les chèvres nourries de cette façon donneront au moins un petit bénéfice. Des résultats analogues peuvent être obtenus dans beaucoup de cas avec des moutons et du gros bétail (fig. 67).
Sur des surfaces brûlées de faible étendue -4 à 5 acres (1,6 à 2 hectares)-les cerfs détruiront les rejets et les semis de «chamise», des chênes, et d'autres plantes ligneuses comestibles (fig. 68). De plus grandes superficies brûlées ne peuvent être convenablement nettoyées car le pâturage n'y serait pas assez concentré.
Une autre méthode efficace pour détruire les semis de broussailles consiste à ensemencer les terrains brûlés avec des plantes fourragères envahissantes. On a pu montrer que, dans une herbe dense, les semis de broussailles ne peuvent étendre leurs racines jusqu'à la profondeur où se trouve l'eau à la fin de l'été (36). Au contraire, des semis de broussailles poussant sans la concurrence d'autres végétaux envoient des racines en abondance jusqu'à cette profondeur (fig. 69). De plus, la couverture herbacée stabilise le sol, fournit du fourrage et éventuellement un combustible si on veut faire une nouvelle incinération pour achever de nettoyer le terrain.
La destruction biologique de la végétation par les maladies et les insectes représente un phénomène naturel qui bien souvent élimine des peuplements indigènes les diverses plantes nuisibles, y compris les broussailles. Ces dégâts n'aboutissent cependant que rarement à une destruction durable. Mais la lutte biologique offre de grandes possibilités en ce qui concerne la destruction des plantes nuisibles introduites; en effet, il est possible d'introduire à leur tour leurs ennemis naturels sans qu'ils soient accompagnés de leurs propres maladies ou parasites. En Australie, des succès remarquables furent obtenus dans la lutte contre des espèces de cactus introduites, et plus récemment en Californie et Orégon, pour le «St-Johns-wort» (Hypericaceae), grâce à des coléoptères qui se nourrissaient exclusivement de ces plantes.
(Traduit de l'anglais.)