
|
|||||||||
 |
|
||||||||
FAO. 2009.
Acipenser baerii. In Cultured aquatic species fact sheets. Text by
Williot, P., Bronzi, P., Benoit, P., Bonpunt, E., Chebanov, M., Domezain, A., Gessner, J., Gulyas, T., Kolman, R., Michaels, J., Sabeau, L. & Vizziano, D.
Edited and compiled by Valerio Crespi and Michael New. CD-ROM (multilingual). |
|||||||||
IDENTIFICATION
Caractéristiques biologiques
Présence de spiracles. Museau et pédicule caudal subconique. Membranes des branchies jointes par l’isthme. Bouche protractile transverse et lèvre inférieure fendue au milieu. Les barbillons sont lisses ou légèrement frangés. La longueur de la mâchoire est très variable (33,3-61 pour cent de la longueur de la tête). 20-49 branchiospines, chacune terminée par plusieurs boutons. Nageoire dorsale: 30-56 rayons. Nageoire adipeuse: 17-33 rayons. 10-12 écussons osseux dorsaux, 32-62 écussons osseux latéraux, 7-16 (20) écussons osseux ventraux. Les écussons osseux des jeunes spécimens sont légèrement inclinés alors que ce n’est pas le cas chez les adultes. De nombreuses petites plaques osseuses se trouvent entre les rangées d’écussons. Grande variabilité de couleurs: du gris léger au marron foncé sur le dos et les flancs, du blanc au jaunâtre sur le ventre.
PROFIL
Contexte historique
Depuis les années 1940, cette espèce a attiré une considérable attention du fait de son adaptabilité. Des tests ont été menés au cours des années 1950 pour l’introduire dans différents espaces en eaux ouvertes (mer Baltique) ou fermées (lacs). L’élevage de l’esturgeon de Sibérie a débuté en ex-URSS pendant les années 1970. C’est à cette époque que les premiers individus sont arrivés en France (en provenance de la Lena) dans le cadre d’un programme de coopération scientifique franco-soviétique. Depuis, la diffusion de l’espèce s’est accélérée et, outre la Fédération de Russie (son pays d’origine), elle est présente en Europe (Belgique, France, Italie, Allemagne, Hongrie, Pologne et Espagne), en Amérique (Etats-Unis, Uruguay) et en Asie (Chine). Elle est également certainement présente dans d’autres pays sous une forme expérimentale. Elle a enfin été l’objet de plusieurs hybridations.
Quelques rares compagnies couvrent l’ensemble du cycle de production et commercialisent tous les produits possibles. Certaines ne produisent que des œufs et/ou des alevins alors que d’autres se sont spécialisées dans la production du poisson pour sa chair. Dans de nombreux pays occidentaux, le caviar est devenu la principale raison de l’élevage de l’esturgeon.
Quelques rares compagnies couvrent l’ensemble du cycle de production et commercialisent tous les produits possibles. Certaines ne produisent que des œufs et/ou des alevins alors que d’autres se sont spécialisées dans la production du poisson pour sa chair. Dans de nombreux pays occidentaux, le caviar est devenu la principale raison de l’élevage de l’esturgeon.
Principaux pays producteurs
La carte proposée ci-dessous a été établie à partir des statistiques de la FAO relatives à l’esturgeon de Sibérie. L’élevage de ce dernier est réalisé dans de nombreux autres pays, notamment dans la Fédération de Russie, en Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Espagne, en Belgique, aux Etats-Unis d’Amérique et en Chine. La production relevant de ces activités est cependant incluse dans la catégorie « esturgeons nca » des statistiques de la FAO, en partie parce que ces pays n’établissent pas avec précision quelle espèce est élevée et en partie parce qu’une part de leur production est obtenue à partir d’hybrides.

Principaux pays producteurs de Acipenser baerii (FAO Statistiques des pêches, 2006)
Habitat et biologie
L’espèce est présente dans tous les bassins hydrographiques de l’Ob-Irtych à la Kolyma. Elle peut donc être identifiée dans ceux de l’Ienisseï, de la Khatanga, de la Léna et de l’Indigirka. Des populations sont également présentes dans le système hydrographique du lac Baïkal. On distingue trois sous-espèces: Acipenser baerii baerii dans le bassin de l’Ob, Acipenser baerii stenorrhynchus dans celui de l’Ienisseï jusqu’à la Kolyma et enfin Acipenser baerii baicalensis dans le lac Baïkal.
Plusieurs centaines de tonnes d’esturgeon de Sibérie étaient capturés au début et au milieu du XXe siècle, par ordre décroissant dans les bassins de l’Ob, de l’Ienisseï et de la Léna. L’esturgeon de Sibérie est une espèce d’eau douce qui migre sur de longues distances dans les rivières où il se trouve. Contrairement à d’autres esturgeons, le stock de géniteurs de cette espèce continue à s’alimenter au cours de la période de migration procréatrice. La puberté arrive tard du fait d’une croissance lente dans ces conditions froides, entre 10 et 17 ans pour les mâles, 12 et 20 ans pour les femelles, suivant leur origine. Les adultes des deux sexes possèdent des canaux de Müller. L’oviducte occupe environ un tiers de la cavité abdominale. Il est relié au canal de Müller par une valve unidirectionnelle. Cette espèce appartient au groupe des esturgeons et compte environ 250 chromosomes.
L’esturgeon de Sibérie peut vivre dans des eaux aux températures très différentes, de seulement 1 °C à 25-26 °C. L’espèce est assez résistante à de faibles teneurs en O2 mais ne grossit pas dans ces conditions.
Plusieurs centaines de tonnes d’esturgeon de Sibérie étaient capturés au début et au milieu du XXe siècle, par ordre décroissant dans les bassins de l’Ob, de l’Ienisseï et de la Léna. L’esturgeon de Sibérie est une espèce d’eau douce qui migre sur de longues distances dans les rivières où il se trouve. Contrairement à d’autres esturgeons, le stock de géniteurs de cette espèce continue à s’alimenter au cours de la période de migration procréatrice. La puberté arrive tard du fait d’une croissance lente dans ces conditions froides, entre 10 et 17 ans pour les mâles, 12 et 20 ans pour les femelles, suivant leur origine. Les adultes des deux sexes possèdent des canaux de Müller. L’oviducte occupe environ un tiers de la cavité abdominale. Il est relié au canal de Müller par une valve unidirectionnelle. Cette espèce appartient au groupe des esturgeons et compte environ 250 chromosomes.
L’esturgeon de Sibérie peut vivre dans des eaux aux températures très différentes, de seulement 1 °C à 25-26 °C. L’espèce est assez résistante à de faibles teneurs en O2 mais ne grossit pas dans ces conditions.
PRODUCTION
Cycle de production

Cycle de production de Acipenser baerii
Systèmes de production
Approvisionnement en juvéniles
Les mâles et les femelles sont conservés séparément en raison des différents produits vendus à partir de l’élevage d’esturgeon. L’absence de dimorphisme sexuel entraîne le développement de différentes méthodes de détermination du sexe des poissons immatures: biopsie et observations, dosage plasmatique de l’hormone 11-kétostérone et scanners à ultrasons. Ces actions sont normalement pratiquées vers 3 ans. Les mâles sont ensuite vendus. Les femelles sont conservées et la phase de grossissement dure plusieurs années jusqu’à ce qu’elles soient adultes et produisent du caviar. Elles sont ensuite récoltées pour leur chair. Certaines d’entres elles peuvent être conservés pour les stocks de géniteurs et de futures reproductions.
Stock de géniteurs
L’esturgeon de Sibérie est une espèce gonochorique. Les conditions d’élevage en ferme sont généralement plus favorables que les conditions naturelles dont ils sont originaires et la puberté a alors lieu bien plus tôt, à 6 ans environ pour les mâles et vers 7 ans pour les femelles dans des conditions tempérées.
La gestion du stock de géniteurs est compliquée par le fait que les femelles n’ovulent pas tous les ans (à de rares exceptions près) et ne sont pas toutes synchrones. Pour une cohorte donnée, le nombre de femelles adultes obtenu peut donc varier entre 35 et 63 pour cent du stock chaque année. Le contrôle de la température de l’eau permet d’obtenir des œufs sur une longue période, de décembre à mai.
La vernalisation et la stimulation hormonale sont réalisées pour obtenir des produits de bonne qualité sur le plan sexuel. Différents types d’hormones peuvent être utilisés, notamment des extraits pituitaires d’esturgeon ou de carpe, ou des gonadostimulines (GnRH). Le principal problème est d’être capable de déterminer le bon moment pour administrer l’injection d’hormones, c’est-à-dire de choisir les animaux qui présentent l’état physiologique le plus approprié. L’histoire du stock, la taille des follicules ovariens, l’homogénéité de ces derniers, leur apparence, la position de la vésicule germinale et la capacité de maturation in vitro des follicules ovariens sont des critères utiles pour déterminer le bon moment pour prendre la décision.
Les œufs sont récoltés grâce à un massage abdominal répété toutes les deux heures ou mieux, en réalisant une petite laparotomie. L’ouverture pratiquée est ensuite refermée avec des points de sutures. Pendant l’opération, l’animal reçoit un jet d’eau à travers la bouche. La récolte varie entre 8 et 14 pour cent du poids de la femelle vivante. Les œufs sont souvent de forme ovoïde, bruns et/ou vert foncé. Ils mesurent entre 3,0 et 3,8 mm et présentent plusieurs micropyles. On compte entre 35 et 45 œufs/g.
Les mâles produisent fréquemment plusieurs dizaines de ml de sperme qui sont collectés en utilisant un petit tube flexible introduit délicatement dans l’orifice génital. La fertilisation est réalisée en utilisant des techniques perfectionnées il y a déjà plusieurs décennies.
Ecloseries
Les œufs fertilisés doivent subir un traitement qui prévient leur rassemblement pendant l’incubation. On pratique très souvent une suspension d’argile aqueuse et parfois du lait est utilisé. Après rinçage, les œufs sont placés dans les incubateurs, généralement des carafes d’éclosion Zoug ou McDonald.
Le développement des embryons démarre au bout de 6 jours environ à une température de 13-14 °C. Les larves normales peuvent être facilement sélectionnées grâce à leur phototropisme positif.
Stock de géniteurs
L’esturgeon de Sibérie est une espèce gonochorique. Les conditions d’élevage en ferme sont généralement plus favorables que les conditions naturelles dont ils sont originaires et la puberté a alors lieu bien plus tôt, à 6 ans environ pour les mâles et vers 7 ans pour les femelles dans des conditions tempérées.
La gestion du stock de géniteurs est compliquée par le fait que les femelles n’ovulent pas tous les ans (à de rares exceptions près) et ne sont pas toutes synchrones. Pour une cohorte donnée, le nombre de femelles adultes obtenu peut donc varier entre 35 et 63 pour cent du stock chaque année. Le contrôle de la température de l’eau permet d’obtenir des œufs sur une longue période, de décembre à mai.
La vernalisation et la stimulation hormonale sont réalisées pour obtenir des produits de bonne qualité sur le plan sexuel. Différents types d’hormones peuvent être utilisés, notamment des extraits pituitaires d’esturgeon ou de carpe, ou des gonadostimulines (GnRH). Le principal problème est d’être capable de déterminer le bon moment pour administrer l’injection d’hormones, c’est-à-dire de choisir les animaux qui présentent l’état physiologique le plus approprié. L’histoire du stock, la taille des follicules ovariens, l’homogénéité de ces derniers, leur apparence, la position de la vésicule germinale et la capacité de maturation in vitro des follicules ovariens sont des critères utiles pour déterminer le bon moment pour prendre la décision.
Les œufs sont récoltés grâce à un massage abdominal répété toutes les deux heures ou mieux, en réalisant une petite laparotomie. L’ouverture pratiquée est ensuite refermée avec des points de sutures. Pendant l’opération, l’animal reçoit un jet d’eau à travers la bouche. La récolte varie entre 8 et 14 pour cent du poids de la femelle vivante. Les œufs sont souvent de forme ovoïde, bruns et/ou vert foncé. Ils mesurent entre 3,0 et 3,8 mm et présentent plusieurs micropyles. On compte entre 35 et 45 œufs/g.
Les mâles produisent fréquemment plusieurs dizaines de ml de sperme qui sont collectés en utilisant un petit tube flexible introduit délicatement dans l’orifice génital. La fertilisation est réalisée en utilisant des techniques perfectionnées il y a déjà plusieurs décennies.
Ecloseries
Les œufs fertilisés doivent subir un traitement qui prévient leur rassemblement pendant l’incubation. On pratique très souvent une suspension d’argile aqueuse et parfois du lait est utilisé. Après rinçage, les œufs sont placés dans les incubateurs, généralement des carafes d’éclosion Zoug ou McDonald.
Le développement des embryons démarre au bout de 6 jours environ à une température de 13-14 °C. Les larves normales peuvent être facilement sélectionnées grâce à leur phototropisme positif.
Nurserie
L’ordre et la durée des différentes phases du comportement larvaire sont bien définis à 17-18 °C. Dans ces conditions, les larves doivent être nourries pour la première fois entre le 9e et le 11e jour suivant leur éclosion, c’est-à-dire une fois la phase d’alimentation endogène complètement achevée. D’excellents résultats sont immédiatement obtenus (en termes de taux de croissance et de mortalité) avec une alimentation composite. De simples petits bassins de 200 cm de long, 20 cm de large et 40 cm de profondeur sont appropriés pour l’élevage des larves au cours des 4 premières semaines. Le poids moyen des larves est d’environ 500 mg à 17-18 °C. La profondeur de l’eau est comprise entre 15 et 30 cm. Par la suite, des bassins circulaires (Φ = 2 m) peuvent être utilisés pour les alevins.
L’esturgeon de Sibérie peut être élevé dans un vaste éventail de systèmes: raceways, bassins circulaires, grands bassins dans le cadre de l’élevage intensif, étangs et cages. Les cages sont d’usage courant en Russie et en Uruguay. Des tests ont également été menés pour l’élevage d’esturgeon dans des systèmes à recirculation d’eau.
Dans les étangs, l’élevage peut être pratiqué à une densité comprise entre 1,5 et 3 kg/m² sans oxygénation. On a enregistré des densités de 50 à 80 kg/m² si de l’oxygène supplémentaire est fourni. L’esturgeon de Sibérie résiste à des températures élevées (25-26 °C) à condition que deux précautions soient prises simultanément: absence d’aliments et fourniture d’un niveau élevé d’O2. Les esturgeons préfèrent l’ombre et évitent la lumière directe. La végétation submergée doit être évitée car elle peut piéger le poisson dans une masse d’algues.
En Europe occidentale, les aliments utilisés sont principalement des granulés commerciaux souvent très proches de ceux adoptés dans la truiticulture. Les granulés extrudés présentent une meilleure stabilité dans l’eau et sont plus appropriés au comportement alimentaire de l’esturgeon. Les taux alimentaires en Europe occidentale dépassent rarement 1-1,5 pour cent de la biomasse. Ils sont même inférieurs à ces chiffres chez les plus grands individus. Des taux bien plus élevés (environ 4 pour cent) ont cependant été relevés dans la Fédération de Russie. En ce qui concerne l’élevage en étang, le lieu de distribution de la nourriture doit varier pour éviter l’accumulation de sédiments autour des zones de diffusion.
Les poissons sont rassemblés au moyen de filets. Ils sont ensuite capturés avec une petite épuisette à mailles moyennes. Les plus gros individus sont attrapés à la main.
En ce qui concerne le caviar, les principales étapes de transformation sont les suivantes: sélection des femelles, conservation dans de l’eau courante quelques temps, assommage, éviscération, retrait des ovaires, refroidissement, examens de dépistage, rinçage, pesage, salage, séchage, conditionnement, étiquetage et conservation. Chaque étape est importante, la première (la sélection des femelles) étant la principale.
Techniques de grossissement
L’esturgeon de Sibérie peut être élevé dans un vaste éventail de systèmes: raceways, bassins circulaires, grands bassins dans le cadre de l’élevage intensif, étangs et cages. Les cages sont d’usage courant en Russie et en Uruguay. Des tests ont également été menés pour l’élevage d’esturgeon dans des systèmes à recirculation d’eau.
Dans les étangs, l’élevage peut être pratiqué à une densité comprise entre 1,5 et 3 kg/m² sans oxygénation. On a enregistré des densités de 50 à 80 kg/m² si de l’oxygène supplémentaire est fourni. L’esturgeon de Sibérie résiste à des températures élevées (25-26 °C) à condition que deux précautions soient prises simultanément: absence d’aliments et fourniture d’un niveau élevé d’O2. Les esturgeons préfèrent l’ombre et évitent la lumière directe. La végétation submergée doit être évitée car elle peut piéger le poisson dans une masse d’algues.
Apport de nourriture
En Europe occidentale, les aliments utilisés sont principalement des granulés commerciaux souvent très proches de ceux adoptés dans la truiticulture. Les granulés extrudés présentent une meilleure stabilité dans l’eau et sont plus appropriés au comportement alimentaire de l’esturgeon. Les taux alimentaires en Europe occidentale dépassent rarement 1-1,5 pour cent de la biomasse. Ils sont même inférieurs à ces chiffres chez les plus grands individus. Des taux bien plus élevés (environ 4 pour cent) ont cependant été relevés dans la Fédération de Russie. En ce qui concerne l’élevage en étang, le lieu de distribution de la nourriture doit varier pour éviter l’accumulation de sédiments autour des zones de diffusion.
Techniques de récolte
Les poissons sont rassemblés au moyen de filets. Ils sont ensuite capturés avec une petite épuisette à mailles moyennes. Les plus gros individus sont attrapés à la main.
Manipulation et traitement
En ce qui concerne le caviar, les principales étapes de transformation sont les suivantes: sélection des femelles, conservation dans de l’eau courante quelques temps, assommage, éviscération, retrait des ovaires, refroidissement, examens de dépistage, rinçage, pesage, salage, séchage, conditionnement, étiquetage et conservation. Chaque étape est importante, la première (la sélection des femelles) étant la principale.
Maladies et mesures de contrôle
A l’heure actuelle, on ne relève pas de pathologie particulière associée à l’esturgeon de Sibérie. Cette espèce est cependant sensible à plusieurs bactéries [yersiniose, vibriose, et mycobactériose (désormais appelée flavobactériose)] Des traitements sont disponibles pour contrôler le développement de ces maladies et des vaccinations permettent d’entreprendre une action préventive. Au stade larvaire, une bonne gestion de l’alimentation permet de diminuer ces risques en prévenant le développement du cannibalisme. Un pourcentage très limité d’animaux présente des déformations pouvant éventuellement entraîner une perte de poids, des difficultés en matière d’alimentation et finalement la mort. L’origine de cette pathologie, qui n’est pas spécifique à cette espèce, reste inconnue.
STATISTIQUES
Statistiques de production
|
Production globale d’aquaculture de Acipenser baerii
(FAO Statistiques des pêches) 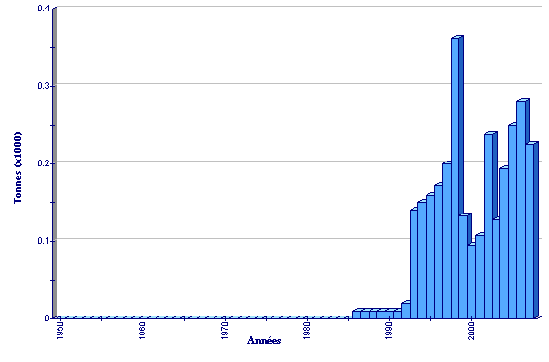
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹ espèce pure; ² espèce pure et hybrides; ³ hybrides
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché et commercialisation
Suivant les pays, les différents produits obtenus à partir de l’élevage d’esturgeon et commercialisés varient considérablement. Le poisson peut être vendu vivant (entre 1 et 2 kg en Chine), entier, en filets ou fumé. Alors qu’il existe un marché des œufs fertilisés et des alevins pour l’élevage, ces derniers sont également produits à des fins de repeuplement (Fédération de Russie) et pour l’aquariophilie. Enfin, les juvéniles sont utilisés pour l’empoissonnement des lacs afin de satisfaire la pêche sportive. Dans les pays d’Europe occidentale et d’Europe centrale, les exploitations piscicoles peuvent obtenir entre 3 et 4 EUR/kg pour des poissons dont la taille convient pour la consommation humaine. En Russie et en Chine, ces prix semblent être supérieurs (entre 8 et 11 EUR/kg).
SITUATION ET TENDANCES
Le marché international du caviar, estimé au cours des années 1980 entre 200 et 300 tonnes par an, semble avoir diminué à cause du manque d’intérêts de la part des transporteurs aériens. La concurrence entre les différents producteurs de caviar augmentera cependant à court terme.
PROBLÈMES ET CONTRAINTES MAJEURS
La vaste dispersion de l’esturgeon de Sibérie a eu pour conséquence que certains individus se sont échappés dans des zones très éloignées de leur habitat d’origine: la mer Baltique et la mer du Nord, le bassin formé de l’ensemble Gironde-Garonne-Dordogne en France et le Rio Negro en Uruguay. Il est intéressant de souligner que malgré le réempoissonnement intensif mis en place dans certaines zones de la mer Baltique au cours des années 1960, l’espèce ne semble pas s’y être établie. L’une des raisons de cet échec est sans doute la très grande facilité avec laquelle elle peut être capturée.
La construction de barrages, la surpêche et la pollution sont les principaux responsables de la détérioration des populations à l’état naturel qui sont considérées comme vulnérables ou en voie d’extinction. Plus globalement, la plupart des espèces d’esturgeons sont en danger et l’esturgeon de Sibérie ne fait pas exception.
L’esturgeon de Sibérie n’a pas une identité commerciale internationale très bien identifiée. Il entre en concurrence avec d’autres espèces d’esturgeons qui jouissent d’un plus grand potentiel de croissance et/ou d’une image commerciale bien établie.
La construction de barrages, la surpêche et la pollution sont les principaux responsables de la détérioration des populations à l’état naturel qui sont considérées comme vulnérables ou en voie d’extinction. Plus globalement, la plupart des espèces d’esturgeons sont en danger et l’esturgeon de Sibérie ne fait pas exception.
L’esturgeon de Sibérie n’a pas une identité commerciale internationale très bien identifiée. Il entre en concurrence avec d’autres espèces d’esturgeons qui jouissent d’un plus grand potentiel de croissance et/ou d’une image commerciale bien établie.
Pratiques pour une aquaculture responsable
De façon à préserver l’espèce et à protéger la production de celle-ci à partir des animaux cultivés, une forme de reconnaissance légale et un statut de l’élevage doivent être établis. L’esturgeon de Sibérie n’est une espèce indigène presque nulle part et, comme les réglementations qui encadrent l’élevage des espèces non indigènes varient d’un pays à l’autre, la concurrence est faussée.
RÉFÉRENCES
Bibliographie
|
Birstein, V.J., Bemis, W.E. & Waldman, J.R. 1997. The threatened status of acipenseriformes species: a summary. Environmental Biology of Fishes, 48:427-435.
Bronzi, P., Rosenthal, H., Arlati, G. & Williot, P. 1999. A brief review on the status and prospects of sturgeon farming in western and Central Europe. Journal of Applied Ichthyology, 15:224-227. Chebanov, M. & Billard, R. 2001. The culture of sturgeons in Russia: production of juveniles for stocking and meat for human consumption. Aquatic Living Resources, 14:375-381. Dettlaff, T.A., Ginsburg, A.S. & Schmalhausen, O.I. 1993. Sturgeon fishes. Developmental biology and aquaculture. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 300 pp. Gessner, J., Debus, L., Filipiak, J., Spratte, S., Skora, K.E. & Arndt, G.M. 1999. Development of sturgeon catches in German and adjacent waters since 1980. Journal of Applied Ichthyology, 15:136-141. Gisbert, E. & Williot, P. 2002. Advances in larval rearing of Siberian sturgeon. Journal of Fish Biology, 60:1071-1092. Ruban, G.I. 1997. Species structure, contemporary distribution and status of the Siberian sturgeon, Acipenser baerii. Environmental Biology of Fishes, 48:221-230. Sokolov, L.I. & Vasil'ev, V.P. 1989. Acipenser baerii Brandt, 1869. In J. Holcik (ed.), The freshwater fishes of Europe: general introduction to fishes acipenseriformes. AULA-Verlag Wiesbaden, Germany. pp. 263-284. Williot P. 2002. Reproduction. In R. Billard (coord.), Esturgeons et caviar, pp. 63-90. Lavoisier Tec & Doc, Paris, France. Williot, P. & Bourguignon, G. 1991. Production d'esturgeon et de caviar, �tat actuel et perspectives. In (P. Williot Ed), Acipenser, pp. 509-513. Cemagref Editions, Antony, Paris, France. Williot, P. & Sabeau, L. 1999. Elevage d'esturgeons et production de caviar: exemple de l'esturgeon sib�rien (Acipenser baerii) en France. Compte Rendu Acad�mie Agriculture de France 85(8), s�ance du 27 nov. 1999:71-83. Williot, P., Sabeau, L., Gessner, J., Arlati, G., Bronzi, P., Gulyas, T. & Berni, P. 2001. Sturgeon farming in Western Europe: recent developments and perspectives. Aquatic Living Resources, 14:367-374. |
