After outlining the current situation in Panama and the environmental challenges facing the government, this article highlights the potential positive impact of peri-urban agriculture on reducing the degradation of tropical rain forests and urban pollution. As peri-urban agriculture serves to ease the pressures of traditional agriculture on forest land, it is in fact a complementary activity to environmental protection policy (watershed and natural resource management, conservation of biodiversity) while at the same time subscribing to the national policy of agricultural modernization and intensification.
The specifics of peri-urban agriculture in a service economy such as that of Panama are emphasized and advantages of peri-urban agriculture are identified, including: i) reduced urban pollution; ii) a lower level of malnutrition; and iii) more employment. The author then goes on to show that peri-urban products are not in competition with rural products.
The article is directed towards decision-makers, donors, mayors and civil society and aims essentially to accelerate the implementation of policies that will maintain and develop employment-generation activities.
Tras una breve descripción de las condiciones actuales del Panamá y de los desafíos a los cuales tiene que hacer frente el Gobierno con objeto de conservar el medio ambiente, el autor pone de manifiesto los efectos positivos que podría tener el desarrollo de la agricultura periurbana en la reducción de la degradación de los bosques tropicales húmedos y de la contaminación de las ciudades. Puesto que dicha agricultura contribuye a reducir la presión que ejerce la agricultura tradicional sobre los terrenos forestales, constituye en realidad una actividad complementaria de las políticas de protección del medio ambiente (ordenación de las cuencas hidrográficas y de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad), en el marco de la política del país de modernización e intensificación de la producción agrícola.
La agricultura periurbana ofrece diversas ventajas: reduce la contaminación de las ciudades, la malnutrición y el desempleo. Se destacan en este artículo los aspectos específicos en un país con economía dominada por el sector terciario como el Panamá. Por último, se demuestra que los productos periurbanos no compiten con la producción rural.
Este texto está dirigido a las autoridades, los proveedores de fondos, las administraciones locales y la sociedad civil, a fin de acelerar la introducción de políticas de mantenimiento y desarrollo de actividades creadoras de empleo.
Mario Margiotta1
Spécialiste en cultures horticoles
Après une brève description du contexte actuel du Panama et des défis auxquels doit faire face le gouvernement en vue de la protection de l’environnement, l’auteur met en évidence les effets positifs que le développement de l’agriculture périurbaine pourrait avoir sur la réduction de la dégradation des forêts tropicales humides et de la pollution des villes. En effet, puisque l’agriculture périurbaine contribue à réduire la pression qu’exerce l’agriculture traditionnelle sur les terres forestières, elle constitue de fait une activité qui va de pair avec les politiques de sauvegarde de l’environnement (gestion des bassins versants et des ressources naturelles et conservation de la diversité biologique) tout en s’inscrivant dans le cadre de la politique locale de modernisation et d’intensification de la production agricole.
Sont également identifiés dans le présent article les avantages offerts par l’agriculture périurbaine, notamment la réduction de la pollution des villes, de la malnutrition et du chômage. On démontre aussi que les produits périurbains ne sont pas en concurrence avec la production rurale. Le présent article met en valeur les spécificités de l’agriculture périurbaine dans un pays à économie tertiarisée comme le Panama.
Ce document, qui s’adresse aux décideurs, aux bailleurs de fonds, aux maires et à la société civile, explique comment accélérer la mise en place de politiques de maintien et de développement d’activités génératrices d’emploi.
Quatrième pays d’Amérique centrale par sa superficie (75 517 km2), le Panama relie sur environ 750 km l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud. Grâce à son climat équatorial humide (pluviométrie allant de 1 000 à 7 000 mm par an), le pays est bien irrigué. Une végétation de type équatorial (forêts très denses) recouvre la côte atlantique et le golfe de Darién, alors qu’une végétation de type savane caractérise le côté pacifique; 43 pour cent de la superficie totale (3,35 millions d’hectares) sont constitués de forêts tropicales humides; 39 pour cent
(2,9 millions d’hectares) sont consacrés aux activités agricoles dont 50 pour cent à l’élevage, 25 pour cent aux formations boisées, 10 pour cent aux cultures temporaires et 5 pour cent aux cultures permanentes; les 10 pour cent restants sont laissés en jachère.
Contrairement aux pays voisins d’Amérique centrale, la structure économique du pays se caractérise par une forte participation du secteur tertiaire (les services représentant plus de 75 pour cent du PIB); le Centre bancaire international, le commerce, les activités libérales, le canal de Panama et la zone franche de Colón (entrepôt de marchandises destinées à la réexportation) constituent l’image de marque de cette économie.
Par contre, la participation des activités agropastorales (agriculture, élevage, pêche et chasse) dans le PIB est faible (de 10 pour cent pendant la période «protectionniste», elle est tombée à 8,3 pour cent) et ne cesse de diminuer sous l’effet des mesures de libéralisation commerciale.
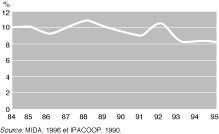
FIGURE 1
Evolution de la part de l’agriculture dans le PIB national de 1984 à 1995
Bien que la plus grande partie des terres agricoles soit cultivée selon les pratiques traditionnelles typiques de l’agriculture extensive (élevage extensif et agriculture itinérante sur formations boisées), l’agriculture intensive (qui ne concerne qu’une partie des terres destinées aux cultures permanentes et temporaires), assure l’essentiel de la production. La banane représente environ 30 pour cent du PIB agricole, l’aviculture 17 pour cent et le sucre 6 pour cent. La part de l’élevage (volailles, bovins et porcins) ne cesse d’augmenter (passant de 27 pour cent du PIB en 1980 à 29 pour cent en 1985, 31 pour cent en 1990 et 33 pour cent à l’heure actuelle).
Le Panama a longtemps pratiqué une politique favorisant les biens produits localement à un coût élevé, et ce au détriment d’importations meilleur marché. Le gouvernement a amorcé un changement d’orientation économique et entamé une série de réformes internes dans le contexte d’un renforcement du libre-échange. En vue de créer des emplois, le gouvernement suit aujourd’hui une politique de réorientation de l’économie dans le cadre de la globalisation, de modernisation du secteur public et de développement du secteur privé. Il favorise en outre les capacités d’exportation du pays moyennant une modernisation de l’agriculture et un renforcement du capital humain. Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé comme objectif de lutter contre la dégradation de l’environnement et contre la pauvreté.
La survie des ruraux les plus démunis dépendant de l’exploitation des ressources naturelles (forêts, agriculture itinérante et élevage extensif), nombre d’entre eux émigrent des régions les plus dégradées (Chiriqui, Coclé, Los Santos et Veraguas) vers les zones forestières (Darién, Bocas del Toro) ou urbaines (Panama et Colón surtout).
Ainsi, les migrations vers les zones forestières et les villes s’amplifient au détriment des régions du côté pacifique. En 10 ans, la population du Darién a augmenté de 65 pour cent, celle de Bocas del Toro de 75 pour cent et celle de Panama-Province de 32 pour cent.
Cet exode vers le front pionnier forestier de paysans et d’éleveurs chassés par le chômage, la pauvreté, ou le manque de terre participe à la dégradation du couvert végétal du Panama.
Plus qu’une stabilisation des flux migratoires actuels, les projections indiquent une confirmation de cette tendance à l’horizon 2015 (MIDA, 1997).
L’agriculture extensive est largement responsable de la dégradation du couvert forestier qui continue de diminuer: entre 1986 et 1992, quelque 300 000 ha de forêts ont disparu. Le PNUD (1996b) estime qu’environ 36 000 ha de forêts ont été détruits chaque année pendant la période 1980-1989; le MIPPE chiffre ce déboisement à 70 000 ha pendant la période 1986-1992 (MIPPE/CONAMA, 1996). Les provinces les plus affectées par la déforestation ont été celles de Colón, Chiriqui, Herrera et Los Santos, la moins touchée étant celle de San Blas.
Basée sur l’exploitation des ressources naturelles, l’agriculture itinérante (les pratiques agricoles basées sur les techniques de défriche-brûlis) et, surtout, la pratique de l’élevage extensif représentent pour le terroir un réel danger. En d’autres termes, puisque la majorité des systèmes traditionnels de production se base sur les techniques d’élevage extensif (pâturage forestier )2 ou de culture de sols après défriche-brûlis, les éleveurs et les agriculteurs brûlent le sous-bois, défrichent et cultivent la terre, puis l’abandonnent pour migrer vers des zones boisées encore intactes. L’interaction de la croissance démographique, de la coupe de bois d’œuvre et de l’extension du réseau routier entraîne le déboisement d’autres zones très vastes.
De 1980 à 1990, on a assisté, d’une part à une progression des terres agricoles (de 2,3 millions d’hectares en 1980 à environ 3 millions en 1990) au détriment du couvert forestier et, d’autre part, à une augmentation des terres destinées à l’élevage extensif (de 1,3 million d’hectares en 1980 à presque 1,5 million en 1990).
La dégradation forestière a une influence directe sur l’eau potable et l’énergie 3 (implication directe avec les bassins versants des fleuves alimentant les stations hydroélectriques et de pompage d’eau), sur l’avenir du canal (qui consomme une quantité d’eau annuelle équivalente aux besoins d’une ville de 11 millions d’habitants) et sur la production agricole à long terme.
A l’heure actuelle, 58 pour cent de la population active habite en zone urbaine (40 pour cent en 1960); près de la moitié des Panaméens se sont installés dans le couloir du canal (de Panama à Colón), attirés à la fois par le «canal de Panama» et par la «Zona Libre de Colón», et environ
70 pour cent de la population urbaine vit dans des villes de plus de 750 000 personnes.
Quant à la population rurale, elle ne cesse de diminuer passant de 48 pour cent en 1970, à 45 pour cent en 1980, à 43 pour cent en 1990 et, enfin, à 42 pour cent en 1992 4.
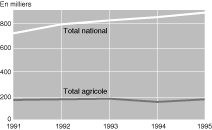
FIGURE 2
Evolution de l’emploi de 1991 à 1995
Les effectifs ruraux ont diminué passant de 187 000 en 1990 à 172 000 en 1995, et ce malgré l’augmentation totale (nationale) des demandeurs d’emploi pendant la même période: les effectifs totaux sont passés de 715 000 en 1990 à 868 000 en 1995, et ceux-ci sont, dans la majorité, des citadins.
Un tiers de la population du pays vit dans la seule ville de Panama. Un million de Panaméens (sur les 2,6 millions que compte le pays) habitent la capitale et environ 7 000 s’y installent chaque année (5 000 personnes en moyenne pendant la période 1980-1990). La ville connaît des taux de croissance de l’ordre de 2,9 pour cent par an (par rapport aux 2,3 pour cent de la période 1970-1975) alors que la population urbaine augmente de 2,4 pour cent par an et la population totale de 1,7 pour cent. Comparée à d’autres capitales de la sous-région, Panama détient le taux d’urbanisation le plus élevé. Seules La Paz et Saint-Domingue affichent des taux supérieurs.
Augmentation du chômage provoquée par l’urbanisation. Sur une population active d’un million de personnes que compte le pays, environ 14 pour cent sont officiellement au chômage (contre 7,3 pour cent pendant la période 1970-1979). Si aux chiffres officiels on ajoute les travailleurs en situation précaire et les personnes sous-employées, le nombre total de demandeurs d’emploi atteint 50 pour cent (MIPPE, 1996), dont 70 pour cent dans la zone métropolitaine.
L’urbanisation a eu, outre des implications démographiques (chômage et sous-emploi), des répercussions négatives sur l’environnement, les ressources et l’alimentation. Ainsi, l’augmentation du nombre d’installations spontanées et précaires 5 pose de plus en plus de problèmes sociaux aigus, tandis que l’augmentation du nombre de chômeurs a entraîné la paupérisation d’une majorité des populations urbaines à tel point qu’environ 40 pour cent de la population urbaine vit en deçà du seuil de pauvreté (PNUD, 1996a). D’après Barre (communication personnelle), «... les principaux problèmes rencontrés par la capitale sont: la marginalité, la pauvreté urbaine, les occupations de terrains (asentamientos espontáneos), l’absence d’hygiène, l’attraction sur les populations rurales, les transports, la pollution, la jeunesse délinquante... La grande difficulté pour gérer Panama réside dans la centralisation de trop nombreuses activités par les différents institutions, laissant la municipalité sans moyens d’agir directement sur les problèmes qui se posent».
Conséquence de l’urbanisation sur la pollution des villes. En matière d’approvisionnement, le plus grand problème pour Panama-Colón est lié à l’évacuation des 100 000 tonnes de déchets (ménagers, des marchés communaux, des brasseries et des agro-industries) par an. Ramassés à 70 pour cent (CEASPA, 1997) et actuellement déversés dans des terrains vagues en périphérie ou dans les rivières, ils entraînent pour les collectivités urbaines un coût croissant d’évacuation et de traitement. Le manque de systèmes de classification et de recyclage aggrave encore la pollution et empêche toute réutilisation.
L’absence d’un système adéquat d’évacuation des déchets solides, la faible extension du réseau d’égouts, l’insuffisance de stations d’épuration sont les principales causes de la dégradation environnementale et de la pollution de la frange littorale de la Bahia de Panama. Les 40 millions de tonnes d’eaux usées déversées chaque année dans la Bahia (qui est, du reste, plus vivante et productive que la haute mer) génèrent une pollution organique (par manque d’oxygène) et bactérienne (risque pour les baignades et la consommation de coquillages) par des agents coliformes.
L’agriculture itinérante et l’élevage sur pâturages forestiers sont les seules techniques adaptées aux stratégies d’autosubsistance des paysans les plus pauvres (qui, de ce fait, n’ont pas besoin de recourir à l’achat d’intrants et au labour). Irremplaçables pour la petite paysannerie, ces techniques sont les seules compatibles avec les faibles moyens financiers de nombreux agriculteurs et éleveurs panaméens.
Néanmoins, elles contribuent à la dégradation des forêts du Darién, de Colón et de San Blas et à entraîner une destruction rapide de la végétation sur les versants orientaux et occidentaux du pays (front pionnier forestier). Chaque année, une superficie importante de forêts et de formations boisées souffre des brûlis répétés, du surpâturage et de la surexploitation en général (notamment pour le bois de feu).
Cette détérioration serait davantage imputable à la présence humaine qu’aux défrichements répondant aux besoins en nouvelles terres. Cette distinction est essentielle dans la mesure où contrairement aux défrichements impliquant une perte définitive du couvert boisé, les terres abandonnées par l’agriculture et l’élevage (jachère forestière) permettent la recrudescence des forêts secondaires.
Lorsque la pression de la population sur la terre est élevée, et que les agriculteurs et les éleveurs n’arrivent plus à tirer profit de ces pratiques traditionnelles (ceci en fonction de la fertilité des sols), ils émigrent à la recherche de nouvelles terres ou alors, chassés par la dégradation des forêts, le chômage, la pauvreté et le manque de terre, ils sont contraints d’émigrer en ville. Là, un chômage croissant repousse les ruraux vers les ressources forestières, accélérant ainsi la dégradation environnementale (CEASPA, 1997).
Que faire pour arrêter ce cercle vicieux? Conscient de l’impact de la dégradation forestière sur l’avenir du pays, le gouvernement a donné priorité à deux types d’interventions. D’une part, il envisage la réalisation de projets concernant la protection des ressources naturelles, la foresterie sociale, la gestion de bassins versants et la conservation de la biodiversité; d’autre part, il finance des programmes de modernisation et d’intensification de l’agriculture (passage de l’agriculture extensive à l’agriculture intensive).
En effet, les interventions actuelles, basées sur les approches traditionnelles axées sur les «subventions», les préoccupations locales, la participation populaire, le développement forestier durable, le développement communautaire durable, le développement rural durable, l’agroforesterie et la gestion durable des ressources forestières n’ont donné que des résultats faibles. Par exemple, en 15 ans, seuls 15 000 ha ont été reboisés malgré les moyens importants mis à disposition par plusieurs bailleurs de fonds et les avantages offerts par la Loi 24 de 1992 sur la reforestation. Cette loi semble avoir entraîné une répartition inégalitaire de la terre agricole au profit des grands exploitants privés qui ont acquis de nouvelles parcelles afin de toucher les subventions gouvernementales (crédits à taux préférentiels et facilitations pour l’achat des terres et des équipements). Indirectement cette loi semble avoir accéléré le processus de défrichement au niveau de la petite paysannerie en contraignant les agriculteurs les plus pauvres à se déplacer vers de nouveaux sites à la recherche de nouvelles terres à défricher.
Malgré ces efforts, on peut redouter que, dans le contexte actuel (augmentation de la pauvreté, inégalités sociales et pression accrue sur le couvert végétal), la dégradation forestière s’accentue, d’autant plus que les politiques actuelles de dérégulation et les mesures d’ajustement structurel en cours ont des effets négatifs sur les revenus et salaires agricoles et renforcent la dépendance des populations rurales vis-à-vis des ressources naturelles.
De nombreuses questions demeurent sans réponse, en particulier:
En attendant de trouver des réponses à ces questions, on envisage de développer: i) des cultures et des techniques permettant de réduire la pression exercée par l’agriculture traditionnelle sur les terres forestières; et ii) des cultures susceptibles de fournir un revenu acceptable aux chômeurs des villes, c’est-à-dire des cultures plus rentables que l’agriculture itinérante ou l’élevage extensif, et donc des cultures à forte intensité de main-d’œuvre. C’est le cas pour l’horticulture, la floriculture, l’aquaculture et l’élevage intensif pratiqués à proximité des marchés de consommation. En un mot, c’est le cas de l’agriculture périurbaine.
|
Panama |
2,9 |
|
|
Caracas |
1,3 |
|
|
Mexico |
0,7 |
|
|
San José |
2,9 |
|
|
Buenos Aires |
0,7 |
|
|
Montevideo |
0,6 |
|
|
Santiago |
2 |
|
|
Bogotà |
2,9 |
|
|
São Paolo |
2 |
|
|
La Havane |
1,1 |
|
|
Saint-Domingue |
3,2 |
|
|
Lima |
2,8 |
|
|
La Paz |
3,6 |
|
|
Guatemala |
2,3 |
L’agriculture périurbaine englobe des activités diverses qui vont de l’aquaculture à l’élevage et de l’horticulture à l’agroforesterie. Certaines activités sont concentrées en zone périurbaine (élevage), alors que d’autres sont pratiquées dans le tissu urbain même des villes (floriculture et cultures maraîchères); d’autres encore sont directement liées aux spécificités des villes (l’aquaculture dépend de la présence d’étangs, de ruisseaux, d’estuaires, de lagons, tandis que l’agroforesterie se pratique davantage en présence de ceintures vertes, de parcs et de forêts).
Malgré l’importance et la diversité de ces produits d’origine intra- et périurbaine autoconsommés ou commercialisés (divers documents soulignent le rôle que ces cultures jouent dans l’approvisionnement des grandes capitales sud-américaines et africaines), il est difficile, faute d’études spécifiques sur ce sujet, d’en chiffrer les quantités, Panama n’échappant pas à cette règle.
Aujourd’hui, de nombreux producteurs, basés sur des parcelles périurbaines approvisionnent les petits marchés de quartier de la capitale (Ampuero, 1996) en produits de la pêche6, de l’aquaculture, de l’élevage (lait frais), en fleurs et plantes d’appartement et en légumes.
L’agriculture périurbaine permet de réduire la pression sur le front pionnier forestier et, de ce fait, la dégradation forestière. Elle permettrait en effet de réduire la pression exercée par les agriculteurs et éleveurs sur les forêts et représenterait une solution de sauvegarde des forêts et de la fertilité des sols. Elle pourrait également seconder les politiques de protection de l’environnement (gestion des bassins versants et des ressources naturelles et conservation de la diversité biologique), tout en s’inscrivant dans le cadre de la politique actuelle de modernisation et d’intensification de la production agricole.
L’agriculture périurbaine permet de réduire la pollution dans les villes. Elle permettrait, en effet, de recycler les ordures ménagères et les déchets des villes (des marchés communaux, des brasseries, etc.). Les ordures et les déchets compostés sont particulièrement bien adaptés aux exigences d’une agriculture périurbaine (horticulture biologique et aquaculture).
L’agriculture périurbaine répond aux politiques actuelles du gouvernement basées sur l’intensification de l’agriculture et de l’élevage. Elle pourrait bénéficier de la récente politique de développement municipal en cours dans le pays. Enfin, elle rejoint les défis majeurs auxquels doit faire face actuellement le gouvernement, à savoir:
De nombreuses conditions sont réunies pour que l’agriculture périurbaine se développe au Panama, notamment:
Aujourd’hui, l’agriculture périurbaine joue un rôle important au Panama, car elle permet: i) de développer une production pour une consommation supplémentaire; ii) de réduire les marges et les prix car ces produits, destinés aux marchés de quartier, ne requièrent pas d’emballage et sont vendus directement par les producteurs sans frais supplémentaires de transport; iii) d’obtenir de petites quantités journalières de produits frais contribuant ainsi à l’amélioration du régime alimentaire de la population; et iv) de réduire le chômage dans les grandes ville en créant des activités pour une population décidée à demeurer en ville.
L’agriculture rurale, quant à elle, est déjà spécialisée dans des produits destinés à l’agro-industrie (par exemple tomates) ou à l’exportation (bananes, café et canne à sucre), le succès de son développement étant bien sûr étroitement lié aux investissements dans les secteurs des infrastructures (routes et moyens de transport) et de l’emballage.
En limitant la pression exercée par l’agriculture traditionnelle sur les terres forestières, le développement de l’agriculture périurbaine pourrait avoir des effets positifs sur l’environnement et constituer, de fait, une activité allant de pair avec les politiques de protection de l’environnement (gestion des bassins versants et des ressources naturelles et conservation de la biodiversité).
Le développement d’espèces à forte intensité de main-d’œuvre et à valeur marchande élevée permettrait à l’agriculture périurbaine de faire partie intégrante du plan de modernisation et d’intensification de la production agricole du Panama, rejoignant ainsi la politique actuelle du gouvernement.
Le fait que le développement d’activités agricoles en milieu périurbain permette l’utilisation durable des ordures ménagères et des eaux recyclées (qui créent de nombreux problèmes d’évacuation et de pollution dans les villes et qui sont actuellement déversées dans la bahia de Panama) rejoint l’actuelle politique de protection de l’environnement du gouvernement. De plus, des activités rentables en milieu périurbain justifieraient les investissements consacrés au recyclage des eaux usées en augmentant le coût d’opportunité de l’eau (c’est-à-dire le prix que les usagers seraient disposés à payer).
Bien évidemment, il ne s’agit pas de créer des activités susceptibles d’attirer les ruraux dans les villes, mais plutôt de donner une occupation à ceux qui sont déjà venus augmenter les effectifs d’une population à nourrir, et qui posent des problèmes sociaux de plus en plus aigus. En d’autres termes, il ne s’agit pas de développer une production périurbaine au détriment de la population rurale, mais de donner une possibilité de travail aux ruraux les plus démunis, contraints à abandonner des régions dont les ressources naturelles ne suffisent plus pour la pratique d’une agriculture itinérante.
Indépendamment d’une volonté politique, l’agriculture périurbaine se développera sous la pression des mesures de libération du commerce (qui pénalise la production de produits frais loin des centres de consommation). En effet, les faibles coûts de commercialisation, la bonne diffusion de l’information parmi les opérateurs, l’accès à des sources de matière organique diversifiée et bon marché (ordures ménagères et déchets des agro-industries), les marchés potentiels et surtout leur proximité (approvisionner en produits frais les 15 000 bateaux qui traversent chaque année le canal), la présence de bonnes terres et d’eau d’irrigation, sont les principaux aspects positifs qui faciliteront le développement de l’agriculture périurbaine. Cette dernière est donc appelée à jouer un rôle clé dans l’approvisionnement des villes. Plutôt que d’adopter des mesures visant à encourager son développement, on devrait étudier les possibilités d’en assurer la durabilité.
Ampuero, R.L.A. 1996. Comercialización de productos agropecuarios. IMA, Panama.
CEASPA. 1997. Panama: Evaluación de la Sostenibilidad Nacional. Panama.
Ciparisse, G. 1997. Dynamiques foncières et agriculture en zones périurbaines. Eléments pour un débat sur de «nouvelles frontières» en Afrique de l’Ouest. FAO, Rome.
FAO. 1997. Villes d’Amérique latine: proposition pour le développement de l’horticulture urbaine et périurbaine. Par W. Baudoin et M. Margiotta. Réforme agraire, 1997/2: 47-50. Rome.
Margiotta, M. 1995. Développement de la production maraîchère dans les ceintures vertes de Libreville. FAO, Rome.
Margiotta, M. 1996. Développement de la production maraîchère dans les périmètres urbains et périurbains de Nouakchott. FAO, Rome.
Margiotta, M. et al. 1996. Stratégies et plan d’action pour le développement de l’horticulture urbaine et périurbaine au Zaïre. FAO, Rome.
Margiotta, M. 1997a. Le rôle de l’horticulture urbaine et périurbaine dans l’approvisionnement des villes de Kinshasa, Libreville et Nouakchott. FAO, Rome.
Margiotta, M. 1997b. Agriculture périurbaine et Systèmes d’approvisionnement et de distribution alimentaire (SADA) dans les villes d’Afrique francophone. FAO, Rome.
MIDA. 1997. Logros trascendentales de las instituciones del sector público agropecuario durante los tres años de gobierno del doctor Ernesto Pérez Balladares. Panama.
MIPPE. 1996. Statistiques du Ministère de la planification et de la politique économiques. Panama.
MIPPE/CONAMA. 1996: Informe ambiental de Panamá – Perfil Nacional. Panama.
Moustier, P. 1990. Dynamique du maraîchage périurbain en Afrique subsaharienne. Etudes de cas pour un meilleur diagnostic de l’approvisionnement vivrier des centres urbains. Labo. agro-éco. no 8, CIRAD/IRAT, Montpellier.
Moustier, P. et David, O. 1996. Dynamique du maraîchage périurbain en Afrique subsaharienne. CIRAD/FLHOR, Montpellier, France.
PNUD. 1996a. Urban agriculture: food, jobs, and sustainable cities. Par J. Smit, A. Ratta et
A. Nasr. Série Habitat II. City Farmer, New York.
PNUD. 1996b. Rapport mondial sur le développement humain. New York.
---------------
1 Courrier électronique: [email protected]
2 En opposition à l’élevage extensif pratiqué en Argentine, au Brésil et au Mexique, le système panaméen devrait plutôt être appelé élevage sur pâturages forestiers. La forêt claire est défrichée pour permettre le pâturage et, dans une moindre mesure, pratiquer des cultures itinérantes. L’élevage dépend donc des ressources forestières et son développement entraîne la dégradation du couvert forestier.
3 Le pays dépend à environ 70 pour cent de l’énergie hydroélectrique. La production d’énergie thermique, c’est-à-dire l’énergie obtenue par combustion à partir de pétrole importé, ne satisfait que 10 pour cent de la consommation totale énergétique. Les autres sources d’énergie sont le bois (15 pour cent environ) et le charbon (2 pour cent).
4 Censos nacionales de población y vivienda. Contraloría general.
5 En 1994, on comptait 116 asentamientos espontáneos ou subnormales dans la seule ville de Panama.
6 Plus de 40 pour cent des pêcheurs artisanaux (12 000 au total en 1995) sont concentrés dans la seule province de Panama.
7 Depuis trois ans, le transit y a augmenté sensiblement, ce qui semble amorcer une tendance durable liée à l’augmentation des échanges internationaux: intensification des échanges entre les pays de l’Asie et les Etats-Unis, entre l’Asie et l’Europe et montée en flèche du commerce extérieur des pays émergents de l’Amérique du Sud (le Chili à lui seul compte pour 7 pour cent des marchandises transistant par le canal).
8 La région interocéanique, qui s’étend sur près de 94 000 ha (5 pour cent du territoire du Panama), compte environ 7 000 bâtiments comprenant des aéroports, des ports, des écoles, des logements, des hangars, des hôpitaux et des terrains de sport et de golf, et des piscines. De fait, les anciennes bases américaines constituent un tissu urbain possédant des infrastructures demandant toutefois à être complétées ou modifiées selon les usages qu’on leur destinera. L’ARI s’est fixé un plan pour trouver une utilisation économiquement rentable aux biens fonciers et immobiliers, et a retenu quatre secteurs principaux: le secteur maritime, le secteur industriel, celui du tourisme et le parc technologique de «Ciudad del Saber».