G.D. Piearce
G.D. Piearce travaille à la Division de la recherche forestière à Kitwe (Zambie). Cet article est adapté d'une communication présentée à la réunion de la Commonwealth Forestry Association tenue en septembre 1985 à Victoria, Colombie britannique (Canada).
TECK DU ZAMBÈZE - il faut agir dès maintenant
|
Le déclin des forêts de teck du Zambèze s'est poursuivi lentement mais régulièrement au cours de ce siècle. Ce n'est que maintenant que la communauté forestière internationale pressent le risque de voir disparaître une ressource irremplaçable si rien n'est fait pour l'empêcher. Mais que peut-on faire? Dans cet article, G.D. Piearce suggère quelques solutions, dont certaines non conformistes. Le plus important, affirme-t-il, est d'agir dès maintenant et de trouver l'argent pour le faire. |
Les forêts de teck du Zambèze se trouvent en Afrique australe dans la région couverte par des formations dites «des sables du Kalahari». Elles ont connu au cours de ce siècle une réduction considérable de leurs surfaces et une forte dégradation, dues presque entièrement aux interventions humaines. Ce qu'il en reste conserve une grande importance économique, scientifique et sociologique, mais leur disparition est imminente si rien n'est fait pour arrêter l'exploitation intensive et les feux dévastateurs. Ni la régénération naturelle ni la régénération artificielle n'ont pu suivre le rythme de destruction des dernières décennies.
|
Une affirmation controversée est que la régénération naturelle est la seule voie logique et praticable pour restaurer les forêts de teck du Zambèze. |
Diverses initiatives locales, nationales et internationales ont été proposées et commencent à être mises en œuvre en Zambie, dans le but de répondre aux besoins urgents de conservation, de recherche et de méthodes de traitement sylvicole. Un obstacle majeur est le tragique manque de fonds à un moment où les forêts elles-mêmes sont soumises à une pression croissante visant à les exploiter pour en tirer des recettes au profit d'autres projets de développement. Un facteur décisif sera d'encourager la participation active des habitants aux opérations forestières.
«Teck du Zambèze» (Zambezi teak) est le nom communément employé de nos jours pour désigner l'umgusi, que l'on a aussi appelé African teak, Rhodesian teak, Zambian teak, Zambezi redwood. C'est l'un des meilleurs bois durs du monde. Il est totalement distinct, botaniquement et anatomiquement, du teck véritable (Tectona grandis L.), originaire de l'Asie du Sud-Est et largement utilisé en reboisement dans d'autres régions des tropiques (Shikaputo, 1986), bien que ses propriétés technologiques soient comparables.
Le mukusi, comme on l'appelle localement, est une césalpinée dont le nom scientifique est Baikiaea plurijuga Harms. Son aire naturelle est restreinte aux sables du Kalahari, dans le sud-ouest de la Zambie, et aux régions voisines de l'Angola, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe. Les meilleurs peuplements subsistants du type unique de forêt dans lequel on le rencontre se situent en Zambie, dans le district de Sesheke, bien que l'on trouve sur une plus vaste zone des provinces occidentale et méridionale des taches relictes occupées principalement par la forêt claire à Baikiaea, forme dégradée de la forêt primitive (voir Fanshawe, 1971; et Edmonds, 1976, qui présentent la carte de végétation la plus récente). Les forêts de cette région se caractérisent donc par la présence de B. plurijuga comme principal élément du couvert végétal. Huckabay (1986) donne une description succincte de l'essence et des forêts qui la contiennent.
L'importance des forêts à Baikiaea en Zambie est essentiellement de trois ordres. Tout d'abord, ces forêts sont importantes économiquement, parce que B. plurijuga et certaines des essences associées fournissent les bois commerciaux les plus précieux du pays. Il s'exerce une forte pression sur les forêts que l'on tend à exploiter jusqu'à épuisement, tant pour répondre à la demande intérieure que pour se procurer des devises par l'exportation des bois.
En second lieu, ces forêts présentent un grand intérêt scientifique, éducatif et esthétique par la richesse de leur flore et de leur faune. Leur disparition réduirait la région à un prolongement du désert de Kalahari. D'où la nécessité impérieuse et urgente d'assurer la conservation des génotypes et de l'écosystème pour le bien des générations futures.
Sociologiquement, enfin, alors que des questions telles qu'exploitation commerciale et conservation des forêts sont plutôt l'affaire de gens venus de l'extérieur, les habitants des régions où l'on trouve le teck de Zambie ont une conscience plus directe, quoique parfois ambiguë, de l'importance de leur environnement naturel. En Zambie, plus qu'ailleurs sans doute, les populations locales sont tributaires de la forêt pour leur bienêtre et leur subsistance. La forêt répond à leurs besoins immédiats de bois de feu et de matériaux de construction, et les industries qu'elle alimente sont d'importantes pourvoyeuses d'emploi, et donc un facteur de prospérité et de développement. Par ailleurs, la pression démographique croissante suscite une demande toujours plus grande de terres agricoles, qui sont exploitées selon le système traditionnel de culture itinérante, lequel occasionne de gros ravages.
Ces facteurs contradictoires ont gravement perturbé un écosystème essentiellement délicat, tandis que depuis le début du siècle la balance penche très nettement en faveur d'une exploitation anarchique par l'homme. Les forêts ont été coupées à un rythme bien supérieur à celui auquel elles peuvent se régénérer. Une intervention énergique s'impose pour renverser cette tendance, en admettant qu'il ne soit pas trop tard.
Les forets de teck du Zambèze ont été le sujet d'une conférence tenue en mars 1984 à Livingstone (Zambie), au cours de laquelle ont été examinés les multiples problèmes que posent leur préservation et si possible la restauration de leur productivité soutenue. Les participants ont refusé à l'unanimité de les considérer comme une ressource minière non renouvelable et ont formulé un plan d'action intégré pour leur restauration.
L'état d'esprit actuel en Zambie à ce sujet est un optimisme réserve, partagé à l'extérieur par les chercheurs et administrateurs forestiers qui jusque-là étaient peu au courant de la situation de ces forêts.
UNE SCIERIE DE TECK DANS LES ANNÉES 40 - l'offre a diminué
TECK DU ZAMBÈZE - inflorescence de Baikiaea plurijuga
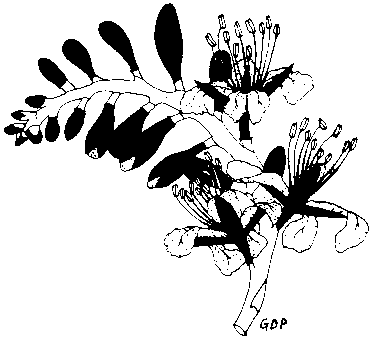
C'est l'explorateur David Livingstone qui, à côté d'exploits plus connus, a incidemment fait connaître au monde extérieur, en 1857, la région du teck du Zambèze. Un de ses compagnons de la grande expédition du Zambèze, John Kirk, fut le premier à récolter des spécimens botaniques de B. plurijuga, vraisemblablement en 1860, aux alentours de Sesheke, mais ce n'est qu'en 1903 que l'espèce fut nommée et décrite scientifiquement (Brummitt, 1986). Son exploitation commerciale débuta vers la même époque.
Tronçon du grand projet de liaison Le Cap-Le Caire, la voie ferrée venant du sud atteignit en 1902 les chutes de Victoria, où le pont sur le Zambèze fut ouvert en 1905; elle avait été prolongée jusqu'au «Copper belt» de Rhodésie du Nord (Zambie) lorsque la première mine de cuivre commença à produire, en 1910. On découvrit bien vite les possibilités qu'offrait le teck du Zambèze pour les traverses de chemin de fer, tant en surface que sous terre dans les mines.
La première exploitation mentionnée se situait en Rhodésie du Sud (Zimbabwe) en 1908 (Judge, 1986), et la première scierie entra en activité en Rhodésie du Nord, à Livingstone en 1911. Les forêts de la région de Livingstone se trouvèrent épuisées vers la fin des années 20, et les chantiers forestiers se déplacèrent vers l'ouest pour la construction du fameux chemin de fer de Mulobezi, la voie ferrée privée la plus longue du monde (Calvert, 1986a).
A cette époque, qui vit la naissance du Service forestier de Rhodésie du Nord, les activités forestières organisées étaient pratiquement synonymes d'exploitation du teck du Zambèze. Les études générales les plus anciennes publiées sont celles de Stevenson (1931) et de Martin (1932, 1940), auxquelles on peut ajouter l'article de Miller (1939) sur les forêts du Bechuanaland (Botswana).
Ce fut Martin, premier fonctionnaire forestier en poste au Barotseland (maintenant Western Province), qui en 1931 introduisit l'aménagement ordonné des forêts de teck du Zambèze. Il joua un rôle décisif en rédigeant un certain nombre de permis réglementant l'abattage et prescrivant des mesures de protection contre le feu et de reboisement dans les zones de concession. Ce fut lui également qui élabora les Ordonnances forestières du Barotseland de 1936, qui furent par la suite adoptées comme lois forestières nationales et fournirent le fondement du Forest Act en vigueur depuis 1973.
BUISSON DE MUTEMWA DANS UNE FORÊT DE TECK - des risques d'incendie
Aux premiers temps de l'exploitation des forêts de teck du Zambèze, le diamètre minimal d'abattage était de 45 cm, et l'on trouvait des arbres dont le diamètre excédait 100 cm. Aujourd'hui, on coupe des tiges bien plus petites (de 25 à 54 cm de diamètre), et on en trouve très peu de taille supérieure. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et donnent une idée du déclin de l'essence.
Cinq scieries exploitent actuellement ces forêts en Zambie. Trois appartiennent à des particuliers, et les deux autres, à Mulobezi et à Sesheke, sont gérées par la société semi-publique Zambezi Sawmills, qui est de loin l'entreprise la plus importante. Les taux de conservation mentionnés varient entre 25 et 45 pour cent. La plus grande partie de la production, formée de bois de cœur, est transformée en traverses pour les chemins de fer de Zambie et Tanzanie et pour les mines. Une faible proportion de bois de cœur plus aubier est utilisée pour la fabrication de frises à parquet, qui pourraient devenir le principal produit d'exportation.
Le montant des ventes ces dernières années avoisine 1,5 million de kwacha (environ 1 million de dollars U.S.) par an, dont 80 pour cent représentés par le marché intérieur et 20 pour cent par l'exportation. Rien qu'en taxes forestières, l'Etat a encaissé prés de 350000 dollars au cours de la période 1979-1983.
Toutefois, les entreprises commerciales ne représentent qu'environ 25 pour cent du volume total extrait, qui à l'heure actuelle est estimé à 500 000 m3 par an. Au moins la moitié de ce volume sert à des fins domestiques. Le quart restant correspond aux défrichements agricoles et aux destructions par le feu.
Les réserves actuelles de bois exploitable sont estimées à environ 28 millions de m3. Si les tendances actuelles se maintiennent, ces foréts disparaîtront dans les 50 années à venir, et elles sont condamnées à être irrémédiablement appauvries dans un délai beaucoup plus bref.
Le mukusi se caractérise par une écorce mince, et il est de ce fait extrêmement sensible au feu. Les forêts primaires ne sont pas particulièrement inflammables, mais elles le sont devenues sous l'effet des perturbations dues à l'homme. A la suite de l'exploitation, les résidus de coupe et la végétation ligneuse et herbacée qui colonise les trouées accroissent considérablement les risques d'incendies. Ces derniers sont invariablement allumés par l'homme.
Les effets les plus graves sont ceux dus aux feux tardifs qui surviennent vers septembre-octobre, à la fin des sept mois de saison sèche. C'est la période la plus chaude de l'année, et il y a souvent du vent. Ces conditions météorologiques, alliées à l'accumulation de combustibles très inflammables, engendrent des feux intenses, progressant à une vitesse qui peut atteindre 16 m par minute avec des flammes allant jusqu'à 15 m de hauteur. Les arbres sont alors extrêmement sensibles au feu, car ils commencent à débourrer et s'apprêtent à disperser leurs fruits et leurs graines en prévision des pluies prochaines. Un seul feu tardif, même dans une forêt non perturbée, surtout s'il endommage fortement les cimes des arbres, accroît le danger de feux ultérieurs en amorçant un processus de dégradation de l'étage principal et en favorisant la pousse de sous-bois. C'est ainsi que des feux tardifs répétés ont des effets graves et cumulatifs.
Bien que ces effets aient été pleinement reconnus et qu'on ait pris quelques mesures pour les combattre dans les années 20 et 30, Martin (1940) notait que le «lacis de zones brûlées s'étendant à travers la forêt occupe de 20 à 50 pour cent de la surface totale». Wood (1986) cite l'opinion de Watson selon laquelle la moitié ou les deux tiers des forêts de mukusi auraient été détruits par le feu dans les 30 années qui ont précédé 1950.
Les actions de protection contre le feu furent intensifiées entre 1945 et 1965, avec l'ouverture de réseaux de pare-feu et la pratique des brûlages périphériques, alliées à une meilleure organisation de la détection et de la lutte. Plus récemment, la protection contre le feu a pris le pas sur tous les autres travaux forestiers, mais malgré cela les feux tardifs ont détruit une moyenne de 1 600 ha par an depuis 1965 (Zimba, 1986).
Les principales causes des incendies récents sont les feux non contrôlés allumés par les agriculteurs, les chasseurs et les récolteurs de miel. Une autre cause est la mise à feu volontaire par malveillance, notamment par des gens qui préféreraient utiliser les terres boisées pour l'agriculture et voient dans la destruction par le feu un moyen de parvenir à leurs fins. Comme la population de la région doublera sans doute dans les 30 années à venir (Wood, 1986), il est peu probable que cette attitude se modifie à moins qu'on ne lance une campagne d'éducation intensive.
Une protection totale contre le feu est chose impossible. En 1978, la Zambie s'orienta vers le brûlage précoce. Cette mesure préventive a deux avantages principaux: tout d'abord, les feux dirigés allumés au début de la saison sèche - généralement en avril-mai - sont un bon moyen pour réduire le volume de combustible, et en second lieu, s'ils sont pratiqués annuellement de manière convenable, ils se ramènent à un brûlage par placettes, de faible intensité, à une époque où les arbres entrent en repos végétatif, de sorte que la régénération n'est pas affectée.
Toutefois, cette pratique n'équivaut pas à l'emploi du feu comme outil sylvicole. Une limitation importante, faute de fonds suffisants, reste le manque de main-d'œuvre, d'équipements et de moyens de transport nécessaires pour le brûlage précoce à grande échelle, l'entretien des pare-feu pour servir de voies d'accès et la lutte proprement dite. Autre problème, la compétence requise pour mener à bien les opérations de brûlage précoce. Comme le sulignent Calvert (1986b, 1986c) et d'autres auteurs, le responsable doit savoir apprécier le moment optimal de l'opération en fonction de l'état général de la végétation, de la masse de combustible présente et des conditions météorologiques.
On a proposé d'autres méthodes possibles pour réduire la masse de combustible, telles que le pâturage de bovins selon le système en usage au Zimbabwe, mais celui-ci est moins facilement applicable en Zambie dans les zones éloignées des points d'eau. Dans ce cas, moyennant des ressources suffisantes, il est techniquement possible de protéger dans une large mesure les forêts de mukusi subsistantes contre les feux dévastateurs par le brûlage précoce. Mais savoir que faire sur les surfaces plus vastes qui ont déjà été brûlées est une autre chose.
Un feu tardif intense détruit entièrement l'étage principal de mukusi, et les trouées qui en résultent sont rapidement envahies par des fourrés de végétaux arbustifs et sarmenteux, notamment Acacia ataxacantha DC., Dalbergia martinii F. White, et divers Combretum spp. Ces formations de fourrés denses, désignées sous le nom de mutemwa, tendent à devenir prédominantes dans le sous-étage des forêts de mukusi, sous l'effet non seulement du feu mais aussi des autres causes de perturbation. En de nombreux endroits, cette végétation est pratiquement impénétrable, ce qui accroît encore le danger d'incendie. En outre, le mutemwa oppose des obstacles sérieux à la régénération du mukusi.
|
La FAO assiste la Zambie dans la création de réserves génétiques Baikiaea plurijuga est l'une des essences retenues par le Groupe FAO d'experts des ressources génétiques forestières comme nécessitant une action urgente. Vers le milieu des années 70, le Département des forêts de la FAO a aidé la Service forestier de Zambie à constituer in situ de cette essence. Ces réserves, établies dans le cadre du Projet FAO/PNUE de conservation des ressources génétiques forestières, sont situées à Malavwe et à Kataba, dans la province occidentale de Zambie. Leur surface est de 31,6 et 4,0 ha respectivement. Ce sont, semble-t-il, les premières réserves dans le monde qui aient été créées avec pour objectif spécifique la conservation in situ de la variation génétique intraspécifique d'une essence forestière. Cependant, pour conserver intégralement la variation de l'essence, il faudrait établir d'autres réserves. Des inventaires botaniques complets ont été effectués dans les deux réserves, et par la suite des études biologiques et phénologiques y ont été menées avec l'assistance de l'Agence suédoise d'aide au développement international. On trouvera une description détaillée de ces réserves, en même temps que le compte rendu d'autres activités, dans le Rapport final du Projet FAO/PNUE de conservation des ressources génétiques forestières (FAO, Rome, 1985). Christel Palmberg |
De nombreux facteurs écologiques interdépendants ont aggravé le déclin des forêts teck du Zambèze en Zambie (Chisumpa, 1986; Malaya, 1986; Mbughi, 1986; Greenwood, 1986). Le mukusi ne rejette pas bien de souche, de sorte que la régénération se fait surtout par semis, mais dés le départ elle se heurte à de grandes difficultés. La floraison et la fructification des portegraines sont capricieuses, et il n'y a une bonne année de semence que tous les trois ou quatre ans. Les gousses encore vertes sont très appréciées par les ânes et les babouins, dont une troupe peut dépouiller un arbre en une demiheure (Calvert, 1986d). Une grande partie des graines qui atteignent le sol est consommée par les rongeurs et autres petits animaux, notamment au stade de prégermination lorsqu'elles sont gonflées et succulentes. Les jeunes semis sont également attaqués par ces mêmes animaux et par des mammifères de plus grande taille, en particulier les antilopes telles que la céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia L.), qui broutent les feuilles et les tiges et arrachent les racines. D'autre part, le mutemwa empêche la croissance des jeunes plants qu'il concurrence âprement pour la lumière et l'eau, outre le fait qu'il abrite des animaux nuisibles.
Comment, dans ces conditions, ces forêts ont-elles pu se régénérer dans le passé? Selon l'hypothèse de Mitchell (1961), appuyée par Piearce (1979) et Lawton (1986), un phénomène décisif a été l'importante diminution des populations de grands mammifères. En broutant, piétinant et arrachant le mutemwa, en enterrant les semences de mukusi et en fumant le sol par leurs déjections, éléphants et buffles freinaient le développement du mutemwa et favorisaient la régénération du mukusi, pour lequel ils n'ont pas d'appétence. On a imputé à la chasse la diminution des effectifs de ces animaux, mais une épizootie meurtrière de peste bovine en 1886 (Wood, 1986) pourrait y avoir contribué encore davantage.
Par la suite, l'exploitation des mukusi et les feux ont considérablement réduit la densité des portegraines sur de vastes surfaces et favorisé la dominance du mutemwa, d'où danger accru d'incendie et pullulation des animaux nuisibles.
Le problème concret, en matière de régénération naturelle, est par conséquent la limitation du mutemwa. Le moyen le plus efficace pour cela est l'emploi d'arboricides, notamment le 2,4,5-T et le Tordon, pour lesquels on a défini des prescriptions d'application (Piearce, 1979). Etant donné, toutefois, qu'on n'est pas très sûr de la rentabilité de ces produits et que de l'avis de beaucoup ils sont nuisibles écologiquement, leur emploi n'a pas été autorisé à une échelle autre qu'expérimentale.
Lawton (1986) propose une autre méthode pour reproduire les conditions dans lesquelles le mukusi se régénérait vraisemblablement à l'origine. Elle consiste à défricher le mutemwa à l'aide d'engins lourds, mais là encore le facteur coût dissuade de passer à l'exécution, même à une modeste échelle expérimentale.
Les tentatives de régénération artificielle, par plantation d'enrichissement ou reboisements expérimentaux, ont connu jusqu'à présent très peu de succès (Malaya, 1986; Chitempa et Shingo, 1986). Tout d'abord, le défrichement coûte de plus en plus cher et, en second lieu, les semences ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante. Le semis direct échoue en général, en raison des attaques par les animaux.
Les plants sont faciles à élever en pépinière, où la germination excède en général 90 pour cent, mais leur transplantation est malaisée à cause de la longueur de la racine pivotante, qui s'enfonce profondément dès le début, atteignant 1,50 m en un an, alors que la tige ne s'élève pas au-dessus de 15 cm au cours des trois premières années (Fanshawe, 1961; Endean, 1968; Högberg, 1986; Calvert, 1986b). Il faut sectionner cette racine avant la plantation, ce qui rend le plant particulièrement sensible à la sécheresse, d'autant que les pluies dans la région sont notoirement aléatoires. Dans certains essais, le taux de survie des plants n'a pas dépassé 10 pour cent au bout d'un an, la plupart des pertes étant imputables à la sécheresse et aux dégâts causés par les céphalophes.
La meilleure parcelle d'essai de mukusi en Zambie a été établie au début des années 60, apparemment par semis direct mais dans des circonstances sur lesquelles les archives existantes ne fournissent guère d'informations. On a émis l'hypothèse que les populations d'animaux nuisibles étaient alors à un niveau suffisamment bas et que la pluviosité avait été assez favorable. Il semble aussi que des soins intensifs aient été apportés à cet essai, tels que, peut-être, l'emploi d'épouvantails et le gardiennage pour éloigner les animaux, et l'arrosage des semis. D'après l'expérience de ces dernières années, on ne saurait à l'heure actuelle espérer raisonnablement réussir à installer le mukusi en plantation aussi bien qu'on y est parvenu lors de cet essai unique il y a 20 ans.
A ces problèmes sylvicoles encore non résolus il faut ajouter celui de la croissance extrêmement lente du mukusi. Même dans les meilleures conditions, son âge d'exploitabilité - pour un diamètre modéré de 30 cm à hauteur d'homme - se situe entre 80 et 100 ans, ce qui fait bien longtemps à attendre.
Exploitation commerciale. A l'issue de la Conférence de Livingstone mentionnée plus haut, 22 résolutions furent adoptées. En ce qui concerne l'exploitation commerciale, la conférence a recommandé d'abaisser la possibilité réalisable et de chercher à réduire la perte au sciage, de manière à utiliser au maximum les volumes abattus; de restreindre les emplois du teck du Zambèze à des produits de haute valeur, notamment en vue de l'exportation; d'encourager les sociétés d'exploitation forestière à participer à l'aménagement, à la protection et à la régénération des forêts; et enfin de promouvoir l'utilisation d'essences secondaires de substitution, afin de maintenir l'emploi dans les industries forestières.
Les scieurs, conscients de la nécessité d'améliorer le rendement du sciage - bien qu'un taux de conversion de 40 pour cent soit considéré comme acceptable - , ont à cette fin sollicité l'assistance de la Division de la recherche sur les produits forestiers du Département des forêts, qui a effectué une étude préliminaire de faisabilité touchant la production de charbon de bois à partir des résidus de scierie (Musonda, 1986). On a songé également à utiliser les déchets pour la production d'électricité, la fabrication de panneaux de particules et la confection de briquettes de sciure.
La promotion d'essences de substitution fait l'objet de propositions de recherches à long terme, portant par exemple sur une étude plus poussée des potentialités de Ricinodendron rautanenii Schinz. (mungongo ou essessang), essence à usages multiples qui a particulièrement retenu l'attention du Conseil national de la recherche scientifique de Zambie (Duff, 1986). La Division de la recherche sur les produits forestiers vient d'entreprendre, en prenant l'aire du teck du Zambèze comme zone prioritaire, un programme d'étude sur les possibilités d'utilisation et la durabilité des essences forestières communes dans la construction rurale, en se concentrant sur les essences peu connues poussant aux alentours ou à l'intérieur des villages.
Jusqu'à présent, la seule essence autre que B. plurijuga qui soit exploitée commercialement est Pterocarpus angolensis DC. (mukwa ou muninga). Mais les scieurs envisagent une utilisation accrue d'Entandrophragma caudatum (Sprague) Sprague (mupumena), Guibourtia coleosperma (Benth.) J. Léon. (mazaule ou mussibi, encore appelé «Rhodesian copalwood»), et Pterocarpas antunesii (Taub.) Harms (m'wangura), toutes essences secondaires caractéristiques des forêts de Baikiaea.
Recherche. La conférence a également préconisé de nouvelles recherches sur la faune forestière, du point de vue notamment de l'influence des grands mammifères sur la régénération; sur tous les aspects de la régénération tant naturelle qu'artificielle; et sur des questions connexes de protection des forêts et amélioration des arbres. Il est indispensable aussi de rassembler des données à jour sur la répartition et la densité actuelles des principales essences à bois d'œuvre, moyennant un inventaire forestier détaillé, et d'étudier les possibilités d'emploi d'images de satellite pour en suivre l'évolution.
En Zambie, un regain d'attention est porté aux problèmes de régénération naturelle. Ceux-ci sont d'une importance toute particulière si l'on s'en tient à l'affirmation de Demeo (1986) selon laquelle la régénération naturelle est la seule voie logique et praticable pour restaurer les forêts de teck du Zambèze. C'est là sujet qui a soulevé de vives discussions lors de la conférence.
Le rythme alarmant de destruction de ces forêts ne fait aucun doute. Cependant, on n'a pas chiffré avec précision l'étendue de celles qui subsistent. Des propositions d'inventaire forestier national ont été faites il y a plusieurs années, mais le manque de fonds en a jusqu'ici empêché la réalisation.
Aménagement. A cet égard, la conférence a recommandé entre autres de donner la priorité à l'amélioration des mesures de protection contre le feu en formant des spécialistes du brûlage précoce, et, vu les échecs récents, de suspendre toute tentative de reboisement à grande échelle jusqu'à ce que la recherche ait fourni la réponse à tous les problèmes rencontrés.
C'est surtout la pénurie chronique de fonds pour la protection contre le feu (Zimba, 1986) qui retarde la mise en œuvre d'une politique de brûlage précoce systématique, plutôt qu'un manque d'expérience et de compétence des exécutants. Les possibilités de mise à feu par voie aérienne à l'aide de capsules incendiaires méritent d'être explorées plus avant, de même que la mise sur pied d'une unité de protection contre le feu autonome et spécialisée.
Coopération et vulgarisation. Dans ce domaine, les résolutions prescrivent notamment le resserrement des liens entre tous les organismes s'occupant de recherche et de développement dans la région du teck du Zambèze, et une intensification des efforts visant à faire connaître la valeur de ces forêts et à faire participer les collectivités locales à leur gestion et à leur protection.
Un événement important en Zambie a été la création en 1985, au sein du Département des forêts, d'une Division de la vulgarisation et de la propagande forestière, chargée d'éveiller l'intérêt et de stimuler la participation active des populations locales aux activités forestières, et de freiner la destruction inconsidérée des forêts. C'est là une question vitale pour la protection et la gestion rationnelle des forêts de teck du Zambèze (Banda, 1986; Matakala, 1986). Sans l'aide des habitants de la région, tous les efforts de restauration seront voués à l'échec. La Zambezi Society, association de conservation de la nature récemment créée au Zimbabwe mais qui a des liens étroits avec des groupements homologues de Zambie, aidera sans nul doute à relever ce défi.
Financement. Afin de grossir les crédits à la disposition des travaux forestiers, la conférence a recommandé de relever les redevances d'abattage et de réaffecter une proportion équitable des recettes que tire l'Etat de l'exploitation des forêts de teck du Zambèze.
Les redevances payées pour l'abattage des essences indigènes en Zambie n'ont pas changé depuis des années, mais elles font actuellement l'objet d'une révision et seront sans doute fortement relevées. Toutefois, même si toutes les recettes publiques étaient réaffectées aux forêts de teck du Zambèze, elles ne suffiraient pas encore à en financer la restauration, car ces forêts ont depuis longtemps passé le stade où elles pouvaient s'autofinancer. Par conséquent, que l'on institue ou non un fonds forestier national, la régénération des forêts devra être fortement subventionnée par des sources extérieures.
En définitive, l'avenir des forêts de teck du Zambèze dépend du simple choix entre un gain à court terme ou à long terme: soit utiliser simplement ces forêts pour en tirer des revenus qui serviront à d'autres besoins de développement apparemment plus urgents, soit investir maintenant des ressources importantes avec peu d'espoir d'un profit financier dans un avenir proche. Il est impossible de tirer aujourd'hui un profit net des forêts de teck du Zambèze sans hâter leur disparition.
En d'autres termes, au lieu de céder à la forte tentation de réaliser ce capital irremplaçable pour obtenir des ressources en devises bien nécessaires, il convient d'attirer les millions de dollars qu'il faudra investir pour assurer la pérennité de ces forêts.
Note:
La plupart des références ci-dessous proviennent d'une seule source: Zambia Forest Department. 1986. G.D. Piearce, ed. The Zambezi teak forests. Proceedings of the First International Conference on the Teak Forests of Southern Africa, March 1984, Livingstone, Zambia. Dans ce qui suit, cette publication sera simplement désignée par l'abréviation ZTF.
BANDA, A.S. 1986 The role of forest extension in the protection and management of the Zambian Teak Forests. En ZTF, cap. 34.
BRUMMITT, R.K. 1986 A taxonomic perspective of the genus Baikiaea. En ZTF, cap. 6.
CALVERT G.M. 1986a The Zambezi Saw Mills railway, 1911 to 1964. En ZTF, cap. 47.
CALVERT, G.M. 1986b The ecology and management of the Kalahari Sand Forest vegetation of south-western Zimbabwe. En ZTF, cap. 11.
CALVERT, G.M. 1986c Fire effects in Baikiaea woodland, Gwasi Forest. En ZTF, cap. 25.
CALVERT, G.M. 1986d Baikiaea regeneration and damaging agencies in Barotseland. En ZTF, cap. 45.
CHISUMPA, S.M. 1986 Mukusi ecological associations and environmental effects. En ZTF, cap. 9.
CHITEMPA, T.T. & SHINGO, J. 1986 Research and management problems in the artificial regeneration of Zambezi teak. En ZTF, cap. 32.
DEMEO, T. 1986 The case for a natural regeneration system in managing the Zambezi teak forests. En ZTF, cap. 13.
DUFF, C.E. 1986 Mungongo - Ricinodendron cautanenii. En ZTF, cap. 40.
EDMONDS, A.C.R. 1976 Vegetation Map 1:500 000. Lusaka Zambia, Departamento de Topografía y Tierras.
ENDEAN, F. 1968 The rooting habits of Baikiaea plurijuga, Pterocarpus antunesii and the main species forming the mutemwa. Informe no publicado. Kitwe, Zambia, Dirección de Investigación Forestal.
FANSHAWE, D.B. 1961 Bikiaea plurijuga Karms. Manuscrito. Kitwe, Zambia Dirección de Investigación Forestal.
FANSHAWE, D.B. 1971 The vegetation of Zambia. Lusaka Zambia, Forest Research Bulletin 7. Imprenta del Gobierno.
GREENWOOD, D.E. 1986 Zambezi teak in Zambia. En ZTF, cap. 46.
HÖGBERG, P. 1986 Rooting habits and mycorrhiza of Baikiaea plurijuga. En ZTF, cap. 8.
HUCKABAY, J.D. 1986 The geography of Zambezi teak. En ZTF, cap. 2.
JUDGE, J.G. 1986 The teak forests of Zimbabwe. En ZTF, cap. 5.
LAWTON, R.M. 1986 How were the Zambezi teak forests established? En ZTF, cap. 39.
LIVINGSTONE, D. 1857 Missionary travels and researches in South Africa. Londres, John Murray.
MALAYA, F.M. 1986 A review of silvicultural research in the Zambian teak forests. En ZTF, cap. 13.
MARTIN, J.D. 1932 The mukusi (Baikiaea plurijuga Harms) forests of Northern Rhodesia. Annual Bulletin, 2: 71-76. Lusaka, Departamento de Agricultura.
MARTIN, J.D. 1940 The Baikiaea forests of Northern Rhodesia. Emp. For. J., 19: 8-18.
MATAKALA, P.W. 1986 Problems of forest extension work in the Zambian teak forests. En ZTF, cap. 35.
MBUGHI, R.J. 1986 The habitat and regeneration of Zambezi teak in Zambia. En ZTF, cap. 43.
MILLER, O.B. 1939 The mukusi forests of the Bechuanaland Protectorate. Emp. For. J., 18: 193-201.
MITCHELL, B.L. 1961 Ecological aspects of game control measures in African wilderness and forested areas. Kirkia, 1: 120-128.
MUSONDA, W.M. 1986 Fuelwood problems in the teak forests. En ZTF, cap. 44.
PIEARCE, G.D. 1979 The use of arboricides to control thicket species in the teak forests of Zambia. East Afr. Agric. For. J., 44 (4): 285-297.
SHIKAPUTO, C. 1986 Properties and end-uses of Zambezi teak. En ZTF, cap. 28.
STEVENSON, D. 1931 Some important native timbers. Annual Bulletin, 1: 45. Lusaka, Departamento de Agricultura.
WOOD, A.P. 1986 Man's impact upon the mukusi forests of Zambia with special reference to Sesheke District. En ZTF, cap. 3.
ZIMBA, S.C. 1986 Fire protection and related management problems in the Zambian teak forests. En ZTF cap. 24