Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
6. Principales démarches techniques
En tout premier lieu, on peut séparer l'ensemble des démarches qui nécessitent la mise en place d'un parcellaire aux approches qui s'abstiennent de recourir au zonage. Pour ce qui concerne l'exploitation du bois de feu, le mode de gestion du taillis fureté nous paraît préconisable dans les régions de faible anthropisation.
Quant aux démarches qui retiennent la mise en place d'un parcellaire, elles opposent traditionnellement les tenants de la définition de l'assiette de coupe par contenu et par contenance, avec indication du contenu (encadré n° 15). Toutes ces approches étant équivalentes lorsque l'on est en présence d'un milieu homogène, il paraît raisonnable dans une première phase de se rapprocher de cette situation et, pour ce faire, de procéder à une stratification de la forêt. Les strates correspondent à des types de forêt offrant des potentialités plus ou moins importantes, mais aussi soumis à des usages différenciés. Cette notion d'usage conduit par exemple à classer dans deux strates différentes deux aires identiques pour ce qui est du couvert forestier, mais dont l'une doit être parcourue régulièrement par les troupeaux et l'autre pas. C'est sur ces strates que sera bâti le parcellaire.
Dans les zones sèches, et par rapport à la ressource bois de feu, il est difficile d'obtenir des estimations de volume précises et fiables. Il paraît donc illusoire d'opter vis-à-vis de cette spéculation pour un aménagement par contenu. Il peut en être autrement si l'on considère les forêts denses sèches et l'exploitation de bois d'oeuvre. La stratification, qui a été précédemment effectuée, va permettre de proposer un premier agencement qui nous rapproche de l'aménagement par contenance avec indication du contenu. Il suffit d'adapter dans chaque strate la surface des parcelles à la "valeur" de la strate (figure n° 8).
Figure n° 8
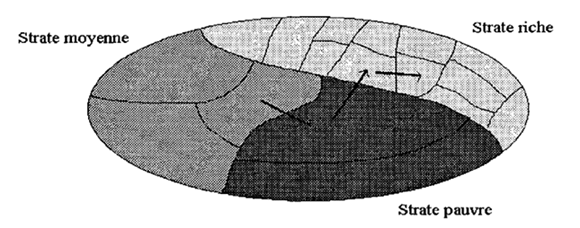
La taille des parcelles est fonction de la richesse de la strate.
La succession des coupes peut ignorer les strates.
Le parcellaire étant réalisé et intégrant toutes les strates, la deuxième étape consiste à ordonner le parcours de l'exploitation.
De nombreuses options peuvent être proposées. En particulier, on peut tenir compte de l'éloignement de la ressource. Deux cas de figure peuvent être explorés.
* Pour ce qui est des zones éloignées des villages, il s'avère que les prélèvements sont adaptés à la possibilité du transport. On peut en tenir compte dans la mise en place de parcellaire.
* La parcelle - c'est-à-dire ce qui, en général, sera parcouru dans l'année - peut être éclatée et comporter une partie proche du village (qui sera exploitée durant les périodes où la main d'oeuvre est rare) et une partie éloignée, prise en compte aux autres périodes de l'année (figure 9-b). On peut même envisager des modes différents d'exploitation de ces deux composantes de la parcelle et remarquer que cette option permet de proposer des parcelles réparties sur plusieurs strates.
Figure n° 9: a) La taille des parcelles est d'autant plus grande qu'elle est éloignée du village.
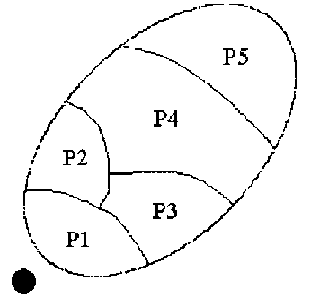
Figure n° 9: b) La parcelle est éclatée en deux composantes, l'une à proximité du village, l'autre éloignée.
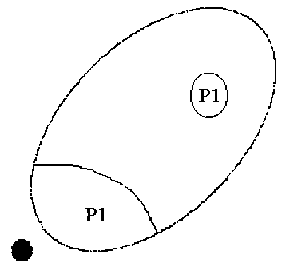
Figure n° 10: Principe d'une exploitation à l'avancement. En première année de la deuxième rotation, le coupon 1 repassera en coupe. Comme la demande aura augmenté, il faudra exploiter la réserve en débutant par le coupon 1 bis (Parkanet al., 1988).

Par ailleurs, de l'aménagement des forêts de Woro et Dialakoro (Mali), le projet mené par la FAO n'a fixé de possibilité, ni par volume, ni par contenance, faute de critères suffisants. C'est a posteriori qu'une capacité annuelle de coupe de la part des paysans a été constatée. Il en a été déduit un parcellaire collant à la réalité: la coupe de bois est réalisée à l'avancement, tout en respectant les quelques règles de sylviculture (figure n° 10).
Le schéma ci-avant illustre ce principe simple (et non simpliste) d'exploitation à l'avancement. Il est très souple: si la demande augmente, un lot ou coupon supplémentaire (issu d'une zone réservée, en prévision pour ce faire) peut être rajouté à l'exploitation de l'année. Au contraire, si les villageois n'arrivent pas à exploiter la surface annuelle qu'ils ont eux-mêmes définie (comme au Niger; voir Quatrième Partie, étude de cas n° 4), on peut défalquer un coupon non exploité. Ce principe, s'il est facile à appliquer, n'en est pas moins difficile à gérer: les problèmes de contrôle et de durabilité restent posés.
Encadré n° 15: Les aménagements dits "par contenance" (par surfaces identiques) L'aménagement forestier est une nécessité pour des raisons qui tiennent à la bonne gestion d'une ressource, à son amélioration et à sa conservation. Sur ce dernier point, l'aménagement par contenance n'est pas une réponse satisfaisante. D'autres possibilités existent. L'aménagement par contenance n'offre en soi aucune garantie de pérennité de la forêt dans sa diversité et sa productivité. Il est clair que le premier acte de l'aménagement d'une forêt est sa délimitation et sa cartographie, avec la mise en place d'un parcellaire. Cela permet de localiser les diverses interventions en forêt. Mais on ne saurait s'en tenir à une localisation des actions: il faut également les définir aussi précisément que l'état de l'art et la connaissance des peuplements le permettent. Un inventaire du potentiel est indispensable afin d'évaluer la possibilité annuelle et de respecter un prélèvement inférieur à l'accroissement. Délivrer des assiettes de coupe par contenance, c'est-à-dire sans garantie quant aux volumes exploitables et sans définition de ce qui sera exploité, ne peut être qualifié d'aménagement durable et n'offre aucune garantie de pérennité, ni au peuplement forestier, ni à sa diversité biologique. La simple fixation d'assiettes de coupes ne constitue pas un aménagement suffisant. Ce type de démarche peut éventuellement constituer une première étape du processus d'aménagement. Etape qui doit être nécessairement suivie d'actions plus élaborées. La connaissance des "volumes existants", de "l'accroissement" et du "prélèvement acceptable" fait partie des éléments nécessaires et permet de faire bien mieux qu'un aménagement pal simple contenance. Les recherches menées en forêt naturelle sèche depuis près de vingt ans ont conduit à des connaissances sur la dynamique des peuplements naturels, sur leur réaction à divers modes d'exploitation et d'éclaircie, sur leur régénération. Ces connaissances sont une base pour des propositions de sylviculture. D'autre part les techniques d'inventaires des ressources sont opérantes depuis de nombreuses années et continuent de se perfectionner. Des outils existent donc pour une gestion qui soit réaliste sans être simpliste, et qui garantisse sur le plan technique la durabilité des peuplements. L'aménagement durable d'une foret suppose que l'exploitation se fait dans les limites qui sont liées, non seulement à des considérations commerciales, ce qui est jusqu'à présent le cas général, mais aussi à des considérations sylvicoles. L'assiette de coupes par contenance ne laisse que très peu de place à des considérations sylvicoles (peut-être un diamètre minimum d'exploitabilité?) et n'impose d'autre contrainte que la superficie parcourue. Source: CIRAD-Forêt, 1995 |