Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
7. Mesure de la biomasse fourragère et recouvrement
Dans les parcours naturels, le disponible fourrager pour le cheptel domestique est constitué par la végétation herbacée, mais aussi par la végétation ligneuse accessible ou rendue accessible aux animaux.
En Afrique, en zone sèche sahélienne, le tapis herbacé est à base de Graminées annuelles fines (Aristida spp., Chloris spp., Schoenefeldia gracilis, Cenchrus spp., etc.) qui germent aux premières pluies de juin, juillet et sèchent sur pied dès la fin septembre. Ce tapis, étroitement dépendant des précipitations et qui peut être clairsemé ou continu, a une hauteur de 50 - 60 cm avec un recouvrement variant, selon les saisons des pluies, de 10 à 80%. Signalons qu'avant la sécheresse, qui sévit depuis les années 70 en Afrique tropicale, des Graminoïdes vivaces (Panicum turgidum, Cymbopogon schoenanthus, Cyperus jeminicus, etc.) n'étaient pas rares; leur recouvrement pouvait atteindre 20%. En zone soudanienne, les herbacées annuelles (Hyparrhenia bagirmica, Diheteropogon hagerupii) ou vivaces (Andropogon gayanus) sont plus grandes. Elles germent et repoussent dès les premières pluies en avril-mai dans un paysage ravagé par les feux de brousse. Les recouvrements sont plus importants et varient de 40 à 80% pour une hauteur de l'ordre de 1,5 à 2 m. Toutefois, il ne faut pas oublier que les Graminées sont héliophiles et que dans la classification de Yangambi, la "forêt claire" est la seule formation physionomique "forêt" où cette famille peut encore se développer.
Certaines espèces de ligneux sont recherchées par les ruminants, en particulier en fin de saison sèche, quand le tapis herbacé est rare: branches basses, rejets, gousses. Les jeunes individus sont systématiquement broutés. Parfois le berger, par un coup de hache, met quelques branches basses à portée de ses animaux. Dans le cas du fourrage ligneux, l'estimation ne passe pas par le recouvrement total. Elle est beaucoup plus compliquée.
a/ Mesure de la biomasse herbacée
Tout d'abord, il convient de préciser que dans le domaine du pastoralisme, la priorité va à la biomasse herbacée appétible, c'est-à-dire celle qui est susceptible d'être consommée par les animaux. On dit également appétable ou consommable. L'évaluation du disponible fourrager qui s'exprime en kilogramme de matière sèche par hectare (kg MS.ha-1) concerne uniquement la fraction appétible. Cette appétibilité est une notion toute relative, selon les espèces animales bien sûr, mais aussi selon le degré de difficulté pour le cheptel de trouver de la nourriture. Un exemple parmi tant d'autres: au Sahel, avant la sécheresse, Calotropis procera était délaissé, mais après la sécheresse, les animaux l'ont moins négligé.
Les mesures de biomasse se font par échantillonnage et par coupe; c'est une méthode dite "destructive". Pour cela, l'herbe est coupée à la cisaille ou à la faucille, à l'intérieur d'un carré de 1 m2. Levang et Grouzis (1980) proposent pour le Sahel trente répétitions réparties au hasard; au-delà, la précision s'améliore peu.
Il est intéressant de connaître la biomasse herbacée totale et la biomasse herbacée appétible (consommable). Après récolte, le poids total est pesé, puis ce qui est considéré comme appétible (d'après les observations, les enquêtes, la littérature) est trié. Ensuite, après homogénéisation, une partie de ce mélange est prise, pesée puis amenée au laboratoire pour évaluation à l'étuve du taux de matière sèche (MS). Par calcul simple entre les productions par mètre carré, exprimées en masse sèche et la surface de référence, on obtient le disponible en kilogramme de matière sèche par hectare.
Mais ce résultat n'est pas suffisant, il est nécessaire de connaître la valeur fourragère par analyse chimique. Leur nombre, limité par le coût, doit cependant être suffisant pour être représentatif de la région concernée. L'analyse peut porter sur un mélange d'herbes ou sur les principales espèces dominantes.
Signalons qu'il existe des méthodes "non destructives" d'évaluation de la biomasse, basées sur l'utilisation de radiomètres de terrain. Leur emploi en milieu naturel n'est pas aisé, en raison de la variété de la composition floristique. Au travail d'étalonnage s'ajoutent le coût et la maintenance du matériel.
b/ Mesure de la biomasse des arbres fourragers
Il s'agit de la partie accessible aux animaux, qui varie avec la taille de l'espèce domestique. Un dromadaire sollicite davantage un ligneux qu'une chèvre. D'autre part, tous les ruminants n'ont pas le même régime alimentaire. Le problème de la mesure de cette biomasse est donc complexe. La méthode est relativement au point, mais son application opérationnelle est très fastidieuse.
Delacharlerie (1994) dans une synthèse bibliographique fait le point sur les "méthodes d'étude des disponibilités fourragères ligneuses, application au calcul des capacités de charge". Sommairement, la méthode consiste à caractériser un peuplement ligneux, à y choisir un site échantillon (parcelle d'une dizaine de ligneux). L'évaluation de la biomasse est réalisée sur des espèces reconnues appétées et espèce par espèce, en distinguant feuilles, fruits, etc., selon les saisons de croissance.
Actuellement, en raison du caractère destructeur et fastidieux des mesures directes, on s'oriente vers des relations d'allométrie. Cependant, les formules établies (encadré n° 16) doivent être ajustées sur le terrain par la méthode des rameaux standards.
Seule une partie de cette biomasse totale évaluée sur le terrain est consommée par les animaux. C'est la partie accessible avec comme critère d'évaluation la hauteur et la pénétrabilité Ickowicz (1995) les réunit sous le terme de volume utile. Pour cet auteur, un ligneux fourrager est caractérisé par le volume de sa partie accessible (pénétrabilité), c'est-à-dire la périphérie du houppier inférieure à 1,5 m. C'est donc ce volume qu'il faut prendre en compte (figure m° 11).
La mesure de la biomasse ligneuse appétible n'est pas chose aisée. Actuellement, les méthodes décrites ont fourni pour le Sahel et les zones sèches d'Amérique des relations qu'il est nécessaire de valider pour chaque situation. Elles permettent d'obtenir un ordre de grandeur de l'apport fourrager des formations ligneuses étudiées (Tounkara, 1991).
Encadré n° 16: Relations d'allométrie entre la biomasse foliaire maximale et les mensurations des espèces ligneuses (d'après Ickowicz, 1995, in: Delacharlerie, 1994)
ESPECES |
RELATIONS D'ALLOMETRIE |
SOURCE |
Acacia laeta |
BM = 142 D + 216,6 |
Piot et al., 1980 |
Acacia tortilis |
BM = 52,5 - 44.64 |
Piot et al., 1980 |
BM = 0,5 C2,35 |
Cissé, 1991 |
|
Acacia senegal |
lnBM = 1,40 lnC + 0,46 |
Poupon, 1980 |
BM = 14,05 C1,40 |
Cissé, 1991 |
|
Boscia senegalensis |
lnBM = 0,47 lnS + 0,77 lnN - 4,85 |
Cissé et Sacko, 1987 |
BM = 2,34 C1,88 |
Cissé, 1991 |
|
Combretum aculeatum |
BM = 60,57 H - 17,66 |
Piot et al., 1980 |
BM = 3,09 C2,33 |
Cissé, 1991 |
|
Guiera senegalensis |
BM = 3,09 C1,89 |
Cissé, 1991 |
Pterocarpus lucens |
BM = 0.95 C2,07 |
Cissé, 1991 |
Ziziphus mauritania |
BM = 1,38 C1,91 |
Cissé, 1991 |
Ln = Logarithme népérien |
Figure n° 11: Biomasse totale, disponible et accessible (Ickowicz, 1995))
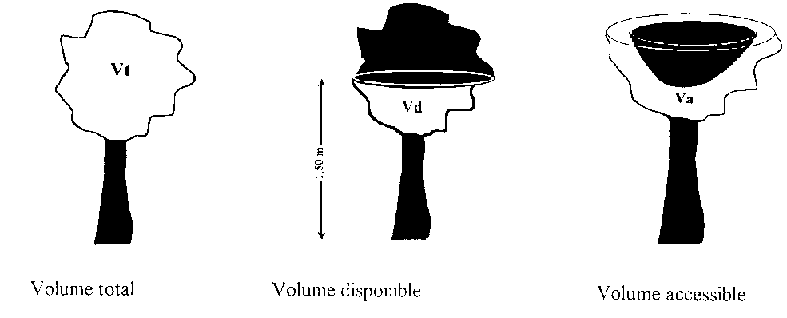
c/ La valeur fourragère
Pour caractériser l'apport de la végétation naturelle à l'élevage, les critères à prendre en compte sont la production appétible (mesurée sur le terrain et exprimée en kg de matière sèche par hectare), la valeur énergétique et la valeur azotée (encadré n° 17). A ces critères quantitatifs, s'ajoute un critère qualitatif, l'appétibilité, qu'il n'est pas toujours aisé d'apprécier. Cela demande une période d'observations sur le terrain tout au long de l'année. Mais en tout état de cause, en cas de sécheresse accentuée, la plupart des espèces considérées comme peu appétées sont finalement consommées.
Encadré n° 17: Valeur alimentaire d'un fourrage Pour exprimer la valeur alimentaire d'un fourrage, on utilise les notions suivantes:
A connaître aussi: la MS ou matière sèche (la teneur en MS d'un produit humide est donnée en pour-cent de la matière verte), et la MSVI ou matière sèche volontairement ingérée (en g par kg de poids métabolique). |
La production appétible est mesurée sur le terrain et la valeur énergétique par analyse au laboratoire (tableau n° 14). La valeur énergétique, obtenue à partir de la digestibilité mesurée ou estimée, s'exprime en unité fourragère viande (UFV) et en unité fourragère lait (UFL).
Tableau n° 14: Composition de quelques aliments pour ruminants (résultats IEMVT, ISRA...)
DESIGNATION |
EPOQUE |
DUREE DE VEGET. |
MS P 100 FOUR |
COMPOSITION CHIMIQUE
(g MS.kg-1) |
ENERGIE (kg MS) |
VAL. AZOTEE (g MS.kg-1) |
||||||||
MO |
MAT |
CB |
Ca |
P |
UF |
UFL |
UFV |
MAD |
PDIN |
PDIE |
||||
A. GRAMINEES
NATURELLES ET CULTIVEES (Exemples) |
||||||||||||||
GRAMINEES ANNUELLES
SAHELIENNES ET SOUDANIENNES |
||||||||||||||
Aristida mutabilis |
||||||||||||||
|
SP 7 |
23 |
909 |
133 |
311 |
5,3 |
1,9 |
0,67 |
0,78 |
0,70 |
93 |
|||
|
SP 8 |
32 |
920 |
72 |
356 |
2,9 |
1,8 |
0,37 |
0,55 |
0,45 |
32 |
|||
|
SP 9 |
49 |
926 |
59 |
365 |
3,4 |
1,4 |
0,33 |
0,53 |
0,42 |
19 |
|||
|
SS 10-12 |
94 |
934 |
32 |
417 |
3,4 |
1,0 |
0,24 |
0,46 |
0,35 |
<0 |
|||
|
SS 3-5 |
95 |
942 |
6 |
438 |
2,3 |
0,3 |
0,21 |
0,44 |
0,33 |
<0 |
|||
GRAMINEES VIVACES
SOUDANIENNES ET GUINEENNES |
||||||||||||||
Andropogon gayanus |
||||||||||||||
|
SP 6-7 |
28 |
918 |
111 |
311 |
3,7 |
1,9 |
0,56 |
0,61 |
71 |
||||
|
SP 8 |
27 |
912 |
86 |
318 |
4,6 |
1,6 |
0,45 |
0,51 |
46 |
||||
|
SS 2 |
15 jours |
38 |
905 |
107 |
295 |
5,0 |
2,3 |
0,55 |
0,60 |
67 |
|||
|
SS 2-3 |
25 jours |
39 |
922 |
96 |
304 |
4,4 |
2,0 |
0,50 |
0,56 |
56 |
|||
|
SS 1 |
20 jours |
37 |
915 |
84 |
284 |
5,3 |
1,5 |
0,47 |
0,53 |
44 |
|||
|
SS 2 |
60 jours |
37 |
899 |
63 |
328 |
4,3 |
1,4 |
0,36 |
0,44 |
23 |
|||
|
SS 2-3 |
100 jours |
44 |
936 |
57 |
344 |
5,5 |
1,4 |
0,54 |
0,44 |
17 |
|||
B. DICOTYLEDONES
HERBACEES NATURELLES (Exemples) |
||||||||||||||
LEGUMINEUSES ANNUELLES ET
SOUDANNIENNES |
||||||||||||||
Zornia glochidiata |
||||||||||||||
|
SP 7 |
15 |
918 |
200 |
222 |
6,9 |
1,8 |
0,57 |
0,72 |
0,63 |
146 |
23 |
||
|
SP 9 |
32 |
934 |
160 |
277 |
9,7 |
1,4 |
0,46 |
0,64 |
0,53 |
104 |
26 |
||
|
SP 9 |
33 |
929 |
134 |
297 |
13,2 |
2,2 |
0,38 |
0,58 |
0,47 |
85 |
|||
|
SS 11 |
94 |
947 |
82 |
367 |
5,4 |
0,9 |
0,23 |
0,47 |
0,36 |
40 |
43 |
||
C. FOURRAGES LIGNEUX
(Exemples) |
||||||||||||||
FEUILLES VERTES |
||||||||||||||
Acacia linaroïdes (espèce
australienne) |
SS |
= 30 |
941 |
125 |
312 |
7,2 |
1,1 |
8 |
15 |
|||||
Leucaena leucocephala |
SS |
903 |
181 |
231 |
2,1 |
1,8 |
0,07 |
0,37 |
0,25 |
128 |
20 |
|||
Piliostigma reticulatum |
SS |
= 30 |
909 |
91 |
297 |
18,4 |
1,2 |
0,65 |
0,77 |
0,69 |
9 |
6 |
||