Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
a/ les terres de parcours
Les parcours naturels de steppe et de savane sont traditionnellement exploités par les éleveurs pratiquant la transhumance à des degrés divers. L'utilisation de l'espace répond à la recherche d'un équilibre entre l'exploitation de l'herbe à son stade optimal, la quête d'eau (mares, fleuve, puits), les désagréments et les risques dûs aux insectes (mouches, taons, glossines) et les déplacements évitant les conflits avec les agriculteurs.
En Afrique de l'Ouest, durant la saison des pluies, les troupeaux exploitent les parcours au nord de la limite des cultures pluviales. Ils s'abreuvent aux mares temporaires et/ou aux puits et sont en général, éclatés. Ils utilisent ainsi des terres de parcours qui seraient difficilement, surtout les plus septentrionales, accessibles en pleine saison sèche. C'est également l'époque des "cures salées". De plus, les insectes sont moins abondants qu'en zone soudanienne et il n'y a que très peu de risques de conflit avec les agriculteurs. Au début de la saison sèche, après les récoltes les troupeaux peuvent se déplacer vers le sud pour trouver de l'herbe plus verte, donc plus riche. Ils pâturent alors la végétation naturelle, les jachères, les résidus de récolte, les zones de décrue des fleuves, les repousses après feu. Les troupeaux reprennent le chemin du nord au fur et à mesure de l'arrivée des premières pluies, initiatrices de mise en culture de la part des paysans.
Une telle utilisation des ressources naturelles est le fruit d'une longue expérience qui a conduit les éleveurs à les exploiter à l'optimum de leur valeur, tout en minimisant les risques sanitaires et de conflits sociaux.
Au cours de ces déplacements, les troupeaux peuvent couvrir des distances considérables plusieurs centaines de kilomètres. Pour l'Afrique tropicale, ces transhumances sont bien connues et décrites dans l'atlas CTA/CIRAD-EMVT "Elevage et potentialités pastorales sahéliennes" (1985-1990). Cet atlas concerne six pays sahéliens (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal Mauritanie). Deux autres atlas séparés, concernant le Nord-Cameroun (1992) et le Soudan (1993) des mêmes éditeurs, décrivent les déplacements et l'utilisation des ressources naturelles dans ces pays.
Les éleveurs transhumants délimitent ainsi de vastes entités géographiques dans lesquelles, saison après saison, ils trouvent une ration relativement équilibrée pour leur cheptel. L'exemple, très connu, est celui de la "dina" de Cheikou Ahmadou au XIXème siècle qui régissait l'exploitation de saison sèche des pâturages de décrue du delta intérieur du Niger (Gallais, 1967). C'est d'ailleurs au Mali qu'un projet de code pastoral a été préparé (Gallais et Boudet, 1980).
En Afrique de l'Est, les miombos montrent quelques particularités, dont une remarquable: beaucoup d'arbres de ces forêts produisent de nouvelles feuilles deux mois avant l'arrivée des pluies (Lawton, 1980), à l'instar de rares espèces du domaine soudanien. Aucune explication étayée n'a encore été avancée à ce jour pour expliquer ce dysfonctionnement physiologique apparent, largement exploité par les éleveurs.
En zone sahélienne, à part quelques tentatives de culture autour des agglomérations, les éleveurs transhumants sont les utilisateurs exclusifs du milieu naturel. Par contre, en zone soudanienne, ils exploitent l'espace non utilisé par les agriculteurs. Depuis deux décennies, la sécheresse au nord et l'augmentation de la population agricole au sud ont compliqué ce schéma: allongement des transhumances, sédentarisation, défrichement accru des milieux naturels. De plus, les agriculteurs, par le biais de la culture attelée, ont créé un noyau d'élevage qui tend à devenir important. Il en résulte un accroissement des situations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs.
b/ Les terroirs agro-pastoraux
Situés en zone soudanienne, ils sont agricoles à l'origine. La spéculation agricole est basée sur des cultures vivrières (sorgho, mil, arachide, parfois riz) et des cultures industrielles (arachide, coton). Autour du village, trois cercles plus ou moins concentriques s'étendent: les champs quasiment permanents, puis les jachères de durée variable intercalées de champs temporaires et enfin les espaces de végétation naturelle. Ce complexe a une valeur pastorale certaine à travers les résidus de récolte (chaumes, feuilles), les annuelles messicoles et la ré-installation d'Andropogon gayanus dans les Jachères.
Progressivement, la culture attelée a été à l'origine, dans ces terroirs, de la spéculation "élevage". Maintenant les agriculteurs disposent de petits troupeaux. Ceux-ci, souvent confiés à un berger salarié, sont éloignés du village pendant la période de culture. Après la récolte, les animaux exploitent les résidus et la végétation messicole. C'est à cette période du calendrier alimentaire (novembre à février) qu'ils se trouvent en concurrence avec les transhumants.
Actuellement, les terroirs agro-pastoraux disposent de ressources pouvant assurer l'alimentation des troupeaux villageois à condition de prendre en compte les pâturages naturels proches et la possibilité de transhumance plus ou moins limitée. De plus, leur situation géographique peut permettre des cultures fourragères et l'approvisionnement éventuel en sous-produits agro-industriels, en particulier ceux issus du coton ou de l'arachide.
c/ Le surpâturage, la mise en repos et la mise en défens
Hormis les évolutions climatiques, événements non maîtrisables par l'homme, surpâturage et feux de brousse sont deux phénomènes dont l'évocation revient sans cesse lorsque l'on traite des parcours naturels.
Le surpâturage peut être défini comme une action du cheptel modifiant les potentialités d'une terre de parcours. La première manifestation est la modification de la composition floristique. Les espèces appétées, trop sollicitées, disparaissent au profit d'espèces non appétées qui ont eu la possibilité de se multiplier. Cette disparition peut être due à l'épuisement du système racinaire comme nous le verrons plus loin. Physionomiquement, cette évolution est peu visible. L'autre manifestation du surpâturage est plus connue, avec l'apparition des phénomènes d'érosion, parfois spectaculaires qu'il entraîne. La raréfaction du tapis herbacé, voire sa disparition, et le piétinement favorisent l'érosion hydrique. Cette action est particulièrement sensible en zone de relief, comme dans l'Adamawa au Cameroun (Hurault, 1974).
En zones de faibles précipitations et dans les autres terres de parcours marginales, il est parfois difficile de faire la part du climat et de l'impact des troupeaux. Après la sécheresse de 1973, Gaston (1981) a montré qu'au Sahel tchadien l'action du climat a été prépondérante.
Il faut également signaler que la notion de surpâturage doit être utilisée avec réserve. C'est le cas des forages profonds au Ferlo (Sénégal). En saison sèche, du fait de l'importante fréquentation (parfois plus de 5 000 têtes si les forages voisins sont en panne), l'aspect au sol (et par télédétection) de l'aire du forage est très dégradé. Il en est tout autrement en saison des pluies. Cette aire, qui a bénéficié à travers les fèces d'un important apport azoté et grainier, dispose d'une production végétale herbacée de qualité. Cette ambiguïté a bien été mise en évidence par Valenza (1984) En fait, le véritable problème consiste en un bon fonctionnement de tous les forages, en l'utilisation de toute cette biomasse pratiquement détruite par le piétinement de début de saison sèche et en la mise en oeuvre de mesures destinées à préserver et restaurer la strate ligneuse, souvent mise à mal et dans l'impossibilité de se régénérer.
Plus récemment, Carrière (1995), étudiant l'impact des systèmes pastoraux sur l'environnement conclut que la combinaison de divers facteurs: "augmentation des surfaces cultivées, réduction des surfaces pastorales densification des impacts autour des pôles agricoles, transferts de propriété du bétail modification des systèmes d'alimentation, diminution de l'accès aux ressources pour les éleveurs" sont la cause de "l'évolution régressive des ressources pastorales naturelles (...) en un quart de siècle la pression anthropozoogène sur les milieux naturels a doublé corrélativement à la multiplication par deux du nombre d'utilisateurs". Cette évolution n'ayant pas été suivie d'analyse, on se trouve maintenant en présence d'écosystèmes dégradés et sans stratégie pour les réhabiliter et préserver ce qui peut encore l'être. Carrière arrive, à juste titre, à la conclusion que "c'est bien à l'échelle de la grande région écoclimatique que se situe le double problème de la production d'élevage et de la protection de l'environnement", tout en reconnaissant le rôle clef des ONG pour les résoudre "à l'échelle du village et de la petite région".
La mise en repos est un moyen relativement simple de contrer les effets du surpâturage pendant un laps de temps généralement court. Dans les cas extrêmes, cette technique s'impose pendant plusieurs années. Elle peut être assortie de travaux légers de régénération comme cela a été initié au Burkina Faso (Toutain et Piot, 1980), selon des modalités qui seront développées ultérieurement (chapitre VII, 4.4-b).
La mise en repos de courte durée peut être un élément de gestion des herbacées. En zone sahélienne, au cours de la saison des pluies, elle permet un développement optimal des annuelles, une bonne dispersion des graines et une éventuelle aide à la régénération des ligneux. En zone soudanienne, elle assure une production herbacée plus importante qui, brûlée, permettra un bon contrôle de l'embroussaillement. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'en situation de terres de parcours, il n'existe qu'un droit d'usage de l'espace. La mise en repos peut se dérouler dans un contexte évolutif et instable. Elle doit faire l'objet de longues négociations et d'un large consensus. Sa durée doit être fixée à l'avance.
Les deux notions de mise au repos et de mise en défens ne sont pas identiques. Dans la pratique cependant, la mise au repos coïncide la plupart du temps avec la mise en défens du périmètre.
La mise en défens durant de longues années des parcelles forestières nouvellement exploitées semblait être, jusqu'à récemment, de mise. Cette opération était une étape commune à tous les plans d'aménagement forestier édictés: les parcelles ayant fait l'objet d'une exploitation étaient protégées intégralement (au moins en théorie) contre les animaux et les feux. La durée de cette protection variait entre dix-huit mois (plans d'aménagement les plus modernes, type Nazinon au Burkina Faso) et cinq ans. Les principales raisons qui justifiaient ce choix étaient:
- la protection des plants fortement appétés, issus de la régénération naturelle par semis (ou par rejets et par drageons);
- la protection contre le tassement des sols doublement exposés aux rayonnements solaires après une coupe à blanc et au piétinement des troupeaux.
Il y eut ainsi de nombreux conflits avec les éleveurs qui voyaient "leur domaine" clôturé ou interdit d'accès. Depuis quelques années, l'intérêt de la mise en défens est remis partiellement en cause, et plus particulièrement en fonction de la couverture arborée. Dans une savane soudano-sahélienne du nord du Cameroun, Peltier et Eyog Matig (1989) montrent que le pâturage a peu d'impact sur la régénération post-exploitation, voire que la production est meilleure si les parcelles sont pâturées, en particulier en cas de non-contrôle des feux. La croissance des ligneux peut être augmentée par la réduction de la compétition herbacée, c'est-à-dire par un pâturage modéré, dans le cas d'une pluviosité normale. Le pâturage maintient aussi l'équilibre entre plantes annuelles, pérennes et buissons. La pâture en forêt est également un moyen efficace de lutter contre les feux. Dans la forêt de Mindif (nord Cameroun), la mise en défens a entraîné un embroussaillement d'espèces épineuses qui sont très difficiles à détruire.
Selon Mazoyer (1992), la mise en défens stricte pendant plusieurs années est à éviter autant que faire se peut, car elle est loin d'être toujours une nécessité en zone sèche. La décision doit être adaptée à chaque cas de figure et la moins contraignante possible.
D'autres travaux, menés au Niger par le Projet Energie II, modèrent aussi l'intérêt de la mise en défens. A Tientiergou, il n'y a pas d'effet significatif des clôtures et le bétail n'a pas d'impact sur la croissance des ligneux: "ces mises en défens ne sont vraiment nécessaires que pour, après exploitation des ligneux garantir un recrû herbacé suffisant qui sera une source de pâturage après deux à trois ans de mise en défens; l'aspect protection des rejets contre la dent du bétail étant alors secondaire". Actuellement, Peltier et al. (1994-a) préconisent ainsi pour le massif de Tientiergou une mise en défens très courte pendant les mois de la saison des pluies qui suivent la coupe.
Devant la difficulté de réaliser des mises en défens totales sans engendrer des mécontentements, ni des conflits avec les populations pastorales, on semble se diriger peu à peu vers une réduction, voire une élimination, de ce système trop dirigiste. Une courte mise en défens de quelques mois après la coupe est préférée si elle est concomitante avec un développement efficace de la gestion des pâturages (capacité de charge limitée en concertation avec les propriétaires, amélioration et rotation des parcours, création de points d'eau à des endroits stratégiques, etc.). Il est, de plus, primordial d'accroître la responsabilisation des populations pour la limitation réelle de la quantité de bétail par village ou la limitation de la durée de passage des transhumants. Cela semble être actuellement le seul moyen d'intégrer réellement un pastoralisme normalisé et raisonnable, évitant la surexploitation, et d'assurer la pérennité des ressources. Encore faut-il connaître et associer les différents types d'éleveurs et leurs besoins.
Dans le cas de forêts gérées pour la production de bois d'oeuvre, ces considérations devront être nuancées, car les espèces de grande valeur (Khaya Pterocarpus, Prosopis, Afzelia etc.) sont souvent les plus appétées. Pour éviter un port buissonnant, une protection contre le bétail est indispensable. Ainsi à Badénou (Côte d'Ivoire), la mise en défens est de trois années (Quatrième Partie, étude de cas n° 2).
d/ Les feux de brousse du point de vue du pastoraliste
Lorsque l'on évoque les feux de brousse, deux questions surgissent: leurs causes et leur utilité. Le point sur les feux de brousse a été réalisé par le CIRAD-EMVT avec les "Fiches techniques d'élevage tropical" (1990); les lignes qui suivent s'en inspirent largement.
A part quelques rares cas où ils sont dus à la foudre, la cause principale est anthropique. Le feu est volontaire (feux de chasse, de pasteurs, malveillance) ou accidentel (feux mal éteints de voyageurs, feux de nettoyage agricole qui débordent).
En Afrique, dans le paysage soudano-guinéen, le feu est un élément du maintien de la savane arborée ou boisée, la tendance étant l'évolution vers la forêt dense. C'est d'ailleurs le feu précoce de novembre qui permet le maintien de la savane arborée. En effet, la combustion du tapis herbacé à demi-sec à moins d'effets négatifs sur les ligneux qui commencent à être en repos, sauf en ce qui concerne les jeunes semis. Au contraire les feux tardifs de mars, avec un tapis herbacé totalement sec, atteignent les branches des arbres dont les jeunes feuilles commencent à se développer. Ces arbres sont contraints d'émettre de nouvelles pousses et s'épuisent.
L'auteur de la fiche conclut: "c'est l'homme qui dans cette zone climatique maintient la végétation de savane par la pratique des feux annuels (...). Savanes et forêts claires, dont les flores sont à peu de choses près identiques ont besoin des feux pour subsister".
L'impact du feu sur la richesse chimique du sol est réduit (encadré n° 19). La quasi totalité des éléments minéraux retourne au sol après brûlis, mais pas l'azote. Mais "il faut savoir cependant que l'approvisionnement du sol en matière organique résulte essentiellement ch' système souterrain dont la masse en région humide est bien plus élevée que la biomasse aérienne. La vitesse de renouvellement des racines dans les sols tropicaux est extrêmement rapide ".
Considérant l'aspect gestion des ressources naturelles par le feu précoce et le problème de la production animale, l'auteur de la fiche conclut pour le domaine soudano-guinéen: "le feu ne doit pas être considéré (...) comme un facteur de transformation, mais comme un facteur de conservation des savanes: il est nécessaire pour maintenir le cortège floristique de la savane et en particulier de la strate graminéenne indispensable à l'élevage".
Au Burkina Faso, depuis 1993, un dispositif compare la production de biomasse herbacée et ligneuse dans des parcelles d'essai (en forêt de Tiogo et de Laba, selon un dispositif statistique en split-plot), soumises au feu précoce et d'autres protégées des feux (tableau n° 20). La strate herbacée y est dominée par la famille des Poacées (plus de 80% de la population totale), soit essentiellement des espèces annuelles, telles que Andropogon pseudapricus, A. fastigiatus, Loudetia togoensis, Pennisetum pedicellatum, Diheteropogon hagerupii, Rottboellia exaltata, Microchloa indica et Hackelochloa granularis. Ces espèces caractérisent des sols superficiels et pauvres. Sur les sols assez profonds, des Poacées vivaces telles que Andropogon gayanus, A. ascinodis, Diheteropogon amplectens sont plus fréquentes. Les herbacées constituent l'essentiel de l'alimentation des ruminants domestiques et sauvages. En 1994, après deux années de protection contre les feux et une abondante pluviosité, une diminution de 54% de la biomasse est observée pour les herbacées annuelles et de 25% pour les plantes vivaces. La production annuelle de la biomasse herbacée est étroitement corrélée avec la pluviosité. Ces résultats doivent être confirmés d'autant plus que l'année 1994 a eu une pluviosité favorable. Pour la gestion future de ces forêts, la présence ou l'absence de feu influera directement sur le choix de l'aménagiste: l'absence feu favorise les ligneux, alors que les feux précoces sont favorables aux herbacées (Nouvellet et al., 1995).
Tableau n° 20: Evolution, avec ou sans feu précoce, de la biomasse des herbacées annuelles et vivaces (forêts de Tiogo et de Laba au Burkina Faso)
|
Herbacées annuelles (t/ha) |
Herbacées vivaces (t/ha) | ||||||
|
Années |
Pluvios. annuelle |
A |
B |
A - B |
C |
D |
C - D |
|
1992 |
894 mm |
2,54 |
2,49 |
+ 2 |
4,05 |
4,20 |
- 4 |
|
1993 |
748 mm |
1,96 |
1,22 |
+ 38 |
3,12 |
2,49 |
+ 20 |
|
1994 |
1130 mm |
3,30 |
1,51 |
+ 54 |
4,79 |
3,60 |
+ 25 |
Extrait de Nouvellet et al., 1995.
En zone sahélienne, où l'essentiel du tapis herbacé est constitué d'espèces annuelles qui sèchent sur pied dès le mois d'octobre, le problème est différent. En aucun cas le feu n'assurera des repousses. Dans cette zone, l'origine des feux est controversée; mais qu'elle qu'en soit la raison, ils sont à proscrire. A part une éventuelle destruction des parasites tels que les tiques, les inconvénients sont nombreux: disparition du disponible fourrager pour la saison sèche, élimination des jeunes régénérations de ligneux, mise à nu des sols. Toutefois il faut signaler que le stock grainier est relativement protégé; en effet' les graines tombent rapidement à terre dès le début de la dessiccation des herbacées.
La strate ligneuse clairsemée de la steppe sahélienne conduit fréquemment à la mise en place de pare-feu. Outre leur coût d'entretien élevé, ils ne sont pas d'une efficacité absolue. Il est préférable d'agir avec les populations d'éleveurs et de les sensibiliser afin de limiter les mises à feu volontaires. Il est également très utile de les former pour qu'ils se mobilisent dès qu'un départ de feu se produit près de leur campement.
Encadré n° 19: Biomasses, teneurs et masses minérales de la strate herbacée et des cendres avant et après le feu de brousse, en savane herbeuse à Loudetia simplex.
|
Biomasse g/m2 |
C |
N |
P |
K |
Ca |
Na | |||||||
|
|
Teneurs en % |
Masses min. g/m2 |
Teneurs en % |
Masses min. g/m2 |
Teneurs en % |
Masses min. g/m2 |
Teneurs en % |
Masses min. g/m2 |
Teneurs en % |
Masses min. g/m2 |
Teneurs en % |
Masses min. g/m2 | |
|
1972 | |||||||||||||
|
Strate herbacée |
606,7 |
41 |
249 |
0,191 |
1,157 |
0,0642 |
0,390 |
0,226 |
1,369 |
0,301 |
1,83 |
0,0077 |
0,047 |
|
Cendres |
57,4 |
15,6 |
9,0 |
0,268 |
0,154 |
0,371 |
0,213 |
0,985 |
0,565 |
2,33 |
1,34 |
0,0304 |
0,017 |
|
Taux de restitution % |
3,61 |
13,31 |
54,6 |
41,3 |
73,2 |
36,2 | |||||||
|
1973 | |||||||||||||
|
Strate herbacée |
379 |
40,1 |
152 |
0,277 |
0,051 |
0,0561 |
0,213 |
0,276 |
1,045 |
0,3 |
1,14 |
0,049 | |
|
Cendres |
49,4 |
10,1 |
5,0 |
0,142 |
0,070 |
0,513 |
0,253 |
1,510 |
0,746 |
0,013 |
0,017 | ||
|
Taux de restitution % |
3,29 |
6,66 |
118,8 |
71,4 |
0,035 |
34,7 | |||||||
|
Taux de restitution moyen |
3,49 |
10,14 |
77,3 |
54,3 |
73,2 |
35,4 | |||||||
|
Dans une savane herbeuse à Loudetia simplex de Lamto, Côte d'Ivoire, les teneurs en quelques éléments ont été mesurées dans la végétation immédiatement avant le feu, puis dans les cendres après le passage du feu de brousse. Les teneurs ainsi que les masses minérales par unité de surface sont données ci-dessus. Elles permettent de calculer le taux de restitution de chaque élément (pourcentage de l'élément restitué dans les cendres) En considérant les résultats moyens calculés SUI deux ans, on peut admettre que 54% du potassium, 73% du calcium et 77% du phosphore sont restitués par les cendres, alors que l'azote est perdu à 90%. Extrait de: Fiches techniques et élevage: les feux de brousse (1990). Ministère de la Coopération et du Développement - CIRAD-EMVT |
e./ L'émondage et l'ébranchage
L'émondage est un élagage, qui permet de prélever aussi bien les branches proches du tronc que l'extrémité des branches ou des rameaux à la périphérie de la cime (figure n° 17). C'est une pratique très couramment utilisée par les pasteurs des zones tropicales sèches pour augmenter la disponibilité en fourrage en fin de saison sèche. Les ligneux apportent près de 50% des protéines en période de soudure entre la saison sèche et la saison des pluies. Cet apport est donc vital pour les troupeaux.
D'après une étude relative au système d'élevage peuhl au Burkina Faso, celui-ci aurait peu d'influences nuisibles sur l'environnement, sauf sur les arbres émondés (De Boer et Kessler, 1994).
L'émondage et le recépage du Pterocarpus lucens paraissent susceptibles de prolonger considérablement la période de cueillette de feuilles vers la seconde moitié de la saison sèche (Le Houérou, 1980). L'émondage est plus productif en saison transitoire (octobre à janvier au Sahel) qu'en saison sèche chaude (mars-avril), alors que le recépage produirait l'effet inverse (Sepp, 1986).
Divers régimes d'émondage ou d'effeuillage (prélèvement des feuilles et des jeunes rameaux) ont été réalisés au Mali (Cissé, in Le Houérou, 1980) sur trois espèces (Combretum aculeatum, Cadaba farinosa et Feretia apodanthera): effeuillage total tous les quinze jours, effeuillage total tous les trente jours, effeuillage partiel, et témoin. Les résultats montrent que le rythme et l'époque d'ébranchage influent directement sur la production foliaire:
- la biomasse foliaire est la plus forte après la saison des pluies;
- une coupe partielle des branches et des feuilles est plus productive qu'une coupe totale;
- lorsque l'on compare les deux effeuillages, quinze et trente jours, la production est supérieure avec ce dernier rythme;
- l'effeuillage peut avoir sur la production foliaire un effet, soit dépressif (Cabada et Combretum), soit stimulant (Feretia);
- la richesse en protéines est inversement proportionnelle à la fréquence d'exploitation.
Ce même auteur (in Hiernaux et al., 1992) montre que l'ébranchage, lorsqu'il n'entraîne pas la mort de l'arbre, tend à étaler la saison de feuillaison. La chute des feuilles est retardée au point que les rejets, qui se maintiennent à l'état végétatif, peuvent rester feuillés en contre-saison. Ce phénomène est un des avantages pratiques de la technique d'ébranchage.
L'ébranchage n'a pas d'effets négatifs sur l'accroissement du diamètre de Prosopis cineraria en Inde, s'il n'est pas pratiqué chaque année (in Jensen, 1995).
Des essais réalisés sur Acacia seyal au Burkina Faso (Toutain et Piot, 1980) ont montré qu'une coupe totale des branches d'arbres traités en têtards (encadré n° 20) est très préjudiciable à cette essence. Le traitement le moins dommageable consiste en un ébranchage au tiers du houppier. Quoiqu'il en soit, les auteurs affirment qu'il n'est pas possible à partir de leurs résultats de préconiser un type d'ébranchage garantissant la pérennité des individus. L'ébranchage total cause une mortalité importante (60%) après traitement.
Une exploitation excessive peut conduire à une modification du peuplement au détriment des espèces ligneuses fourragères: Cissé (in Le Houérou, 1980) cite par exemple la substitution de Combretum micranthum et Acacia ataxacantha par Pterocarpus lucens, Acacia seyal et Combretum aculeatum.
|
Encadré n° 20: Les peuplements de chênes têtards Les peuplements de chênes têtards au pays Basque peuvent être décrits comme des boisements lâches (vingt à cinquante tiges par hectare) de chêne pédonculé, dans lesquels les arbres présentent un fût d'environ trois mètres et un houppier très développé constitué de fortes branches; entre ce couvert boisé, discontinu, s'étendent des landes à fougères. Cet espace forestier, si particulier, encore observable de nos jours sur des séries entières de forêt communale, a été façonné, au cours des décennies, par un traitement original dû à la volonté que les Basques ont toujours eue de concilier, sur des terrains voués au libre parcours, les trois productions essentielles à leur activité pastorale: la nourriture du cheptel, la production de bois pour les besoins domestiques et la récolte de litière. Pour atteindre cet objectif, les arbres étaient périodiquement (tous les dix à quinze ans) écimés, en totalité ou partiellement à quelques mètres du sol. Cette taille en "têtards" présentait l'avantage de permettre le développement des rejets au-dessus de la "dent du bétail" et la pousse d'un houppier abondant. Ainsi, du début du XIXème siècle jusqu'en 1930, les aménagements forestiers définissaient des séries dites "d'étêtement" où le règlement d'exploitation déterminait le nombre de têtards à passer en tour chaque année et la possibilité-volume à récolter ainsi que les règles de culture à observer (maintien de quelques tirants de sève). Mais l'évolution des techniques d'exploitation et le non-renouvellement des arbres "épuisés" par la fréquence des coupes ont conduit à un 'abandon progressif de ce traitement en forêt, que d'aucuns ont appelé, non sans malice, "des taillis SUI futaie". Extraits de Aureau, 1989. |
En Zambie, les pasteurs ont recours aux feux au fur et à mesure que la saison sèche s'avance: brûlis et suppléments de ration sont nécessaires. Le type de culture itinérante (appelée "chitimene"), utilisé dans les miombos, peut concilier certains des intérêts des éleveurs, des forestiers et des agriculteurs. Les arbres sont recépés pendant la saison sèche à une hauteur comprise entre un et deux mètres en laissant plusieurs moignons de branches (les étêtages ou tailles en têtard permettent une "régénération" plus rapide que les coupes au ras de terre). Le feuillage est brouté par le bétail. Ensuite, les branches sont entassées sur le sol et brûlées juste avant le début de la saison des pluies. Cette culture itinérante se prolonge pendant trois à cinq années, avant de céder la place à une jachère à base de Brachystegia - Julbernardia, qui reprendront le dessus au bout d'une vingtaine d'années (Celander, 1983)
Globalement, peu d'études ont été réalisées sur la capacité de réponse des espèces en fonction de l'émondage, de l'ébranchage et de la conduite en tétard Celles qui ont été effectuées montrent que:
- cette pratique, si elle est excessive, porte atteinte à la survie des espèces;
- les arbres sont plus souvent attaqués par les termites;
- en cas d'incendié, le feu se propage à tout l'arbre, principalement dans le cas des "arbres-parapluies", dont les branches, à moitié coupées, traînent au sol et protègent les herbacées du broutage (d'où réserve de paille combustible);
- l'effet de l'émondage est variable suivant les espèces et les saisons;
- l'émondage permet de prolonger la période de cueillette vers la seconde moitié de la saison sèche pour certaines espèces.
L'intégration ou non de ces pratiques dans certains des projets d'aménagement, actuellement en cours, est donc très variable:
- au Burkina Faso, dans la forêt du Nazinon, l'émondage des arbres est complètement interdit;
- Nouvellet (1992) propose un "élagage contrôlé", pour éviter un trop fort prélèvement entraînant une mortalité précoce;
- au Niger, dans la forêt de Tientiergou, l'aménagement autorise l'émondage, à plus de deux mètres de haut, pour les espèces susceptibles de fournir du fourrage aérien (Peltier et al., 1995);
- au Mali, les contrats de gestion villageoise des arbres fourragers notamment du Pterocarpus erinaceus (menacé) en forêt classée des Monts Mandingues (pour l'élevage urbain des moutons) constituent vraisemblablement à ce jour l'expérience la plus intéressante et la plus instructive dans ce domaine.
Des groupes d'exploitants se sont organisés, sous l'égide de l'Opération Aménagement et Productions Forestières (OAPF). Des contrats ont été négociés selon les principes suivants:
- sécurisation et précision des droits;
- respect de la "capacité de charge";
- transfert de certains devoirs, y compris investissement dans le capital fourrager, et auto contrôle de l'exploitation de la zone;
- respect pour l'organisation "traditionnelle";
- simplicité.
Ces contrats de gestion visent la protection des droits des exploitants pous 5 ans (Anderson et al., 1 994).
Notons en passant que l'ébranchage est généralement prohibé dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas sans poser un sérieux problème aux agriculteurs qui souhaitent pouvoir exploiter librement les arbres des parcs. Les essais relatifs à la technique, l'époque, l'intensité de l'ébranchage, de l'écimage, de l'élagage, de l'émondage, de la conduite en tétard, ne sont pas assez nombreux, ce qui laisse planer un doute sur la possibilité de renouveller régulièrement les parcs arborés qui dans quelques années constitueront sans doute la principale ressource ligneuse des zones sahéliennes surpeuplées. La législation relative aux arbres éparpillés dans les champs de culture devrait être réactualisée.
Afin d'améliorer la lisibilité de ce type d'expérimentation, la synthèse des observations et des résultats relevés doit au préalable passer par une définition précise des termes employés et des modalités de prélèvement (saison, périodicité, durée de l'essai, âge présumé des arbres, dispositif statistique, etc.). La figure n° 17 permet de mieux comprendre le sens des termes employés.
Des recherches sont encore nécessaires afin de mieux appréhender les conséquences de ce système d'exploitation et de proposer des prélèvements n'entraînant ni un affaiblissement, ni la mort de l'arbre.
Figure n° 17: La taille des arbres (von Carlowitz, 1991)
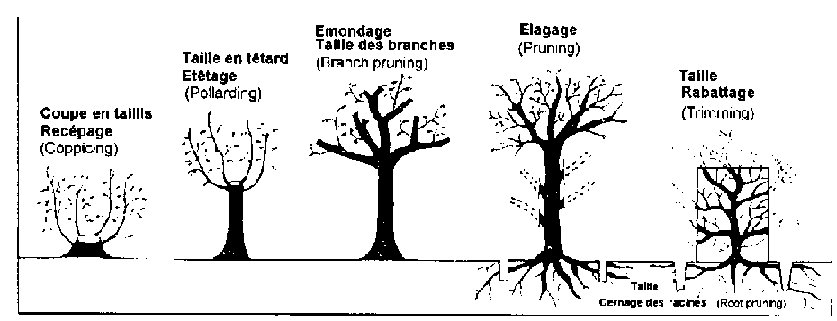
La production de fourrage aérien dépend de nombreux facteurs qui doivent encore être étudiés. A titre d'exemple (hors zone étudiée), la production potentielle de feuilles de mûrier en fonction de la taille de formation des arbres et de leur espacement est schématisée ci-après (figure n° 18).
Figure n° 18: Production potentielle de feuilles de murier selon la forme des arbres et leur espacement
