Table des
matières - ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
a/ règles d'usage, principes préconisés, structures de surveillance
Théoriquement, la gestion des terres de parcours peut être organisée selon les principes qui prévalaient avant la sécheresse, grâce à une bonne entente entre agriculteurs et éleveurs en zone soudanienne et l'exploitation d'une chaîne alimentaire naturelle.
Dans la réalité des faits, on se trouve, pour reprendre les termes de Boudet (1990) devant "un imbroglio juridique et culturel", l'utilisation des terres de parcours n'étant qu'un droit d'usage non considéré comme une mise en valeur. Par conséquent, le développement agricole se fait aux dépens de l'espace pastoral, qui de plus, tend à se réduire au nord en raison de la sécheresse.
Dans ces conditions, il devient indispensable d'édicter des règles d'usage concernant l'exploitation des terres de parcours par les transhumants:
- le régime alimentaire du cheptel, les risques climatiques imposent une mobilité des éleveurs;
- cette mobilité a fait ses preuves depuis des siècles face aux divers aléas qui ont éprouvés ces populations;
- les entités géographiques dans lesquelles les transhumants évoluaient doivent être reconnues par l'administration après un large consensus entre toutes les parties en présence; des "unités pastorales" seront ainsi créées confortant les droits d'usage et prévoyant des zones refuges en cas de déficit pluviométrique au Sahel.
Sur le plan technique, en s'inspirant de Boudet (1990), les principes suivants pourraient être préconisés pour les parcours:
- exploitation "modérée" du Sahel en saison des pluies;
- mise en repos périodique des parcours sahéliens;
- adaptation de la charge de saison sèche au stock fourrager;
- création de réserves sur pied pour la saison sèche chaude;
- adoption d'une exploitation consensuelle des terroirs agropastoraux après récoltes vivrières;
- identification d'espaces interstitiels auxquels un droit d'usage aux transhumants serait accordé;
- gestion des feux, protection autour des points d'eau, contrôle de ceux des zones inondables, après assèchement de milieu de saison sèche.
Sur le plan national, la création de structures de surveillance continue s'impose Les méthodes existent et ont été expérimentées. Elles se basent sur la télédétection, en particulier l'imagerie NOAA, irremplaçable pour l'alerte rapide, et sur l'étalonnage au sol (Gaston, in Audru et al., 1987).
Les terres de parcours et les terroirs agro-pastoraux se trouvent confrontés, en raison des évolutions climatiques et démographiques à un grave problème d'espace. Deux paramètres fondamentaux doivent être gérés:
- l'utilisation terres de parcours (appropriation, droits et règles d'usage) qui relève des sciences sociales et de l'organisation administrative;
- l'exploitation des ressources du sol et de la végétation, qui concerne directement l'agronomie et l'écologie du milieu végétal.
En effet, le dénominateur commun de l'ensemble des parcours (de la jachère de courte durée à la savane boisée en passant par les pâturages de décrue) est la conservation des potentialités et même leur amélioration.
b/ Pâturage en continu: forme insidieuse du surpâturage
Les travaux de César (1992) au nord de la Côte d'Ivoire montrent que la production de biomasse dépend de facteurs climatiques et est affectée par les déficits hydriques. Les conditions édaphiques et le couvert ligneux interviennent également.
Sous pâture, cet auteur, étudiant les différents rythmes d'exploitation propose des équations prédictives d'exploitation optimale permettant de conserver le potentiel fourrager. Les espèces à forte productivité et bonne appétence se maintiennent avec une forte charge instantanée limitée dans le temps. César écrit: "il semble donc que l'on ait intérêt à exploiter ces savanes avec une forte charge instantanée de manière à obtenir la pâture la plus régulière possible et à laisser en contrepartie des temps de repos suffisants, de l'ordre de trente jours. Un tel mode de gestion serait préférable à la gestion habituelle qui se rapproche d'une gestion en continu" (figure n° 19).
L'exploitation en continu, créant très souvent des situations de surpâturage, provoque une baisse de production des repousses. Les graminées ne peuvent plus reconstituer leurs réserves souterraines, d'où il s'ensuit un épuisement du système racinaire dont la masse diminue. La production sera moindre l'année suivante. Une mise en repos permet, car le sol n'est pas épuisé, une reconstitution des potentialités pastorales.
La poursuite du pâturage en continu est une forme insidieuse de surpâturage qui ne se traduit pas par une dégradation visible de la surface du sol. "La biomasse racinaire diminue, n'approvisionne plus le sol en matière organique et l'horizon humifère s'amincit et disparaît. Les Graminées fourragères de savane meurent par épuisement et seule subsiste une maigre flore d'annuelles et psammophiles capables de résister aux nouvelles conditions édaphiques. Cette évolution peut aboutir en cinq à dix ans" (César, 1992).
Ces études pertinentes montrent que ces ressources, jachères anciennes et savanes, qui paraissent être peu fragiles et disposer de suffisamment de biomasse, doivent être gérées avec beaucoup d'attention. La gestion des parcours en zone de savane doit évoluer en fait entre le maintien des potentialités et la lutte contre l'embroussaillement.
Figure n° 19: Schéma d'évolution de la composition floristique sous l'action de divers traitements dans le ranch d'Abokouamékro en Côte d'Ivoire.
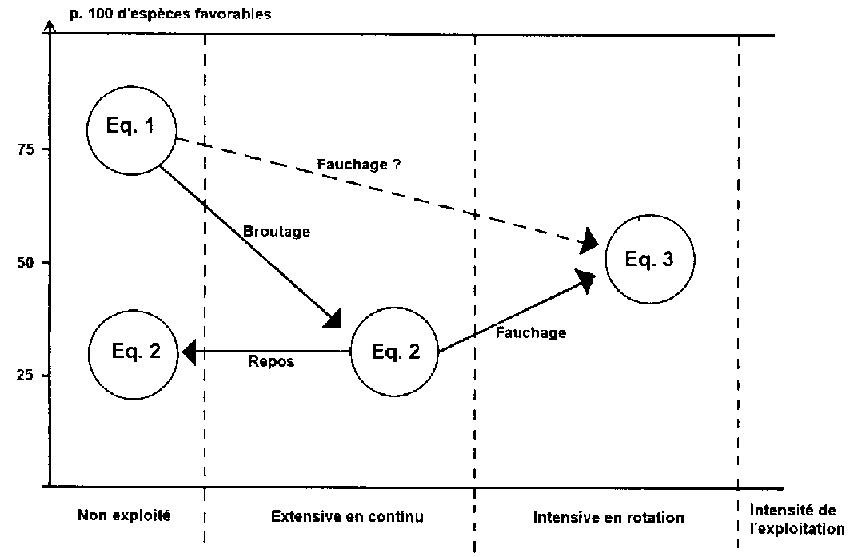
1/ Dans la savane naturelle d'Abokouamékro, les espèces favorables (Andropogonées) sont dominantes (équilibre 1).
2/ L'exploitation en pâture continue par le bétail fait régresser les espèces favorables au profit de Loudetia arundinacea (équilibre 2). La mise au repos de la savane ne modifie pas ce nouvel équilibre.
3/ L'exploitation intensive par coupe permet une inversion du sens de l'évolution, avec régression du Loudetia et extension des Andropogonées (équilibre 3).
La flèche en pointillé ne correspond pas à une expérimentation à Abokouamékro, mais à des résultats obtenus dans d'autres stations.
A ce propos, César (1992) signale que le "développement des strates ligneuses était l'évolution naturelle de toute formation du domaine soudano-guinéen et que cette tendance s'accroît avec la pâture". La solution qu'il propose, pour réduire les ligneux, consiste en une mise en défens (qui fournira la matière herbacée combustible), puis le feu de brousse précoce.
L'embroussaillement par les ligneux est également connu depuis longtemps en République Centrafricaine. Dès 1965, Bille signale les problèmes engendrés par Harungana madagascariensis. Actuellement, à cause du pâturage qui favorise la dispersion des graines de certaines espèces, l'envahissement par Chromolaena odorata (herbe du Laos), peste végétale d'introduction récente, s'accentue (Audru, 1988)
c/ Gestion attentive et multidisciplinaire
En conclusion, la gestion de l'espace pastoral des formations ligneuses tropicales sèches doit rechercher un équilibre du paysage végétal freinant la tendance naturelle à l'embroussaillement, mais favorisant le maintien des Graminées fourragères.
Cet équilibre, relativement simple à énoncer nécessite en fait sur le plan technique une excellente maîtrise des feux et une bonne capacité des pasteurs, aidés des techniciens, à effectuer un diagnostic pastoral pour exploiter l'herbe à la période optimale, tout en maintenant un bon niveau de fertilité du sol. Cette fertilité est vitale. Elle garantit soit une bonne production fourragère, soit un gage de succès en cas de remise en culture de la jachère de longue durée.
Sur un plan que l'on peut qualifier de sociologique, la gestion de l'espace pastoral en forêts tropicales sèches passe impérativement par l'adoption consensuelle de règles d'usage. Elles concernent aussi bien l'adoption:
- d'unités pastorales géographiques;
- la complémentarité éleveurs, agropasteurs et forestiers;
- le respect des mises en repos périodiques, des dates d'utilisation des feux de brousse et des charges retenues.
La contrepartie administrative implique un encadrement adapté faisant intervenir des agents ayant reçu une formation appropriée qui doit aller au-delà des formations agricoles, forestières et vétérinaires actuelles.
La surveillance continue, aussi bien sous son aspect alerte rapide que son évolution dans le moyen terme, constitue l'outil scientifique indispensable à la mise en oeuvre d'une gestion conservatoire des ressources naturelles renouvelables. Elle doit être le fruit de la participation des services agricoles, forestiers, vétérinaires, hydrauliques, météorologiques et de l'aménagement du territoire.
Ces techniques et propositions, au niveau des exploitants agricoles sont réalisables immédiatement. Mais l'amélioration de l'élevage passe aussi par des techniques telles que la fenaison et la régénération de pâturages.
4.4. Interventions amélioratrices
Nous nous limiterons à deux types d'interventions nécessitant des intrants, modestes certes, mais qui créent tout de même un frein important à leur vulgarisation: la fenaison et la régénération de pâturages.
a/ Le foin
Le foin se définit comme un fourrage sec. Il provient d'herbe récoltée en vert et séchée au soleil, puis conservée pendant plusieurs mois avant d'être donnée aux animaux. Si au moment de la récolte, l'herbe est sèche sur pied, on ne parle plus de foin, mais de paille. Cette nuance est très importante: dans le premier cas, le foin a gardé beaucoup de ses qualités alimentaires; dans le second, elles ont quasiment disparu.
Pour obtenir un foin de qualité, il faut faucher de l'herbe verte au stade de maturité. La fauche peut être manuelle (faucille, faux) ou mécanisée (traction animale ou motorisée). La fauche manuelle est pénible et nécessite beaucoup de main d'oeuvre. Une famille peut stocker des réserves pour quelques bovins dans le cas d'une exploitation agricole, mais cette méthode est exclue pour un éleveur intensif. La fauche mécanisée permet de traiter des surfaces beaucoup plus grandes. Une paire de boeufs peut tracter une faucheuse à lame.
L'herbe une fois fauchée, de préférence en début de journée, doit être séchée au soleil et retournée plusieurs fois. Généralement, il faut deux à trois jours pour que la dessiccation soit complète, ce qui implique la mise en petites meules pour la nuit et lorsque la pluie survient. En effet, si l'herbe conserve ses qualités lorsque le séchage a été rapide, la pluie, surtout si elle survient en fin de séchage, lessive les éléments minéraux du foin, ce qui le rapproche de la paille. Cette technique de fanage, relativement simple, nécessite de la part du paysan une certaine organisation et prévision entre le moment de la coupe, la quantité de foin en fonction des personnes disponibles et une estimation des risques de pluies.
Après récolte, le foin doit être stocké, si possible sous forme de meule tassée afin de le protéger du soleil et de réduire son encombrement. Le stockage sur le toit des cases n'est qu'un pis-aller relativement dangereux. D'autres réserves de fourrages sont réalisées par les paysans et les éleveurs. Ils stockent des chaumes de céréales, des fanes d'arachide, des gousses de Faidherbia albida, de la paille de brousse qui parfois fait l'objet d'un commerce près des villes, de l'Echinochloa stagnina (bourgou) vendu en vert sur les marchés, etc.
Sous la pression des besoins en fourrages, cette tendance au stockage prend de l'ampleur depuis plusieurs années. La demande ne pourra que s'accentuer, il est donc possible que la récolte de foin puisse se développer au moins ponctuellement.
b/ L'amélioration des pâturages
Cette activité qui demande beaucoup de main d'oeuvre, souvent à une période où elle n'est pas disponible, se révèle de plus rapidement onéreuse. Elle ne peut donc s'exercer que sur des surfaces limitées, ce qui facilitera la surveillance, car les parcours restaurés sont souvent parcourus par des troupeaux extérieurs.
Les travaux réalisés sur ce thème se sont déroulés en Afrique, principalement au Sahel: au Burkina Faso (Toutain et Piot, 1980), au Tchad (Guervilly et Bouba, 1992; Toutain, 1993), au Sénégal (Diatta et Mandret, 1991; Roberge, 1994).
L'amélioration la plus simple consiste en des travaux du sol. Autant que faire se peut, le sol est gratté ou labouré à la charrue selon les courbes de niveau; les lignes sont espacées d'une dizaine de mètres (figure n° 20). Ce travail léger est suffisant pour retenir l'eau et les graines des espèces annuelles. Après les pluies, les lignes herbacées sont nettement visibles et sont efficaces pour plusieurs années, le temps que toute la surface du sol ait pu être reconquise.
Ceci suppose évidemment une mise en défens rigoureuse pendant deux à trois ans. Cette technique peut être améliorée en semant sur les lignes des graines d'espèces fourragères. Pour débuter, il est généralement d'usage de se limiter à des graines d'espèces naturelles qui auront été récoltées la saison sèche précédente. Les résultats sont encourageants, mais de tels travaux nécessitent, de la part de la communauté villageoise qui les entreprend, un contrôle parfait de l'espace de leur terroir.
Figure n° 20: Profil schématique d'une parcelle sous-solée et billonnée en demi-lune.
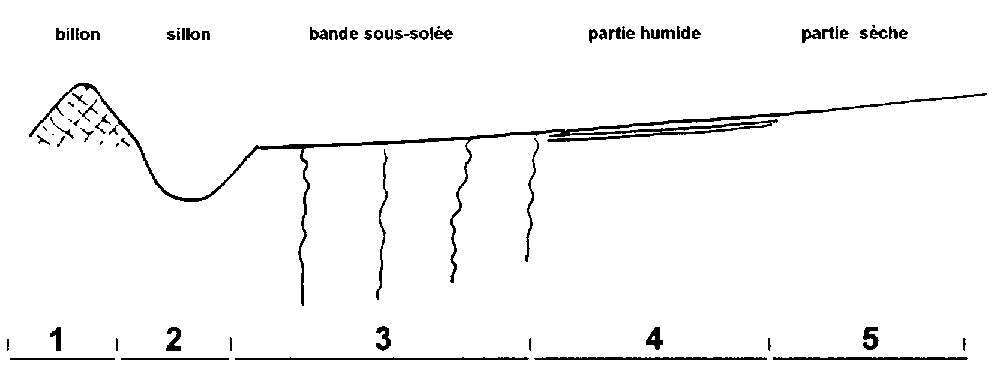
Cette technique peut être perfectionnée en traçant les lignes avec une charrue et un tracteur. Le creux et le dévers forment un petit fossé qui retient l'eau et les graines sur le dévers, des Légumineuses, des Graminées vivaces et des arbustes fourragers peuvent être semés. Une variante préconise de tracer ce même fossé en demi-lune afin de recueillir l'eau d'un microbassin versant. Dans ce cas, les résultats sont plus spectaculaires, mais le terrain doit faire l'objet d'une mise en défens très stricte. Il n'est pas rare de voir la végétation se développer entre les petits fossés de rétention d'eau, notamment des régénérations spectaculaires de ligneux.
Ces techniques, qui ont montré leur efficacité dans des terrains très dégradés, ne constituent pas par elles-mêmes la solution aux problèmes de la dégradation des parcours. Mais, bien conduites dans un contexte d'ensemble de responsabilisation des communautés rurales pour la gestion de l'aire des terroirs, elles constituent une excellente démonstration des potentialités de la végétation naturelle, particulièrement bien adaptée aux conditions extrêmes des terres marginales.
Chapitre VIII - Bilan et outils: Les sciences sociales
1. Les méthodes et les moyens d'observations
2. Multi-usages et multi-acteurs
3. La prise en compte de facteurs socio-économiques lors de l'aménagement
4. L'aménagement par delà l'espace forestier
L'aménagement des espaces forestiers tropicaux a longtemps procédé d'une approche centrée sur la connaissance et la gestion de l'espace naturel dans ses fonctions biologique et physique. Les sciences sociales étaient peu mobilisées. Depuis quelques années, la prise en compte des relations qu'entretiennent les populations avec les espaces forestiers est l'une des préoccupations majeures des aménagistes et il n'est plus question d'aborder la gestion des massifs forestiers sans tenir compte des aspects "socio-économiques" qui lui sont associés. Les échecs successifs qu'ont connus un grand nombre de projets rendaient cette évolution nécessaire.
Le terme "sciences sociales" rassemble un nombre relativement important de disciplines scientifiques et donc d'approches et ce chapitre tente de montrer comment cette diversité et ces complémentarités peuvent participer à l'aménagement des forêts tropicales en zones sèches. Toutefois, il n'existe pas de voie royale et la complexité des phénomènes oblige à une certaine prudence. Il ne s'agit pas de proposer une revue systématique de tout ce qui a été tenté encore moins de théoriser les différentes pratiques, mais plus modestement de donner un aperçu sur certains points qui nous paraissent importants.
1. Les méthodes et les moyens d'observations
1.1. La caractérisation de "l'objet socio-économique"
1.2. Les enquêtes
1.3. La nature de l'information à collecter
1.4. GPS et GIS de nouveaux outils pour les sciences sociales ?
A l'identique du forestier qui analyse l'existant biologique au travers de l'évaluation des ressources ligneuses et de la description du milieu physique et naturel, le spécialiste des sciences sociales a recours à des méthodes et des moyens d'observations directes pour établir ''ne base de connaissance du milieu socio-économique auquel il s'intéresse.
1.1. La caractérisation de "l'objet socio-économique"
L'une des premières questions que peut se poser l'homme des sciences sociales concerne la nature de ses interlocuteurs: quels sont les individus qui sont concernés par l'aménagement et où sont-ils? Cette connaissance de "l'objet" ne lui sera pas donné a priori et il n'arrivera à en déterminer le contour que peu à peu, au fur et à mesure qu'il dévoilera les relations qui associent les différents acteurs. Cependant, la question est première, dans le sens qu'il faut en connaître pour partie la réponse, si l'on désire travailler avec efficacité.
Ces premières initiatives devraient conduire à la réalisation de cartes, qui peuvent être associées à un SIG, positionnant les interlocuteurs directs dans leur contexte géographique, administratif, économique, etc. et à la constitution de bases de données. Pour ce faire, on pourra avoir recours aux cartes existantes, aux archives, aux documents disponibles mais il est clair que toute cette information doit faire l'objet d'une "vérité terrain".
L'enquête est l'une des clefs universelles de la boîte à outils du socio-économiste. Avant d'en discuter les méthodes, les capacités et les limites, il est nécessaire de prendre conscience qu'elle participe au dialogue qu'entretiennent les aménagistes avec les populations. Puisque l'aménagement se traduira par la réalisation d'un compromis entre les différents usagers de l'espace forestier, cette finalisation ne doit pas être négligée même lors des phases exploratoires.
L'enquête est une méthode d'obtention d'informations au service d'un ou de plusieurs objectifs, qui comporte trois phases principales: la conception, la réalisation et l'analyse. Elle comporte des contraintes au demeurant classique: fournir le maximum d'informations de qualité dans des délais minimaux et au moindre coût. Ajoutons que les enquêtes sont, dans des pays qui ne disposent pas généralement de statistiques nationales ou locales fiables, un des rares moyens d'obtenir des informations sur un aspect particulier. Tout un chacun est confronté à cette situation, qu'il s'agisse des décideurs, des chefs de projets et des scientifiques, que le sujet d'intérêt soit la forêt l'agriculture ou l'aménagement du territoire.
Dans les années 1970-1980, un effort particulièrement important a été réalisé pour améliorer les méthodes d'investigation en milieu rural africain par le groupe AMIRA10. Malheureusement, aucun ouvrage de synthèse n'a résulté de ce travail. De plus, il n'existe pas à l'heure actuelle et en l'état de nos connaissances de manuel polyvalent d'enquête en sciences sociales pour l'aménagement des forêts. Toutefois, on pourra se reporter à un ouvrage très complet comme celui de Dubois et Blaizeau (1989) qui traite "des conditions de vie des ménages dans les pays en développement" et qui est organisé selon le triptyque proche de celui que nous avons rappelé: concevoir, collecter et analyser.
10 AMIRA: Amélioration des méthodes d'investigation en milieu rural africain (Paris).
1.2.1. La conception de l'enquête
C'est tout d'abord au regard d'un objectif donné, définir l'information que l'on recherche, le niveau de précision acceptable, la nature et l'unité d'observation, la population ou la sous- population concernée, les variables et les caractères explicatifs associés à l'objectif principal, et le contexte dans lequel on va opérer. Très souvent, on est d'ailleurs conduit à procéder à des pré-enquêtes, à confronter certaines options, à tester des démarches et/ou hypothèses. Cette phase ne conduit pas ou très rarement à un questionnaire, mais plutôt à un cahier des charges.
Encadré n° 21: Quelles unités d'observation'? En
matière d'enquêtes en sciences sociales le choix des
unités d'observation n'est pas toujours une chose
évidente. Il dépend en grande partie des objectifs
précis assignés à l'étude et aux besoins en
informations. Ainsi, on peut enquêter au niveau de la
structure villageoise, de l'entreprise du lignage, de la
famille du ménage, du foyer, de la maison, de
l'individu, etc. En règle générale lorsque l'on
désire des informations très précises sur un domaine,
on essaye d'enquêter au plus près du centre de
décision ou d'action concernant ce domaine. Mais, ce
type d'approche peut s'avérer trop coûteux ou trop long
et l'on peut décider d'enquêter à un niveau
d'agrégation supérieur. |
1.2.2. La réalisation de l'enquête
La réalisation comporte de nombreux préalables qui relèvent de la théorie des enquêtes et des sondages ou qui sont attachés à la spécificité du cas étudié. Dans ce paragraphe, nous ne retiendrons que deux aspects de cette étape: les techniques de relevés et l'organisation pratique de la collecte.
a/ Les techniques de relevés
Trois grandes familles de techniques existent. Elles ne sont pas équivalentes et peuvent être complémentaires.
Les carnets:
On fait appel aux enquêtés en leur demandant de remplir par eux-mêmes un carnet destiné à cet effet. On peut de cette manière obtenir des données sur des consommations, des déplacements des emplois du temps, des dépenses, etc. Ces renseignements peuvent être consignés au fur et à mesure (à la manière d'un livre de compte) ou d'une manière récapitulative (comme un bilan annuel ou une déclaration de revenus). Ces techniques ont l'avantage de permettre de travailler auprès d'un nombre important d'enquêtés, éventuellement à distance et de manière répétée. Elles peuvent donner d'excellents résultats lorsque les participants sont motivés. Longtemps négligées dans les pays où l'illettrisme est important, ces méthodes ou des formes équivalentes peuvent être un recours utile si elles sont très simples et bien adaptées aux possibilités de la population enquêtée.
Les mesures:
En fonction des objectifs de l'enquête, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des mesures directes ou indirectes. Ainsi, certaines informations ne sont pas détenues par les enquêtés (apports nutritionnels de produits forestiers) ou sont souvent imprécises (consommation ou transport de bois de feu). Cette approche est hélas très coûteuse. Son usage et le degré de précision dans les mesures doivent être mûrement réfléchis, la mesure n'étant pas forcément un gage d'amélioration de l'information.
L'entretien:
La dernière grande famille de techniques de relevés est l'entretien ou interview. C'est certainement la technique la plus couramment employée, parfois de façon peu satisfaisante. Elle s'organise souvent autour d'un questionnaire lors d'un entretien entre un enquêteur et une personne ou un groupe de personnes. Le questionnaire comprend un ensemble de questions articulées entre elles, adressé à une même unité statistique et le plus souvent à un même niveau d'observation. La réalisation d'un questionnaire est un travail particulièrement délicat car de sa structure dépend en grande partie la qualité de l'information recueillie et la facilité du traitement associé. Différentes techniques peuvent être utilisées dans un questionnaire. La première distinction courante est faite entre questions de type ouvert ou fermé: dans un cas l'interrogé est libre de sa réponse, dans l'autre il a le choix entre plusieurs réponses pré-définies.
En dehors de ces deux classiques, le questionnaire peut être beaucoup plus interactif. On peut être amené à demander à l'interrogé d'effectuer des classements dans des échelles de valeur ou des regroupements entre des propositions, de commenter des images ou des textes, de dessiner, de raconter, etc.
La conduite d'entretien sans questionnaire est une technique dont les objectifs sont souvent distincts de ceux des enquêtes plus formalisées. On l'utilise plus facilement pour obtenir des informations d'ordre qualitatif et elle peut être complémentaire de l'enquête par questionnaire. Elle demande avant tout une expérience plus pointue du praticien pour être efficiente. Certaines informations particulièrement complexes sont plutôt recherchées avec ce type d'entretien.
b/ La réalisation pratique de l'enquête
La phase de recueil proprement dit est aussi un moment très délicat puisqu'elle est basée sur une relation d'échange, parfois même de confiance entre enquêteur et interrogés. Il faut expliquer en quoi cette enquête à un intérêt pour les interrogés, préciser à quoi elle va servir, garantir éventuellement la confidentialité de certaines données, etc. Quelques recommandations élémentaires et souvent de bon sens sont proposées (Dubois et Blaizeau, 1989):
- consacrer suffisamment de temps pour introduire le sujet;
- enchaîner les questions par emboîtements successifs;
- procéder par association d'idées;
- éviter les questions trop longues ou complexes;
- bien référencer les questions;
- spécifier à qui s'adresse l'entretien;
- réfléchir sur le moment et le lieu les plus propices à l'entretien.
La réalisation pratique de l'enquête est également tributaire des compétences du personnel recruté à cet effet, de sa formation et de son suivi ainsi que de différentes modalités de contrôle. Il s'agit de points essentiels qui conditionnent la réussite de cette activité et qui doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.
1.2.3. L'analyse des résultats
La méthode d'analyse dépend très évidemment de la nature des informations.
Avant toute chose, elle doit comporter une phase dite d'apurement au cours de laquelle les données sont explorées dans un souci de validation et d'élimination des données aberrantes. Pour cela, elle doit avoir été réfléchie dès la phase de conception, qui aura prévu de procéder à une vérification soit en ayant recours à des sources d'informations complémentaires, soit en croisant des informations extraites de la collecte.
Du strict point de vue de l'analyse, on peut faire appel à des méthodes statistiques mais en ne négligeant pas que ces dernières ne se substituent pas au pratricien au moment de l'interprétation. Enfin, il est important de prendre en compte que les opérations d'enquêtes nécessitent souvent de procéder à une restitution des résultats et qu'il est important de faire un effort pédagogique pour pouvoir en présenter clairement les conclusions.