Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
2.4.1. Révolution
Une révolution provisoire de 20 ans, décidée par le Service Forestier, a été adoptée pour la FCN du fait du faible niveau des connaissances relatives à la productivité des formations naturelles et de la méconnaissance des paramètres tels que le volume sur pied et les cycles de sécheresse. La fixation de cette révolution s'est également inspirée des taux d'accroissement annuel calculés par Clément (1982): 0,66 m3/ha/an pour les formations forestières naturelles non protégées et non aménagées et 0,83 m3/ha/an pour les formations protégées ou aménagées. Elle s'est appuyée en outre sur les performances attendues des mesures de protection (encadré n° 33) proposées.
Encadré n° 33: Périodes de mises à feu précoces La lutte préventive et active contre les feux de brousse est assurée par des brigades constituées de volontaires issus des groupements de gestion forestière. La technique de mise à feu séquentielle des aires à graminées a été adoptée en 1988. Trois grands ensembles de Graminées ont été identifiés en fonction du rythme de dessiccation des herbacées (annuelles ou pérennes):
Des layons qui servent de réseau pare-feu sont ouverts avant la mise à feu: layons périmètraux des parcelles de coupe et layons servant de contre-feu. Puis les blocs les plus sous le vent et en bordure de zones à protéger | (champs agricoles) sont brûlés les premiers, le feu étant allumé à contre-vent. |
2.4.2. Traitement sylvicole, régénération et exploitation
Les premières conclusions partielles des études sur la reconstitution des peuplements naturels ont déconseillé le taillis simple et préconisé un "taillis sous futaie avec coupe sélective". Cette méthode est régie par un règlement d'exploitation qui comprend les critères suivants:
- densité: exploitation interdite dans les sites présentant moins de 200 pieds (souches)/ha, selon une estimation visuelle;
- état sanitaire: coupe en priorité des arbres les plus atteints par des maladies ou des malformations;
- dimensions commercialisables: exploitation des arbres dont le diamètre (à hauteur de poitrine) est compris entre 10 et 25 cm;
- protection des essences protégées ou peu représentées;
- écologie: conservation des formations sur termitière, sur les fortes pentes, sur les glacis, et aux abords des cours d'eau, ainsi que des arbres semenciers;
- régénération: par semis ou multiplication végétative naturelle:
* la régénération naturelle par semis: certaines espèces comme Butyrospermum paradoxum germent aisément au cours de la saison des pluies. Cependant il faut préciser que la majorité des plantules périt dès le début de la première saison sèche et les feux détruisent les survivants;
* la régénération par semis direct: le semis direct a été adopté comme technique de régénération artificielle en raison de son coût réduit (1 700 F CFA/ha) et de sa maîtrise rapide par les populations. En effet, le semis direct fait appel aux techniques et aux outils utilisés pour semer les céréales dans les champs;
* la régénération par rejets de souches: les essences qui font l'objet de coupes rejettent bien, sauf Acacia dudgeoni. La vigueur des rejets est généralement fonction de l'état sanitaire et de l'âge de l'arbre abattu. Cette forme de régénération, bien que satisfaisante en ce qui concerne la croissance en hauteur (4 à 6 mètres en quatre ans, pour Detarium microcarpum, Butyrospermum paradoxum) pose des problèmes pour l'avenir. En effet, le nombre de passages en coupe, que peuvent supporter ces essences tout en maintenant leur potentiel de régénération, n'est pas encore connu.
- exploitation: la production comporte deux types de bois de chauffe: le bois coupé dans les parcelles de la forêt et le bois mort ramassé dans les terroirs. Les périodes de production et la quantité de chaque type de bois de feu dans la production annuelle ne sont pas les mêmes: le volume de bois provenant de la forêt est plus ou moins constant tandis que la disponibilité de bois mort est variable. La coupe de bois dans la forêt aménagée est réalisée par les équipes de bûcherons seulement de janvier à mars, tandis que le ramassage de bois mort (femmes, enfants) se déroule tout au long de l'année. La coupe pratiquée est à entaille double. Cette technique d'abattage permet non seulement d'orienter le sens de chute de l'arbre, mais surtout permet de laisser une souche en biseau réduisant la stagnation d'eau de pluie. La souche a une hauteur maximale de 15 cm, permettant ainsi l'apparition de rejets de souche très proches du sol. La coupe sélective autorise au maximum le prélèvement de 50% du volume commercialisable sur pied. Cette prescription technique n'a jamais été atteinte après six années d'application. Les plus forts taux de prélèvement enregistrés n'auraient guère dépassé 40%.
2.4.3. Organisation spatiale de la forêt
La matérialisation des limites de la forêt s'est faite par l'ouverture d'un layon, d'une largeur moyenne de 8 mètres. Le tracé du layon a pris en compte les limites officielles de la forêt, mais surtout les limites opérationnelles. Une superficie de 8 000 ha a été exclue de l'aménagement parce que fortement occupée. La forêt a été ensuite subdivisée en unités de gestion opérationnelle de superficies comprises globalement entre 2 000 et 4 000 ha, appelées unités d'aménagement (U.A.). Chaque U.A. est confiée en gestion à un ou plusieurs groupes de villages dont le choix s'effectue en fonction de la proximité, du nombre d'actifs et des affinités inter-villageoises. C'est à l'intérieur de l'U.A. que s'appliquent toutes les normes d'aménagement. Chaque U.A. est subdivisée en parcelles dont le nombre correspond à la durée de la révolution adoptée (20 ans). Le tableau n° 22 présente les caractéristiques de chaque U.A.
Tableau n° 22: Caractéristiques des unités d'aménagement
Unité d'aménagement |
Superficie |
Nombre de GGF |
Nombre de membres |
Production escomptée (m3) en
1993 |
Bleue |
2 852 |
2 |
79 |
3 455 |
Rouge |
2 249 |
3 |
113 |
2 582 |
Verte |
3 983 |
4 |
95 |
2 433 |
Brune |
2 779 |
4 |
118 |
1 822 |
Grise |
2 110 |
3 |
76 |
1 681 |
Jaune |
4 117 |
3 |
132 |
3 282 |
Orange |
3 932 |
7 |
207 |
2 130 |
Nabilpaga* |
1 657 |
0 |
* |
0 |
Total |
23 699 |
26 |
820 |
17 385 |
* L'unité de Nabilpaga est fortement dégradée et sert donc de champ d'expérimentations.
2.4.4. Répartition des responsabilités et système de commercialisation
Les responsables qui participent directement au processus de production et de commercialisation du bois sont les membres des GGF (Groupement de Gestion Forestière), le Bureau du GGF, le Chef d'Unité d'Aménagement, le Commis de commercialisation, et le Comptable du Chantier (encadré n° 34).
L'ensemble des GGF qui gèrent une unité d'aménagement constitue l'Union des GGF. Plusieurs unions se regroupent à leur tour pour former une Union Précoopérative de Gestion Forestière pour gérer un chantier d'aménagement forestier avec à sa tête une Direction Technique (encadré n° 34). La forêt classée du Nazinon constitue à elle seule un chantier d'aménagement forestier.
Encadré n° 34: Organisation du chantier d'aménagement forestier du Nazinon Groupements de Gestion Forestière Les Groupements de Gestion Forestière (GGF) sont à la hase de la politique d'aménagement des forêts naturelles. Ils sont définis comme des organisations volontaires à caractère économique et social jouissant de la personnalité morale et dont les membres ont des intérêts communs. Le fonctionnement des groupements est déterminé par le Statut général des groupements précoopératifs et sociétés coopératives au Burkina Faso et par leurs Règlements intérieurs. Les membres des groupements ont le droit de s'organiser par équipes de travail en fonction de leurs affinités personnelles. La production, c'est-à-dire le nombre de stères stockés au bord de route, des personnes ou des équipes est comptabilisée par des bureaux des groupements. Chaque bureau se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un moniteur. Il assiste et contrôle l'application du règlement de coupe, enregistre la production de leurs équipes, informe régulièrement le Chef d'Unité d'Aménagement de l'évolution et de la localisation des stocks. Les bûcherons reçoivent de leur bureau respectif 610 F CFA par stère au fur et à mesure que leur production est commercialisée Unités d'aménagement Une unité d'aménagement est gérée par un ou plusieurs (GGF formant une union des GGF. Les unités d'aménagement sont dirigées par un Chef de l'Unité d'aménagement choisi parmi les membres des groupements. Ses fonctions consistent à coordonner l'exécution du plan de gestion au niveau de l'unité d'aménagement et de représenter le GGF ou l'union des GGF au Conseil d'Administration. Il veille à coordonner avec les moniteurs de l'unité tous les travaux prévus par le plan de gestion pour l'unité d'aménagement. Dans le domaine spécifique de la production, le Chef de l'Unité est chargé, avec le commis de commercialisation d'enregistrer l'évolution et la localisation des stocks et de participer à l'élaboration d'un calendrier d'enlèvement du bois par groupement. Parallèlement, il doit contrôler avec les moniteurs de gestion forestière le respect du règlement de coupe et la qualité de la production, et faciliter la circulation de l'information entre l'unité et le directeur technique. Direction Technique. La Direction Technique est chargée d'appliquer le plan de gestion forestière pour l'ensemble des unités d'aménagement qui composent l'Union Précoopérative de Gestion Forestière, sous la tutelle directe du Conseil d'Administration et du Service Forestier. Elle est composée d'un directeur technique (cadre forestier), d'un animateur, d'un comptable, d'un commis de commercialisation, d'un gardien magasinier. Le directeur technique est nommé par le Directeur Régional de l'Environnement et du Tourisme (DRET), premier responsable du Service Forestier au niveau régional En étroite collaboration avec les chefs des unités d'aménagement, la direction technique doit proposer au Conseil d'Administration et à la DRET un plan de travail annuel en fonction des recettes escomptées et fournir des bilans trimestriels de son exécution technique et financière. Les frais de fonctionnement et les salaires de la direction technique sont supportés par le fonds d'aménagement forestier du chantier (voir encadré n° 35). Système de commercialisation. Le système de commercialisation est structuré de la manière suivante: tout commerçant de bois de feu qui souhaite se ravitailler au chantier forestier du Nazinon doit se présenter d'abord à un poste de contrôle où est affecté un commis de commercialisation à qui il présente les documents relatifs à sa profession. Celui-ci lui indique l'unité d'aménagement auprès de laquelle il doit s'approvisionner en bois de feu; il est reçu par le secrétaire du bureau qui organise le chargement de son camion et lui remet un ticket pontant les informations suivantes: le numéro du véhicule, le nom du GGF ou du bûcheron, la quantité de bois enlevée et la date. De retour du chantier et sur la hase des informations inscrites sur le ticket, le commis de commercialisation délivre au commerçant une facture qui est acquittée sur place. Périodiquement, le commis de commercialisation organise la répartition des recettes avec les responsables des GGF qui entrent en possession de la part revenant aux bûcherons des groupements Les parts des recettes correspondant au fonds d'aménagement forestier et à la taxe forestière sont encaissées par le comptable du chantier pour versement sur le compte bancaire du chantier et au Trésor Public respectivement. Les opérations sur le compte bancaire de l'union Précoopérative est réalisée conjointement par le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Régional de l'Environnement et du Tourisme ou son représentant officiellement accrédité. Ce système de commercialisation est fréquemment mis à l'épreuve par les commerçants de bois qui tentent de le contourner à la recherche de plus grands profits dans les zones non encore aménagées. C'est donc pal l'extension des zones aménagées et le renforcement du contrôle que les fraudes pourront être minimisées. Commission de Contrôle La Commission de Contrôle mandatée par l'Assemblée Générale de l'Union Précoopérative a la responsabilité de vérifier périodiquement l'exécution du plan de gestion, les livres, la caisse et les valeurs de la société coopérative Elle peut dans l'exercice de ses fonctions se faire assister pour un temps limité ou pour une tâche précise, par un organisme spécialisé. La Commission de Contrôle est composée d'un représentant du Service Forestier désigné par la Direction Régionale de l'Environnement et du Tourisme, d'un représentant des Autorités villageoises, et d'un représentant du ministère chargé des coopératives Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration est chargé de l'administration générale de l'Union Précoopérative des fonctions spécifiques sont d'observer et de faire respecter les statuts de la société et la réglementation en matière de coopérative. Il est composé des chefs des unités d'aménagement. La direction du Conseil d'Administration est choisie par l'Assemblée Générale des unions des GGF, représentées par les bureaux de tous les groupements associés à l'Union. La fonction d'administrateur est gratuite Toutefois, les dépenses encourues par un administrateur dans l'exercice de ses fonctions autorisées ou ratifiées par le Conseil d'Administration doivent lui être remboursées Le Conseil d'Administration se réunit trimestriellement ou sur convocation du Président. Budget du Chantier Le budget du chantier est l'exposé prévisionnel de l'ensemble des recettes et des dépenses, ainsi que de l'objet et le moment de leur utilisation. Il est annuel, mais divisé en tranches trimestrielles L'élaboration du budget est de la responsabilité du Directeur Technique, qui doit le soumettre au Conseil d'Administration et au Directeur Régional de l'Environnement et du Tourisme, dans la première semaine du mois de décembre chaque année. La version définitive du budget est adoptée par le Conseil d'Administration. Le budget du chantier est formulé sur la base de la projection de la production escomptée et les réserves de l'exercice budgétaire précédent. Les réserves sont équivalentes à 10% du montant total des recettes annuelles. Afin de faciliter la planification, le contrôle et l'évaluation des activités du chantier, le budget est organisé suivant une structure normalisée lait de rubriques et à l'intérieur de celles-ci des lignes budgétaires. Recettes Les recettes du chantier sont générées par la vente du bois de feu. La production est constituée du bois coupé dans les parcelles de la forêt et du bois mort ramassé dans les terroirs. Néanmoins, le prix au bord de route est le même pour les deux types de produits (1 610 FCFA/stère). Par conséquent, les prévisions des recettes annuelles sont conditionnées par le volume de production de bois de feu et par son prix au bord de la route. Dépenses Les
organismes autorisés à engager et à régler des
dépenses sont le Conseil d'Administration et le DRET,
agissant conjointement par délégation des pouvoirs du
Conseil d'Administration. Celui-ci, suite à l'adoption
du budget annuel, autorise l'engagement des dépenses
conformément à la programmation trimestrielle.
L'exécution du règlement des dépenses programmées est
de la responsabilité du Directeur Technique du Chantier,
sous la tutelle directe du Président du Conseil
d'Administration et du DRET. Les ajustements de la
programmation trimestrielle, ainsi que du montant du
budget annuel relèvent exclusivement de l'autorité du
Conseil d'Administration. |
L'organigramme du chantier forestier du Nazinon
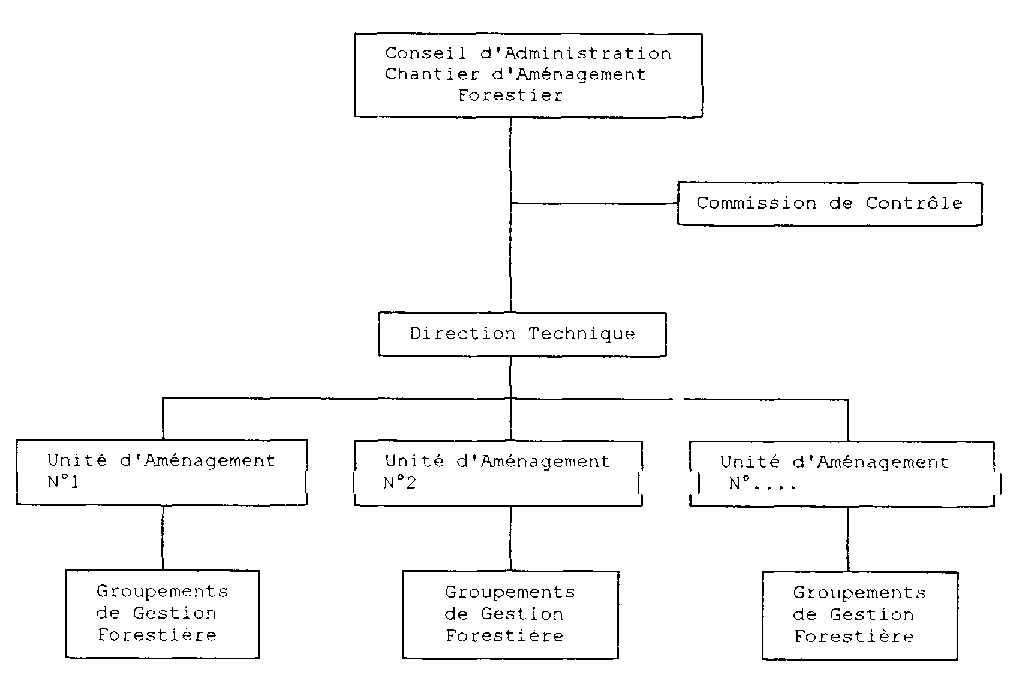
Encadré n° 35: Genèse du Fonds d'aménagement forestier (FAF) Le 15 juillet 1985, date du démarrage de l'application de la "Lutte contre la coupe anarchique du bois", le Service Forestier a stratégiquement et provisoirement institué le ramassage du bois mort. C'est ainsi que dans le cadre du ravitaillement de la ville de Koudougou. située à 100 km à l'ouest de Ouagadougou, un premier groupement de six bûcherons s'est créé pour le ramassage du bois mort dans la forêt classée de Tiogo. Un système de commercialisation a été mis en place, qui consistait à délivrer au commerçant un ticket indiquant la quantité de bois à enlever sur le chantier, au niveau du poste forestier de Ténado. Parce qu'analphabète, le groupement a recruté un commis pour suivre la commercialisation du bois. Les recettes encaissées au niveau du poste forestier étaient ensuite régulièrement réparties de la façon suivante (Kabore et al., 1987): 300, 200 et 1 110 F CFA respectivement pour la taxe forestière (permis de coupe), pour la caisse commune destinée à recevoir les cotisations pour la satisfaction des besoins collectifs du groupement et enfin pour la rémunération individuelle des membres du groupement Durant les premiers mois d'activité, le revenu moyen par membre du groupement atteignait 80 000 F CFA, revenu Si substantiel en milieu paysan que le groupement a commencé à embaucher d'autres paysans pour confectionner des stères. Il a en outre réalisé une plantation forestière d'un hectare Constatant que seule la forêt n'avait pas sa part dans le partage des recettes et tirant leçon de l'échec de certains projets de plantation forestière qui n'avaient pas suffisamment prévu les charges récurrentes, le Service Forestier a alors décidé que, dans le cadre des projets d'aménagement de forêts naturelles au Burkina Faso jusque-là financés par des ressources extérieures, il sera négocié avec les groupements de bûcherons le prélèvement d'une partie des recettes pour autofinancer la gestion forestière. Ainsi naquit l'idée du Fonds d'aménagement forestier. Il fut demandé au projet "Aménagement et exploitation des forêts pour le ravitaillement de Ouagadougou en bois de feu" (Projet PNUD/FAO/BKF/85/011) de le tester. La direction du Projet proposa alors aux groupements nouvellement créés le prélèvement de 710 F CFA sur le prix d'achat aux producteurs (de 1 610 F CFA/stère). La proposition fut dans un premier temps acceptée, mais a été remise en cause quelques mois plus tard par les groupements gui trouvaient la taxe trop élevée. Une nouvelle négociation permit de rabaisser le prélèvement à 500 F CFA/stère. En 1995, la création du FAF est généralisée dans tous les projets d'aménagement forestier au Burkina Faso, avec des taux de prélèvent variables allant de 250 F CFA à 600 F CFA selon les prix d'achat des différents types de bois de feu (espèces locales ou exotiques), et en tenant compte de l'obligation que la rémunération journalière du bûcheron ne soit pas inférieure au salaire minimum agricole garanti. |
2.4.5. Composante pastorale
L'exploitation des potentialités fourragères a été perçue dès le départ comme une donnée incontournable dans l'aménagement des forêts naturelles qui constituent également des zones de pâturage par excellence; la forêt classée du Nazinon n'a pas fait exception. Une étude de la composante pastorale a été entreprise dans le cadre de son aménagement:
- le nombre de têtes de bétail utilisant les ressources fourragères et les points d'eau dans la forêt était en 1989 de 21 000, dont 16 000 bovins et 5 300 ovins et caprins;
- le pâturage disponible représente environ 40% de la superficie totale de la forêt, soit 14 400 ha sur la base de 7 ha/UBT, la capacité de charge théorique de la forêt a été estimée à 2 000 UBT. Il a été proposé d'ouvrir la forêt au pâturage cinq mois par an, en portant la charge du bétail à 4 800 UBT pour une utilisation intense du pâturage de saison de pluies. Il permettrait de réduire l'importance du tapis herbacé, et partant, l'intensité d'éventuels feux non désirés de saison sèche.
Ces hypothèses ont permis d'engager des discussions entre le projet, les éleveurs, les agriculteurs et les techniciens de l'élevage, qui ont abouti à l'élaboration d'un cahier de charges pour le pâturage en forêt. Il contient essentiellement les points suivants:
- les parcelles exploitées et/ou enrichies doivent être soustraites au pâturage pendant au moins dix-huit mois pour permettre la reconstitution du potentiel ligneux;
- les parcours doivent faire l'objet d'une rotation annuelle afin d'éviter la création à court terme de couloirs de surpâturage;
- l'émondage et l'étêtage des arbres et des arbustes sont interdits;
- la couverture sanitaire minimale du cheptel doit être assurée par les éleveurs avec l'appui technique du projet et du service chargé de l'élevage;
- la formation technique est assurée par le projet et le service chargé de l'élevage.
L'élevage dans la zone constitue une des principales activités des populations. C'est un élevage traditionnel avec des migrations saisonnières vers le sud, par suite de la pression des transhumants venant du nord du pays. On y distingue en effet trois types d'éleveurs: éleveurs traditionnels (Peuhls) de la zone, agro-pasteurs Mossis, éleveurs transhumants qui parcourent intensément la zone pendant la période allant du mois de janvier au mois de mai.
Des essais de pâturage contrôlé (en juillet - août) et de récolte et stockage de foin, entrepris par le projet, n'ont pas donné de résultats encourageants. L'interdiction d'installer des campements dans la forêt et le fait que le parcellaire conçu pour la gestion forestière n'ait pas pris en compte la répartition spatiale du disponible fourrager, expliqueraient le résultat peu satisfaisant du pâturage contrôlé, en particulier le non-respect de la capacité de charge; le désintéressement des éleveurs pour la constitution du foin s'expliquerait par le fait que cette activité leur est traditionnellement étrangère (encadré n° 36).
La synthèse des données de l'étude précitée a permis de formuler des propositions présentées par ordre de préférence des pasteurs ouvrir la forêt au pâturage, implanter des forages en dehors de la forêt et mettre en place un marché à bétail, assurer une assistance à la santé animale et ouvrir un magasin d'intrants zootechniques.
Encadré n° 36: Situation sommaire du sylvo-pastoralisme au Burkina Faso Le respect de la capacité de charge des forêts est fondamental pour l'utilisation rationnelle du potentiel fourrager. Malheureusement, l'expérience montre que cette exigence écologique n'est jamais respectée, même dans certaines zones exclusivement pastorales, aménagées au Burkina Faso Ainsi, par exemple, les éleveurs ont refusé d'intégrer une zone pastorale aménagée si leurs caprins n'y étaient pas admis, alors que cette possibilité était effectivement proscrite par le plan d'aménagement. Ailleurs, les éleveurs ont fait semblant, dans un premier temps, de se conformer aux exigences des plans d'aménagement en intégrant les zones aménagées avec les effectifs de troupeaux fixes. Par la suite et progressivement, ils y ont introduit la totalité des troupeaux qu'ils avaient gardés hors des zones aménagées La rai son essentielle toujours évoquée est que l'élevage traditionnel reste encore moins une activité économique qu'un mode de vie des éleveurs. Il est alors très difficile, voire impossible d'amener ceux-ci à ajuster les effectifs de leurs cheptels en fonction des ressources fourragères disponibles Actuellement, l'aménagement à buts multiples des forêts naturelles ne doit pas par conséquent prétendre satisfaire les besoins alimentaires des animaux, mais y apporter une contribution. En effet, ce problème ne peut se résoudre que, d'une part, par le changement de mentalité des éleveurs (pour faire d'abord de l'élevage une activité économique et d'autre part, par l'organisation de l'espace rural dans le cadre de la gestion des territoirs. Celle-ci doit être complétée par des activités de recherche appropriées, lices à l'utilisation rationnelle des ressources fourragères (jusqu'à présent les expériences ne prennent pas en compte les fourrages ligneux et les rotations ne sont pas toujours bien définies et contrôlées) et à l'augmentation de la productivité des espaces sylvo-pastoraux. Mais en attendant l'exploitation des pâturages doit y être admise dans l'espace et dans le temps, de préférence pendant la saison des pluies (quand les zones pâturables dans les terroirs sont cloisonnées par les champs agricoles) afin de contribuer à minimiser les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Cette mesure pourrait être complétée par l'implantation de forages pour l'approvisionnement en eau des troupeaux, en dehors des forêts aménagées, cela permettrait de maintenir les animaux hors forêts. Les techniques proposées par les spécialistes de l'élevage (fauchage d'herbe et conservation de fourrage) ont eu jusqu'à présent un impact faible. |