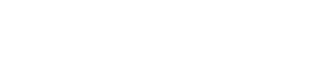Vers des systèmes alimentaires durables
La Journée mondiale de l’alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre, date anniversaire de la fondation de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) en 1945.
Elle donne l’occasion aux personnes du monde entier qui interviennent dans un des multiples aspects du système alimentaire de s’entretenir sur le rôle vital que joue la nourriture dans nos vies et de réfléchir sur comment améliorer les choses.
Le processus de production de la nourriture et de l’acheminement jusqu’à nos assiettes est extrêmement complexe. Il comporte de nombreuses phases et une multitude d’acteurs – agriculteurs et pêcheurs, bien sûr, mais aussi scientifiques qui élaborent des technologies, pourvoyeurs d’intrants agricoles, personnes chargées du transport, du stockage et de la transformation, et enfin, de la commercialisation. Les êtres humains sont tous des consommateurs de nourriture, et ce qu’ils choisissent de manger, comment ils l’achètent, le préparent et le nombre d’enfants qu’ils ont sont autant de facteurs qui déterminent la nature et l’importance de la demande globale de nourriture. On pourrait dire que le système alimentaire fonctionne bien en présence d’un équilibre satisfaisant entre la demande et l’offre mondiales de nourriture. Le thème de la Journée mondiale de l’alimentation cette année – Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition – nous invite à évaluer le fonctionnement du système et ce qui peut être accompli pour le perfectionner.
Du strict point de vue de l’offre et de la demande, nous pouvons affirmer que, depuis 1945, le système alimentaire a fonctionné remarquablement bien. La population mondiale a triplé durant cette période et les disponibilités moyennes de nourriture par habitant ont augmenté de 40%. Il s’agit là d’une avancée formidable et nombreux seraient les économistes à l’invoquer pour témoigner de l’efficacité du «marché» à mettre en adéquation l’offre à la demande croissante émanant d’une population mondiale plus riche et en rapide expansion.
Si nous y regardons d’un peu plus près, toutefois, nous constatons que le fonctionnement du système alimentaire révèle d’énormes lacunes. Le plus gros échec est que, malgré l’abondance des approvisionnements alimentaires, la santé de plus de la moitié de la population mondiale de 7 milliards d’habitants est victime de sous ou de surconsommation. Il y a tout juste 3 ans, des millions de Somaliens ont été contraints d’abandonner leurs foyers pour se mettre en quête de nourriture et la famine a fait 260 000 victimes, dont beaucoup d’enfants. Cela nous a rappelé de façon dramatique que le marché alimentaire mondial fonctionne bien pour ceux qui ont les moyens, mais échoue quand il s’agit de satisfaire les besoins des plus pauvres.
Encore aujourd’hui, quelque 840 millions de nos semblables sont victimes de pénuries alimentaires quotidiennes qui les empêchent de travailler, retardent la croissance de leurs enfants, les exposent à la maladie et à une mort prématurée. La santé de deux autres milliards de personnes est compromise par les carences en nutriments. À l’autre extrémité, le surpoids ou l’obésité touche 1,5 milliard de personnes qui ingèrent plus de nourriture qu’il ne leur en faut et qui s’exposent à des risques accrus de diabète, de problèmes cardiovasculaires et d’autres maladies.
Ce qui est clair, c’est que «le marché» à lui seul ne traduit pas automatiquement les disponibilités vivrières en une meilleure nutrition, meilleure santé ou meilleure productivité. La défaillance la plus flagrante du marché dérive du fait que la pauvreté rend ceux qui ont les plus gros besoins alimentaires incapables de les traduire en demande. Ils sont pris au piège de la faim, lequel s’auto-perpétue, car ils n’ont pas les moyens d’acheter ou de produire la nourriture dont leur famille a besoin pour mener une vie saine. Que la faim perdure dans un monde d’abondance est tout simplement scandaleux.
L’autre grand échec est lié au système alimentaire actuel, avec ses dimensions à la fois environnementales et humaines, qui ne s’inscrit pas dans une optique de durabilité. La croissance prodigieuse de la production vivrière a exercé, pour une large part, de fortes pressions sur les ressources naturelles : en dégradant les sols, en polluant et en épuisant les disponibilités d’eau douce, en empiétant sur les forêts, en appauvrissant les stocks de poissons sauvages et en réduisant la biodiversité, laissant à ces mêmes ressources une capacité réduite de satisfaire les besoins alimentaires de nos enfants et des générations futures.
Les systèmes d’exploitation intensive et les gaspillages et pertes alimentaires à grande échelle sont désormais une vaste source d’émissions de gaz à effet de serre à l’origine des processus du changement climatique, lesquels imposent de nouveaux défis d’adaptation aux agriculteurs. Même les consommateurs les plus nantis ne contribuent pas encore au coût de ces dégâts au capital naturel, ni à leur élimination.
On aurait pu supposer que la demande croissante de nourriture entraînerait une plus grande prospérité des communautés agricoles et halieutiques qui auraient ainsi produit davantage. Mais paradoxalement, c’est précisément cet accroissement des disponibilités alimentaires, associé aux politiques de protection commerciale et de subventions des pays développés et au pouvoir de négociation limité des agriculteurs face aux sociétés d’import-export, aux entreprises agroalimentaires et aux détaillants, qui a porté à une concentration grandissante de la pauvreté dans les zones rurales de nombreux pays en développement.
La preuve en est que 70% des affamés de la planète vivent en milieu rural et que leurs moyens d’existence sont essentiellement tributaires de la production vivrière. Voilà pourquoi nous devons mettre à profit cette Journée mondiale de l’alimentation pour partager nos opinions et expériences sur la manière de mieux affronter ces deux enjeux de taille : comment traduire la disponibilité croissante de nourriture en meilleure nutrition pour tous et comme effectuer le changement de cap qui s’impose vers des systèmes de production et de consommation écologiquement et socialement durables. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette tâche en modifiant nos propres modes de vie ; et nous sommes tenus de le faire si nous voulons remédier à l’effroyable situation alimentaire que je viens de décrire. J’ai la conviction que nous pouvons faire beaucoup mieux sur les deux fronts. Nous avons désormais la preuve que dans maints pays résolus à garantir le droit à l’alimentation à leur peuple, la faim et la malnutrition peuvent être atténuées rapidement par des mesures directes.
Citons, par exemple, les programmes de repas scolaires et les transferts monétaires en faveur des familles les plus démunies pour leur permettre de combler leur déficit vivrier et de récupérer leur autonomie. En traduisant ces besoins alimentaires en demande, des programmes de ce type peuvent stimuler les marchés locaux pour les petits agriculteurs. Nous apprenons aussi des mouvements de commerce équitable et de Slow Food, ainsi que de la certification des produits alimentaires et forestiers tirés de sources gérées durablement, que le consommateur individuel peut, en faisant ses courses, décider d’améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs et pêcheurs et de les encourager à adopter des pratiques de production durables.
Les États membres de la FAO ont récemment réaffirmé les deux priorités absolues de l’Organisation : œuvrer pour l’éradication rapide de la faim et de la malnutrition et accélérer le passage à des systèmes de production vivrière et de consommation durables. Je ne doute pas, chers lecteurs, que cette cause vous tient à cœur et que nous pouvons compter sur votre soutien pour atteindre ces buts dans les plus brefs délais possibles !